Guy Perrocheau, D’un phrasé monde
Où sommes-nous dès que nous ouvrons le livre de Guy Perrocheau, D’un phrasé monde ? Comme l’indique le poème liminaire, « vivre a poursuivi / son glissando » (p. 9).
Ce monde n’a rien d’un monde contemplé, ni observé qui le constituerait en objet. Le glissando que ce livre accomplit en sept parties, qui sont comme autant de mouvements, fait tout le contraire : du monde, il écrit le récitatif. Le « phrasé monde » de Guy Perrocheau concentre une énergie de la parole par une écriture : il la concentre et en même temps l’élargit, car le propre de l’écriture, dans ce livre, est de mener la parole, la moindre pensée qui la traverse, vers une dimension d’écoute que jamais cette parole n’aurait eu sans elle.
Il est troublant que, dès son titre, D’un phrasé monde soulève cette si ancienne relation du poème à la musique et qu’elle rende manifeste un rapport que l’on peut comprendre ainsi: que la musique est ici musique du poème ou que le poème, dès les premières lignes, rencontre sa musique, à savoir son glissando, son phrasé, son récitatif, qui sont la poursuite de son « vivre ». Dans ce premier poème du livre, le glissando découle de ces glissades, de la première ligne « … à ces bords de tertres usés de glissades ».
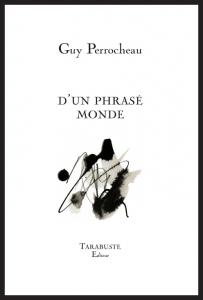
Guy Perrocheau, D’un phrasé monde, éd. Tarabuste, 2020, 132 p., 14 euros.
Happés par une phrase qui a déjà commencé, et qui est prise en un milieu, on y lit un peu le passage, en un glissement, d’une évocation paysagère à une évocation des opérations d’un phrasé intérieur au poème, aux dernières lignes « vivre a poursuivi / son glissando ». Entretemps : « les ténèbres de soi qui ont couru », « imaginez le sable qui vous enlise en dansant », « et le désert même ajusté / pile à ses poussées de sève ».
Ce premier poème semble alors poser une chose cruciale : que c’est dans ce phrasé, par cette musique à soi, qu’est reconnu – et vécu – le monde : « aube et nuit comme une seule friche on croirait / les stries de clarté qui raient le fond du monde ». C’est ce quelque chose du monde que l’on trouve en soi et dont le poème est la « répondance », au sens où Péguy entendait par là des séries d’échos, de reprises. De « friches » à « stries de clarté qui riaient », le livre de Guy Perrocheau montre une poésie de l’instant unique et d’une expérience subjective de l’intimité dans le langage. Il nous apprend, ou nous pousse à reconnaître, que dire « monde », c’est rejoindre le monde par une densité de langage. Entrer dans le monde, c’est entrer dans le langage, un peu comme avec Vargaftig, quand il écrit pour titre d’un livre Le Monde le monde (éd. André Dimanche, 1994) : si le mot se fait écho, c’est en deux instants, ce qui fait qu’il n’est jamais le même. Reprendre n’est jamais répéter. Dire ne crée pas une essence, mais un passage et une fiction. Le « phrasé monde » en est la création, l’invention, le franchissement ainsi que le basculement d’une ontologie et d’une phénoménologie vers une anthropologie.
La clarté est le problème poétique angulaire du livre. On le retrouve dans le motif ténébreux du début, qui se prolonge « jusqu’à / plus rien que la lumière » (p. 9) et se retrouve dans l’obscur, très présent au fil des pages. Sans doute y a-t-il là quelque chose d’une lecture de Rimbaud, dont les Illuminations sont citées à chaque nouvelle section. La lumière est certainement à l’intersection du monde et de la phrase ; elle renvoie à ce que c’est qu’être un sujet dans le monde, un sujet dans le langage ; et l’on pourrait dire que cette phrase devient phrasé parce qu’elle se poursuit d’un bout à l’autre du livre, ce qui fait dire que ce n’est pas un recueil que nous tenons, mais un poème qui se cherche et s’écoute, se construit à chaque page. De sorte qu’à chaque fois nous sommes face à une page de ce poème, lieu d’écoute, d’attention et de vertige (« je m’envertige », p. 33). Et aussi le lieu d’une improvisation qui ne sait pas vers quoi elle va à force de s’y trouver. Ainsi chaque partie recommence-t-elle aussi le livre par cette lumière, non exempte d’obscur : la « supposée présence / muée jour nuit / secousse à secousse en un / phrasé monde » (p. 13), puis « l’issue par un tunnel / et je reçois le soleil » et « des rimes s’embrouillent tant / qu’on ne sait plus où / son petit printemps sur le dos / la lumière coule » (p. 31). Alors, « la lumière semble / ne plus devoir finir » (p. 53) et l’ « aube et nuit sur cette friche » (p. 59) reviennent pour que « des voix prennent leurs couleurs de la nuit » (titre de la cinquième section, p 71), avant cette question qui est aussi une affirmation en suspens : « vers quel autre / aujourd’hui » (p. 91). Enfin, la traversée de l’obscur dans la lumière, la lumière perçant l’obscur s’écrivent dans leur réciprocité parce que c’est de la traversée d’un sujet qu’il s’agit, l’un des « voyageurs du comment dire » : « autant de fois en un jour / que je suis entré dans cette spirale / et que j’en suis sorti […] j’avance dans aujourd’hui je tourne à / l’autre bout comme au centre » (p. 111). Le poème est « aujourd’hui » : sa clarté pousse ce je, résolument autre que celui assigné à une identité, à constituer un temps spécifique, celui de la reprise et du continu, autant de fois en un jour.
C’est ainsi qu’il y a un sens du passage dans cette poésie. Pour le dire autrement, avec la page 47, « pas le décompte / des choses vues / mais la traversée ». Dans une proximité avec la poésie de Meschonnic, voyage et passage (Voyageurs de la voix et Nous le passage, éd. Verdier, 1985 et 1990) construisent une intériorité critique de la personne dans et par l’intime. L’intime n’est pas la personne, chaque page le rappelle, et celle-ci l’énonce : « chaque fois la page tourne / une mémoire met bas / ses petits / ce qui fut / sera / l’aorte / comme un tronc » (p. 76). Avec cette mémoire qui se réinvente page à page, l’intimité qui affleure compose un récit irréductible à toute narration, un récit inénarrable pour ainsi dire et qui se construit comme continu : à lire le livre, on est surpris par tout ce qui s’y continue, chaque ligne tendant une sorte de perche à l’autre. Le tronc fait l’arbre et les branches : on pense aux « poussées de sève » du premier poème, à l’ « arbuste en fleurs / sitelle voletant / mes sentiers à l’aveugle ont ouvert / par mille et mille les plus longs / jardins de l’enfance » (p. 20), à « la forêt d’errance » (p. 34), à « la / lenteur arrêtée d’un feuillage » (p. 37). Enfin, « chaque arbre bouge / ou bien c’est une aube » (p. 48). Expérience subjective, donc artistique, le récit est un récitatif. Nous sommes donc au milieu d’un monde dans une phrase continue, dans ce qui ne cesse de « reprendre en nous les parcours / d’un phrasé monde » (p. 125), comme on le lit au final.
L’arbre pluriel de ce poème, mémoire et oubli composant l’aujourd’hui obscur et lumineux, est encore mis en mouvement : un « enrythmement » (p. 101) faisant une poésie de la page, de l’improvisation maîtrisée et finement travaillée, toute en abandon et ressaisie. S’y construit une écoute, qui en retour construit l’improvisation, le geste de l’écriture : « cette oreille qui écoute / où la beauté recommence » (p. 103). Cette maîtrise garde fidélité à « la dérive » qui pousse à (s’) écrire, sans jamais s’en tenir à du calcul ou de l’intention : « un langage advient / plus large que je n’ai pensé / plus fort que je n’ai voulu » (p. 41). Le vol et le chant d’un oiseau en donnent une idée, avec le parcours en élévation terrestre-aérienne de l’arbre : « toute douceur entre les mille / manières d’oiseaux en liesse / trouant les matinées pensives pour / quel point haut dans l’air / à nous toujours » (p. 123). Et le lecteur y retrouve des mots qui sont les siens : « chacun dans sa rencontre à l’infini de / chacun » (p. 94). Il y est écrit. C’est dire que D’un phrasé monde est à lire pour s’entendre dans sa trajectoire. Ce n’est pas tant être dans un lieu qu’être dans un mouvement.
