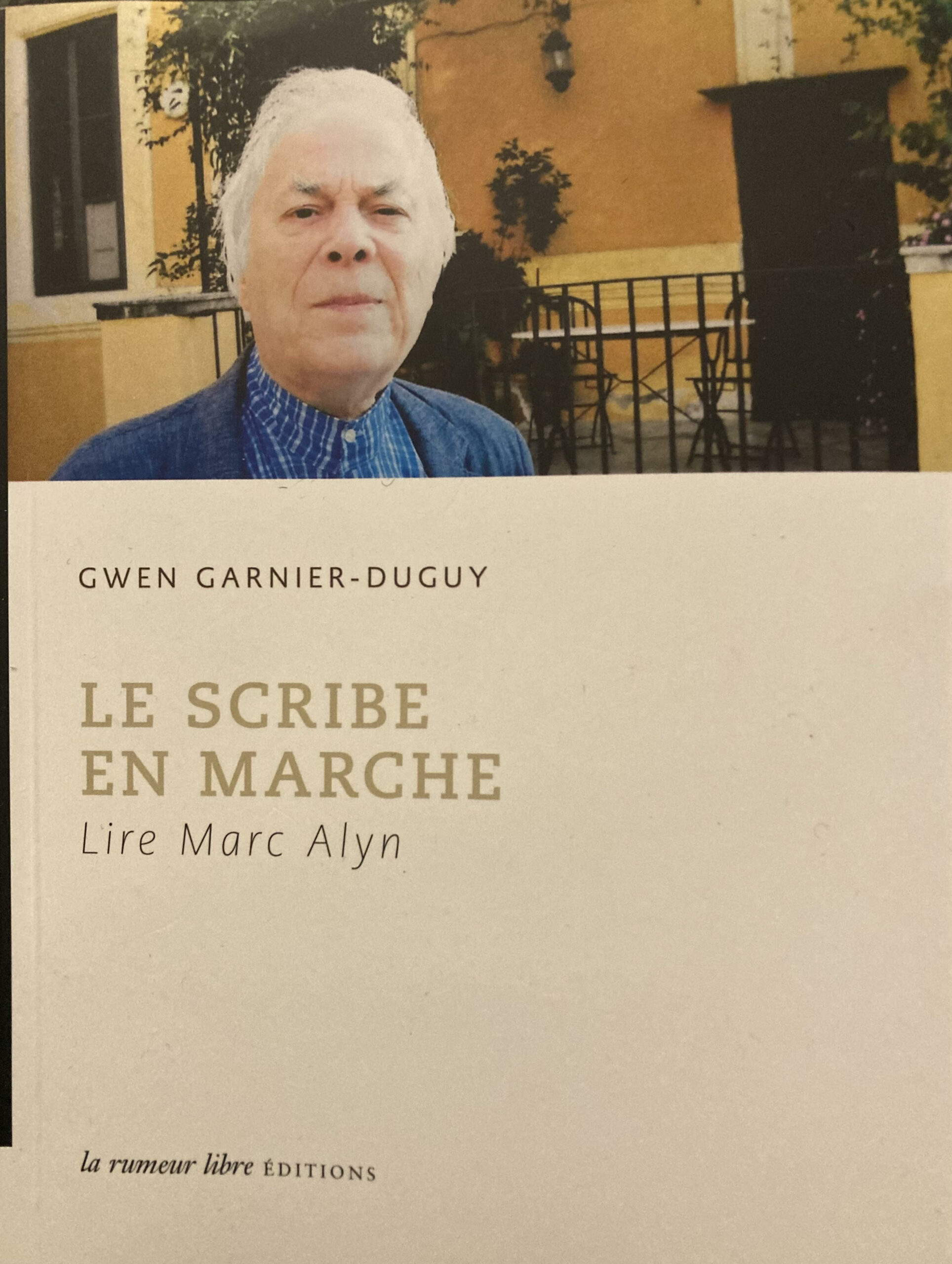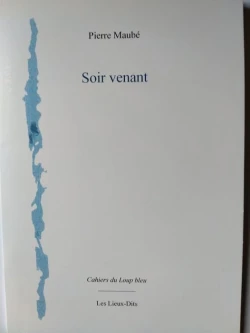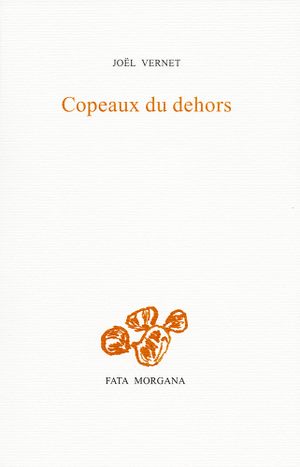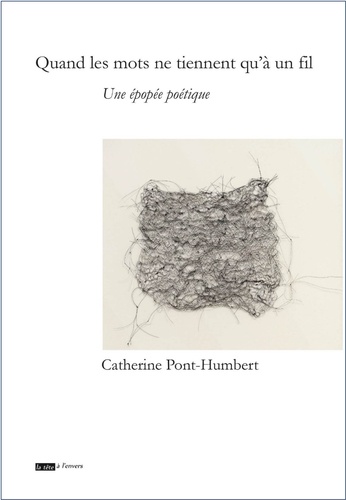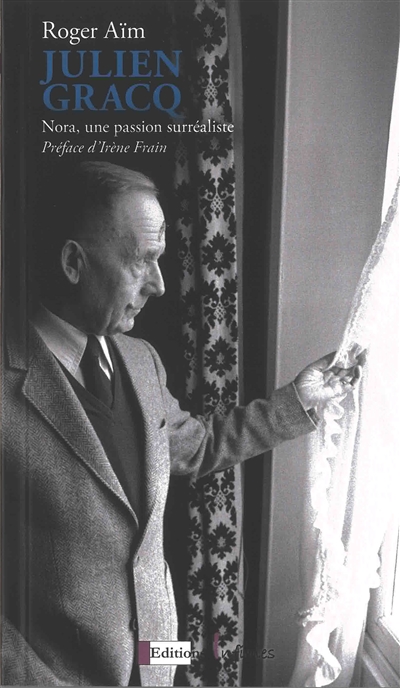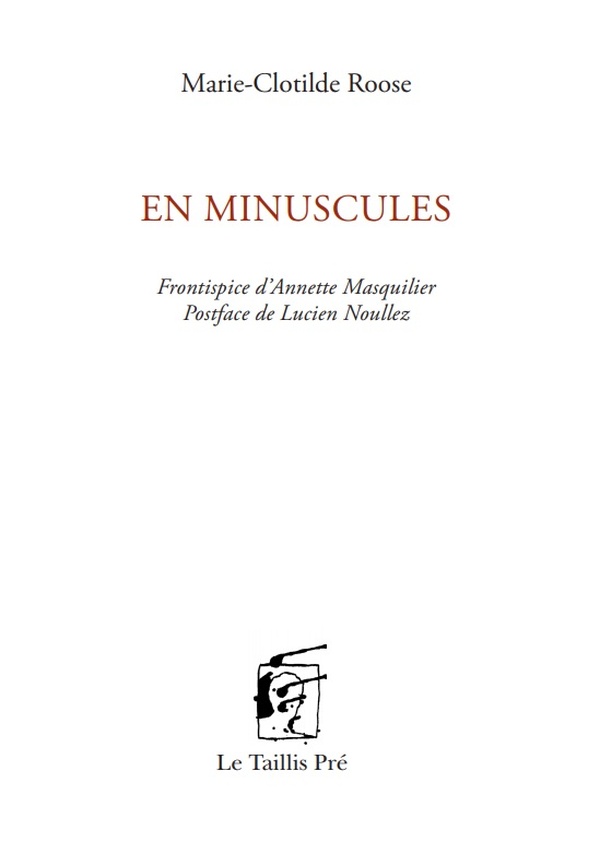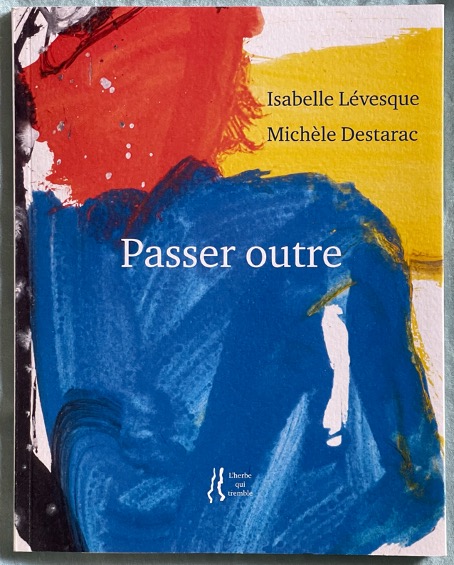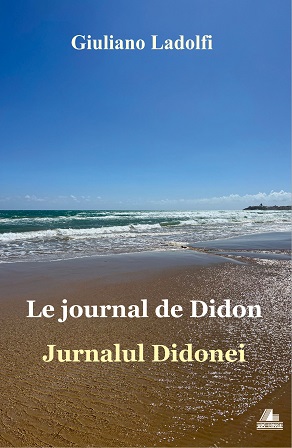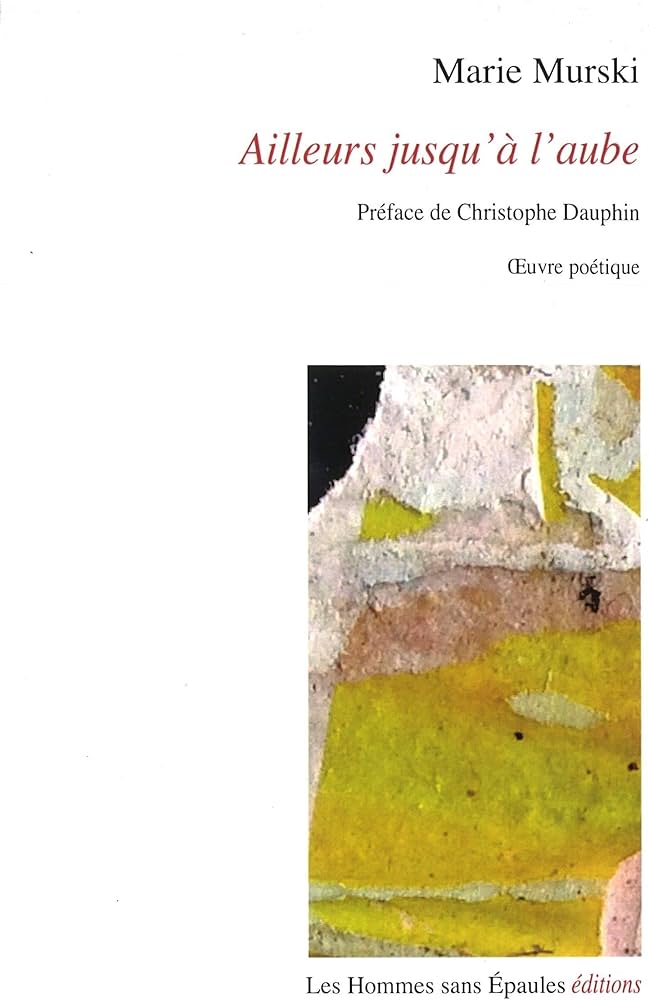Je souffle, et rien est un livre de deuil, quelque chose entre une « lettre au père » et un livre-tombeau qui pourrait s’inscrire dans la lignée des textes explorés par Marik Froidefond et Delphine Rumeau à travers leur volume consacré aux Tombeaux poétiques et artistiques (2020). Il pose des questions essentielles sur le rapport de la poésie à la mémoire et au deuil.
Fait singulier, ce livre ne dévoile que peu à peu l’identité du mort. Celui-ci est d’abord un centre vide, autour duquel gravite l’écriture et où le lecteur peut projeter ses propres figures de disparus. Le lien entre la poète et le lecteur s’en trouve intensifié. Mais peu à peu nous devinons l’identité du mort par de plus en plus d’indices disséminés : le mort se révèle être le père, comme le suggèrent par exemple la primauté de l’enfance dans le livre et le lien entre le prénom du père dans la dédicace (« à Claude et Françoise Lévesque ») et le mot « claudique » qui traverse le livre, à déchiffrer toujours jusque dans le tremblé de l’infinitésimal et du non ‑dit.
Cette mort atteint de plein fouet l’enfance : « Fini les fées, / fini le bois du conte à Noyers. » (p.44). Les jeux de l’enfance, la montée dans les arbres (« Tu disais ‘arbre’, j’entendais / réduite la syllabe du jour. / Nous grimpions Le souffle manquait. », p. 53) et la « marelle (« Parce que géant sur la marelle / toi si haut, moi plus bas », p.113), sont révolus. Si désormais « l’enfance est une arme douloureuse » (p.74), le paysage de cette enfance aux « Andelys » (p. 74), auquel le livre ne cesse de revenir comme à un aimant, porte les marques d’un drame intime.

Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien, L’herbe qui tremble, 2022, 18 euros.
L’unité de lieu, comme dans la tragédie, resserre encore ce drame. Indissociable du livre est la « falaise » de l’enfance, qui est prise dans un mouvement de chute (« La falaise a craqué, craie vive d’un feu sans flamme », p.82, « La falaise, (…) / s’effondre », p.107) que l’être lui-même épouse : « La falaise tombait, / je la suivais » (p.67). Autre lieu crucial du paysage de l’enfance, la Seine, paisible seulement en « apparence » (p. 23), entraîne elle aussi la chute mentale de l’être : « Je tombe, je frissonne, j’ai vu la Seine / au plus fort de février, j’ai chu » (p. 81). Tout se passe comme si le deuil avait décomposé le paysage : « La Seine / Les Andelys / n’existent plus, / couverts/ par la mer de notre silence » (p.124). Au-delà du paysage, c’est l’espace-temps de l’origine qui est bouleversé : « Des morceaux de temps / détachés (en fractions) / s’écartent de l’origine » (p. 47). La perte a ici une dimension cosmique. A l’heure du deuil, il est éternellement « minuit », noir : « Toujours minuit, toujours, maintenant parcouru/ d’étoiles disparues » (p. 26).
Le livre, qui est tout entier une adresse à l’autre manquant, pourrait se placer sous le signe de la définition du lyrisme par Martine Broda : le lyrisme est « une adresse à l’Autre donné comme essentiellement manquant » (L’amour du nom). Le « manque » est d’ailleurs le centre générateur du livre : « Matin, réveil. Pas pareil, / tu es cru, crûment/ ‑manquant » (p.80). Le couplage des mots « Pas pareil », qui donne à entendre le signifiant « papa », contribue à aider le lecteur à identifier le mort au père. Tout au long du livre, le tutoiement scande l’adresse au mort, qui est prise dans un mouvement de rapprochements rêvés (« A Noël où je suis née, / presse-moi contre ton cœur », p. 94) et d’éloignements répétés : « Tu t’éloignes » (p.21) … « Blessé, tu t’éloignes » (p.42) … « Tu t’éloignes / et je cours » (p.67). Parfois l’éloignement est vertical et s’identifie à un « enfoncement », d’autant plus intense qu’il est souligné par le couplage du maitre mot « enfance » et du mot « enfonces » : « Là au pied de l’arbre, sous les feuilles d’or / tu t’enfonces » (p.32). Le père lui-même redevient parfois l’enfant qu’il a été : « Tu es l’enfant blessé, / genoux écorchés, tu es l’abandonné » (p.29). Dans l’adresse au père, le chiffre 9 est une clé indissociable du mouvement d’éloignement. Désignerait-il le jour de la mort : « Tu t’éloignes. Oublier le chiffre 9 » (p.21) ? Peu à peu s’esquisse avec délicatesse, en filigrane, un portrait du père : « ta voix grave » (p.30), « ta barbe inchangée « (p.81), « ta barbe de sel » ( p.102) . Mais sans cesse le portrait se dérobe : « c’est toi, forme-fumée » (p.24). Cela n’empêche pas la poète de toujours « courir » derrière le père et d’inventer des « rendez-vous » secrets près des « falaises » de l’enfance : « Alors je cours, cent fois je cours. // Je cours, / j’invente un rendez-vous. // Falaise ! » (p.47). Mais le « rendez-vous » n’a jamais lieu : « Je me penche. A 18 heures/ le soleil s’est couché (je pleurais). / Tu n’es pas venu » (p.67). Tout le livre est tendu vers le pronom « nous », incarnation verbale de la fusion impossible : « nous s’est dispersé à l’instant » (p. 80). Cependant le « je » ne renonce pas à son désir de créer des rituels de signes (« ton anagramme trace ici / une suite de signes au nom d’étoile », p. 32) parfois à vocation résurrectionnelle : « Je cours vers toi sur les eaux / pour te faire renaître » (p. 54). Une discrète présence du mythe d’Orphée et d’Eurydice, mise en relief aussi dans la très belle postface de Jean Marc Sourdillon, approfondit encore le livre, comme le suggèrent le titre de la quatrième partie « Ne t’éloigne pas, mon ombre fragile te suit » (p. 85) et la répétition de la formule « Ne te retourne pas » (p. 93, 94, 123, 124). On pourrait lire aussi une présence en sous-œuvre des mythes de la métamorphose (Ovide) : « Le corbeau (…) Est-ce toi perché ? » (p.97). Même si parfois le « je » joue avec l’idée d’un « leurre » de la mort (« Nous sommes arrivés (ton trépas n’est qu’un leurre ) », p. 58), cherche à l’« oublier » (« J’ai oublié que tu meurs, j’ai oublié / que ta langue de signes / ne saurait percer le jour », p. 59) ou voudrait que tout ne soit qu’un « rêve » ( « Je t’embrasse, j’ai perdu / la réalité, elle file sur les rêves », p. 58), c’est « l’éloignement » qui s’impose à la fin, sans recours ni retour, dans une esquisse du mythe de la barque funéraire antique : « Je fais des doigts une barque, / tu es le fleuve qui s’éloigne » (p. 124).
Face à l’absence irréductible du père, que peut le « je » sinon « écrire » sans répit : « Ici j’écris » (p.123) ? La poète imagine parfois, dans un semi-songe, que le père signe les poèmes : « Tu signes chaque page au lieu vivant du poème. / Je l’écris pour toi, il existe » (p.28). L’écriture se décline de plusieurs façons, tout d’abord sous la forme du verbe « souffler » qui rythme le livre : du titre répété (« Je souffle, et rien ») aux formules scandées « je souffle » (p.18, 33, 50, 68), où « je souffle » (p.68) peut être couplé avec « tu souffres » (p.67), selon un travail déjà suggéré de l’écriture par couplages. Ecrire peut prendre aussi la forme répétée du verbe chanter (« je chante j’emporte / les mots vivants qui tremblent / à la surface du poème » (p. 23), qui, dans l’ascendant progressif de la dissonance, risque de se retourner en « je chante-faux » (p.75), voire en « je crie » (« je crie, je secoue les voyelles / de ton nom ressuscité », p. 82). Le mutisme hante la poète : « Les consonnes trébuchent sous ma langue muette » (p.104). Mais elle se ressaisit toujours, jusque dans le poème terminal, où elle semble trinquer avec le mort : « Alors fière je lève ce verre vide : / le coquelicot joindra sa parure au vent » (p. 127). La beauté de ce livre-tombeau tient aussi à ce qu’il parvient à être léger, parfois presque aérien, comme en apesanteur, sous le signe de l’image séminale du « coquelicot » et d’une langue respirée.
Que garde-t-on en soi de ce livre sinon surtout son « énigme », accrue par la magie mate et rêche des peintures de Fabrice Rebeyrolle, qui elles aussi étreignent ce que Rimbaud appellerait la « réalité rugueuse » : « L’ombre (…) se dissipe et scelle / l’énigme » (p.23) ? Le livre entier, poèmes et peintures, ressemble à cette « lapidaire encoche / dans le calcaire » (p.92) de la falaise d’enfance. La force d’énigme est décuplée par le travail d’une écriture elliptique (au sens étymologique de ce mot : « elleipsis », le « manque »), signe distinctif d’Isabelle Lévesque. Les blancs typographiques et les césures accroissent encore parfois l’énigme de vers laconiques et inachevés : « Il semble que tu — » (p.91) … « toi tu / » (p. 99) … « Tu murmures (dans ma tête tu ) » (p.126). Dans ses méandres, le livre est comme cette île sur la Seine : « La Seine abrite une île (un mystère) » (p.127). Le verbe « souffler », du titre à ses nombreuses reprises incantatoires, est l’incarnation verbale de ce « mystère » auquel est confrontée l’écriture dans son face-à-face avec le secret et la mort, qui s’ouvre sur le « rien » : « Alors je souffle / deux doigts de mystère, / une lettre nue, fragile et grave » (p. 18) … Je souffle, et rien. Reste au lecteur à recueillir de ses mains ce « souffle » « fragile » et ce « rien », qui scintillent dans l’intervalle entre les mots.
Présentation de l’auteur
- Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien - 29 août 2022
- Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien, - 19 juin 2022
- Florence Saint-Roch, Rouge peau rouge - 20 février 2022
- Pierre Dhainaut, État présent du peut-être - 5 mai 2018