À propos de lecture poétique certaine – celle qui consiste à s’emparer du recueil d’un autre, et non pour son auteur, à réciter le sien –, il y aurait ce critère : ce qu’il en reste après. J’entends par là une mémoire vive de cette lecture, son empreinte insistante et ressentie, sa représentation dynamique et imagée, sa relance idéelle, toutes marques maintenant comme incrustées, contrastant – par leur nouveauté ou leur caractère d’inouï – avec ce qui est su, entendu ou vu déjà, imposant une sorte d’« ailleurs », de déplacement, de dépaysement qui fascine, résiste ou se partage.
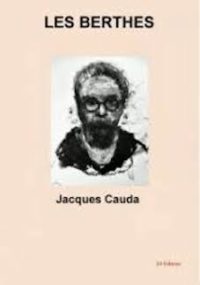
Jacques CAUDA, Les Berthes, 90 p, Z4 Editions, Paris, 2018
Il faut bien sûr que ce dont on parle ici s’impose par une présence identifiée ou les signes promus à sa suite – figures, visions, enchaînements, pensées inédites ou de flamme. Le même effet serait absent si ne persistait au-delà de la « forme » – car celle d’un genre littéraire ne suffirait pas – un improbable dans la langue, un traitement d’elle capable d’une pénétration – celle qui fait parvenir, rejoindre, accéder – avec ou sans la dite Beauté – à un cela même en nous et comme à notre insu. Là serait l’essence à saisir et retenir des vrais poèmes, œuvres avant tout de l’esprit. Hegel le pensait, qui plaçait la poésie au faîte des réalisations de l’Art, pour la raison de ses pouvoirs intimes.
Ce recueil de Jacques Cauda, approcherait d’une telle gageure. On sortirait de là, désorienté, surpris, mal à l’aise et comme à la fin, soulagé de l’épreuve, d’une compagnie pesante, désespérée, inavouable et mystérieuse, à force d’une idiosyncrasie codée, de provocations nostalgiques, d’objurgation à des présences ou des ombres, de défis déjà perdus contre le réel, la destinée, le temps et la Mort. Quatre parties composent l’ensemble, allant de lieux investis, souvenus, à ceux de personnes présentées comme chères ou moins. On y trouvera des strophes brèves ressemblant à des haïkus, de plus longues en forme d’élégies, mais on ne sortira pas indemnes– comme dans notre hypothèse – de la troisième, intitulée : Supplément d’âmes.…
Il s’agit alors de la mort, parfaitement interpellée, visitée, scrutée, fouillée en terre ou déterrée, avec ses hôtes grouillants ou volatils qui lui tiennent compagnie, ne l’acceptent pas, s’en repaissent, la décomposent. Le corps, lui, toujours là, offert et consommé, n’en peut mais et d’une main décharnée, vous agrippe. Serait-il alors ré-invité par le peintre, qui aurait renoncé bien sûr aux anges, et pour conclure, convoquerait à cette noce des fins, son modèle nu, prétexte à un autre abandonné, terrifié, jouissant, empli de questions muettes ? Loin de Dante qui juge, dialogue avec eux ou apostrophe les morts, d’un Baudelaire qui imagine la camarde et ne s’en remet, Cauda avance en elle, toute en chair, os et vermine. Du lieu du verbe crucifié à une renaissance, de la toile au supplice de sa couleur, de l’obscène ameuté à sa représentation prise à témoin !
Va près des faces
Frémir d’un grand frémissement
Quand la mer se regarde va…
Comment alors – vivant encore – sortir sauf du voyage ? Le poète gagnerait une place à ce critère de la lecture troublante qui dérange et voudrait – dans le même temps – faire voir le jamais vu, l’in-entendu ou le laissé jusque là, pour compte. Avant que l’œil – prédateur à sa manière, la main qui trace – ou se saisit des mots, n’essayent ici de faire « rendre l’âme » à l’âme. Une si belle expression.


