JEAN-FRANÇOIS MATHÉ
Bonjour Jean-François Mathé. Merci d'accepter cet entretien pour Recours au Poème. J'aimerais débuter cette conversation en évoquant Claude Michel Cluny, qui vient malheureusement de nous quitter. Dans Le Monde du 16 janvier 2015, Josyane Savigneau lui rend hommage par ces mots : "Claude Michel Cluny voyait en la poésie "un pouvoir d'appel, de résistance, de vérité", tout en déplorant qu'il n'y ait "peut-être pas de pays au monde où la poésie soit plus refusée que la France".
Vous qui étiez ami avec Claude Michel Cluny, partagez-vous le même constat distinguant si désavantageusement la France ?
A priori, on ne peut que donner raison à Claude Michel Cluny : le grand voyageur qu’il était n’a d’évidence émis cette opinion qu’en conclusion des comparaisons qu’il a pu faire entre le sort de la poésie en France et celui qu’on lui réserve ailleurs. Et d’autres que lui ont souligné la « popularité » de la poésie par exemple au Canada, en Amérique latine, en Europe centrale et de l’est, dans nombre de pays latins… Pour aller dans son sens, je peux au moins constater le peu de visibilité de la poésie aussi bien dans les médias (presses audiovisuelle et papier confondues) que dans les bibliothèques et les librairies où, si elle n’est pas complètement absente, la poésie est en retrait, en recoins, très rarement mêlée sur les tables à la littérature générale et essentiellement romanesque. On peut ajouter l’abandon de collections de ce genre littéraire par de nombreux « grands » éditeurs. Ces faits sont suffisamment connus pour qu’on ne s’y attarde pas trop. Mais les causes sont-elles à chercher dans un système économique de plus en plus orienté vers la rentabilité immédiate, ou – plus grave – dans l’absence de demande derrière laquelle se retranchent quasi systématiquement les institutions citées ci-dessus ?
C’est sur ce point que je nuancerais l’avis de Claude Michel Cluny et serais moins pessimiste que lui. Il m’a toujours semblé que si le « public » n’allait pas vers la poésie, une minorité quantitativement et surtout qualitativement non négligeable acceptait fort bien que la poésie vienne à elle, et s’en réjouisse. Pour prendre un exemple concret et personnel, le professeur de Lettres en lycée que j’ai été s’est bien gardé de cantonner la poésie dans son rôle de support favori du commentaire de texte. J’ai toujours suivi le conseil d’Yves Bonnefoy qui disait en substance qu’il fallait préférer la « monstration » à la « démonstration ». Aussi, pendant des années, ai-je apporté en classe des recueils, des revues de poésie ancienne et contemporaine en demandant aux élèves de les feuilleter et d’y choisir des poèmes qu’ils recopieraient en une sorte d’anthologie. Les seules contraintes : bien encadrer chaque poème des références qui leur permettraient d’en retrouver l’auteur, le titre du recueil, l’époque de parution et d’en envisager une mise en voix. Ne justifiaient leur choix que ceux qui le désiraient et je me bornais à circuler dans la classe pour lire par-dessus leur épaule les poèmes qu’ils recopiaient. Je n’ai jamais essuyé de refus, au contraire les élèves m’ont souvent demandé le renouvellement de l’expérience pour qu’ils puissent s’échanger des recueils et conseiller à d’autres des poèmes. J’ai toujours pu constater que ces jeunes gens apparemment indifférents à la poésie méditaient leur choix, avaient bon goût et ressentaient, même en l’exprimant maladroitement, la nécessité de cette écriture touchante, troublante.
Par ailleurs, de nombreux poètes, lors de lectures publiques, sont frappés par la qualité d’attention de leur auditoire et par la qualité et la profondeur inattendue de certaines discussions qui s’ensuivent. Implacable comme il pouvait l’être, Claude Michel Cluny ferait remarquer que ces publics sont bien maigres et que l’écoute ponctuelle de poèmes ne se prolonge pas obligatoirement en une passion durable pour la lecture personnelle de la poésie. Et il maintiendrait sa position. Mais je ne dirais pas comme lui que la poésie en France est « refusée ». Elle est moins refusée qu’ignorée, ce qui laisse à ceux qui agissent pour elle (éditeurs, revuistes et poètes) des ouvertures vers sa mise en rapport avec les gens, fussent-ils français !
Et quant à la dimension "d'appel, de résistance, de vérité", partagez-vous ces mots du poète Cluny ?
De ces trois mots qui déclinent « le pouvoir de la poésie », c’est le premier qui résonne le plus en moi : oui, la poésie est un appel, non pas venu de quelque puissance supérieure que ce soit, mais d’abord du désir même de la poésie : le besoin d’écrire ou de lire un poème est le premier signe d’une invitation à sortir de nous-mêmes, de ce que le temps ordinaire, l’habitude, les indifférences ont rétréci, étriqué, voilé en nous. Et nous ressentons dans le désir de la poésie le désir de nous agrandir en intelligence et sensibilité, le désir de donner à notre rapport au monde sa vraie nature en nous comprenant autrement et en comprenant aussi le monde autrement par l’accès à ses dimensions cachées (ce que René Rougerie appelait les « Réalités secrètes » et dont il fit le titre de la revue qu’il anima avec Marcel Béalu dans les années 1950/60). Cet appel n’est pas un appel de prise de pouvoir sur le monde, mais d’inscription en lui et en ses profondeurs mystérieuses, devinées, rendues presque accessibles par le pouvoir des mots, des images. C’est un appel à mieux rencontrer l’âme de la nature, de l’humanité, à les interroger, ou à les remercier d’être là pour donner sens à notre existence.
Et c’est peut-être à ce stade que nous sommes dans la vérité de la vie, encore incomplète, encore à explorer quand, sous des formes parfois différentes, inattendues, la poésie appellera de nouveau.
Quant au mot « résistance » il s’associe pour moi tout naturellement au mot poésie, et cela découle de ce que j’ai écrit précédemment : à partir du moment où l’on estime que le poème exprime les états les plus complexes de l’intériorité humaine, se le fixe comme but, il est un acte (peut-être modeste, mais mieux vaut être modeste que n’être rien) de résistance contre tous les systèmes politiques, idéologiques, économiques… qui veulent abaisser et simplifier l’homme pour l’instrumentaliser. Les emblématiques 33 sonnets composés au secret de Jean Cassou, composés de tête durant sa détention en prison au début de la guerre pour faits de résistance, sont la preuve que l’appel de la poésie maintient la dignité et l’espérance.
Pour synthétiser un peu cette réponse, j’aimerais citer ces quelques vers de Maria Luisa Spaziani, récemment disparue :
Cette nuit la bronchite me transforme
en chêne ployant sous la neige […]
J’ai un jour connu un garçon, beaucoup
plus malade que moi.
Il respirait à grand-peine, il était
dans son lit un voilier ensablé,
mais en haut sa pensée chantait comme un loriot
à la cime de l’orme foudroyé.[…]
(Extrait de « Chemin de croix », in Jardin d’été Palais d’hiver, Mercure de France 1994)
Vous avez écrit 16 livres de poésie, publiés quasi exclusivement par les éditions Rougerie, entre 1971 et 2015. Comment voyez-vous votre propre parcours en poésie, et que vous a appris le poème ?
Oui, 16 livres, et même 17 au moment où j’écris avec la parution aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune d’un petit recueil de poésie-jeunesse intitulé Grains de fables de mon sablier. Une fidélité à la même maison d’édition qui s’explique par le fait qu’il y a belle lurette que les relations d’auteur à éditeur se sont transformées en relations d’ami à ami(s) avec René et Olivier d’abord, avec Olivier seul désormais.
Il m’est assez difficile de définir un « parcours en poésie » n’étant pas sûr d’avoir parcouru autre chose que ma vie avec la poésie mêlée à elle en une sorte de journal d’états d’être successifs qui se prêtent mal à une vision synthétique.
Pour ne pas fuir la question, je dirais que mes premiers poèmes étaient un peu « des chiens fous » qui devaient encore à l’esprit d’adolescence et à l’influence du Surréalisme : l’écriture n’y craignait pas l’emportement, voire l’imprécation et un abus du « stupéfiant image ». Il y avait de tout cela dans le premier recueil que René Rougerie a publié et il en est resté (de moins en moins) dans plusieurs des livres suivants. Mais à côté de ces poèmes agités, la présence de poèmes disons plus calmes, à l’écriture plus posée avait été remarquée par mon éditeur et il me les indiqua en suggérant que, si je continuais d’écrire, c’est en eux qu’il fallait que je puise ce qui deviendrait peut-être ma voix. J’ai retenu ce conseil avisé et, progressivement je suis allé vers des tonalités plus sourdes et vers ce que certains commentateurs appellent « ma voix basse ». Donc une évolution s’est faite vers plus de simplicité (sans renier mon goût pour l’image), plus de naturel (j’ai beaucoup lu Léautaud) et plus de creusement de l’intériorité. L’influence du Surréalisme s’est estompée, peu à peu remplacée par celle de Supervielle, Guillevic, Schehadé, Jaccottet ou Cluny, et aussi celle de poètes étrangers tels que Ungaretti, Ritsos, Paz, De Andrade ou Skacel.
Depuis l’âge de 30 ans, je ne me suis plus départi de ce choix d’une simplicité d’écriture qui vise, (qui tente l’accès à) la profondeur. De plus les thèmes qui ont peu à peu envahi mes poèmes (l’inquiétude, le souci de l’interrogation du sens de la vie, la conscience de la fragilité, l’œuvre du temps, etc.) ont comme nécessité le maintien d’une écriture assez transparente pour les faire affleurer, les suggérer plus que les imposer. Du coup, je suis entré en discrétion ce qui m’assimile, pour beaucoup de mes lecteurs, aux Classiques : puisque cet entretien a commencé sous la protection de Cluny, voici une de ses expressions, dans la dernière lettre que j’ai reçue de lui, à propos des poèmes de La vie atteinte : « Votre poésie m’a toujours retenu, et les pages de La vie atteinte, dans leur clarté, à peine touchée d’ombre, car votre pudeur classique est sans faille, lui ajoutent l’imperceptible frémissement du temps qui s’éloigne… » Voilà le point où j’en suis : une poésie « claire », à deux doigts du silence et qui se donne la liberté d’être écrite dans des formes différentes : vers libre (surtout), prose (abandonnée dans les deux derniers livres), vers rimés. Pour terminer ce regard sur un « parcours », je tiens à préciser qu’en écrivant mes poèmes j’ai toujours eu le souci de leur oralisation, de leur mise en voix. D’où mon goût pour une certaine fluidité voire une certaine musicalité.
Quant à ce que le poème a pu m’apprendre ou m’apporter avec ce qu’il garde toujours d’énigmatique même pour celui qui l’a écrit, je n’oserai dire un supplément de vie, même s’il m’arrive de le penser. Il a au moins donné à ma vision de la vie des couleurs insoupçonnées, pas toujours vives ni gaies et une autre façon de traverser le temps qui m’est imparti, en le dilatant dans la méditation et dans des émotions créées et non offertes ou imposées.
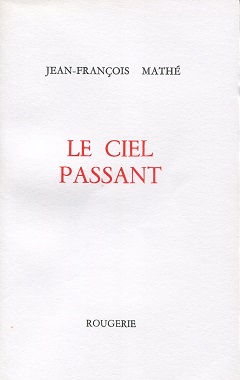
Rentrons maintenant, après ces vues générales, dans le cœur de vos poèmes. Vous ouvrez votre recueil Le ciel passant par un poème sublime et polysémique :
le ciel passant
nous lui avons confié
le vol maladroit de la mémoire
ses ailes à retremper
dans des bleus d'autrefois
et la tête vide
en attendant que tout revienne
nous avons accepté
les pierres du chemin
et la douleur d'un premier pas
à côté du soulier
marcheurs danseurs
avaleurs des sabres du souffle
nous avançons pour ouvrir
le temps terrible qui nous tient
Ce "temps terrible", je le vois plutôt comme le temps d'aujourd'hui plutôt que celui de la condition humaine. Le poète aurait la vocation prestidigitatrice - "avaleurs des sabres du souffle" - par la magie du Verbe, de conjurer réellement la fermeture de ce "temps terrible" ?
Pour moi, ce « temps terrible », au moment où j’ai écrit ce poème et aujourd’hui encore où vous me le donnez à relire, est celui de la condition humaine. Avec le moins de mots possible, ce poème m’apparaît rétrospectivement comme une sorte de narration métaphorique de l’entrée dans le vieillissement, le bleu du ciel renvoyant à la jeunesse que l’on quitte tout en essayant de rester en rapport avec elle par la mémoire, et le « premier pas / à côté du soulier » marque le début de l’épreuve du vieillissement (chemin pierreux s’il en est !). Mais l’avancée dans cette nouvelle période de la vie est loin d’être un consentement, un renoncement à la beauté de la vie, ce dont témoigne le mot « danseurs » : il y a, dans l’ultime cheminement, de la fête et de la lutte, au moins de la révolte : « nous avançons pour ouvrir / le temps terrible qui nous tient ». Quant aux « avaleurs des sabres du souffle » ils sont moins des magiciens (qu’ils voudraient bien être) que des êtres en souffrance comme le suggère le mot « sabres » qui infléchit le souffle vers des connotations douloureuses. Et quant à ouvrir le temps, en desserrer l’étau, je ne peux que renvoyer à la fin de ma réponse précédente : on ne le fait incomplètement et provisoirement que par la poésie en le dilatant dans la méditation et dans des émotions créées.
Mais comme vous le dites, Gwen, le poème est polysémique et voir ce « temps terrible » comme celui d’aujourd’hui n’est pas un contresens. Je dirais même que votre lecture confère à l’adjectif « terrible » encore plus de force : si le temps nous pousse naturellement sur un chemin pierreux, l’époque actuelle par son déni de la profondeur de l’être humain en rend les pierres encore plus coupantes, blessantes. Mais dans ce poème-ci, il n’y a aucune perspective de conjuration par la magie du verbe. Il faut attendre le recueil La vie atteinte pour trouver des poèmes moins pessimistes qui redonnent saveur, ouverture et force à la vie. Où « de l’autre côté du poème […] » on retrouve « l’immensité […] dans ces yeux qui s’ouvrent / et me mettent au monde / malgré ma vie déjà vécue. »
Nous sommes là au cœur du mystère de la composition du poème. Des intentions vous ont conduites, "avec le moins de mots possibles", peut-être par souci d'épure, peut-être par volonté de ne pas fermer l'interprétation du poème, peut-être par esprit de mesure. La lecture que j'en fais s'écarte de vos intentions premières, car le temps passe, la charge des mots se modifie, et mon œil possède sa propre histoire. Le poète peut-il alors se réclamer d'une interprétation, lui qui est, visiblement, un outil au service du poème, inconscient de la portée sémantique définitive de ce qu'il a composé ? Autrement dit, le poète pourrait revêtir le manteau de « la conjuration par la magie du verbe », sans même le vouloir ?
Cher Gwen, j’apprécie que votre question commence par la formule fondamentale « mystère de la composition du poème ». Elle est fondamentale dans la mesure où il y a bien mystère dans l’élaboration d’un poème et ce mystère persiste même dans le poème achevé. Et heureusement. Non pas que ce mystère doive complètement fermer le texte à la moindre chance de compréhension par l’intelligence et la sensibilité, mais il est la trace de la liberté, de la polysémie imprévue que portent les mots quand nous les écrivons. Sans cette part irréductible d’énigme, de polysémie du sens, le poème ne serait que l’illustration rhétorique, didactique d’une pensée préméditée. Si ce que je dis de ce poème, dans la réponse précédente, paraît autoritaire, tranché, je le regrette, car rien de tel n’a présidé à son écriture : c’est le poème lui-même qui m’a embarqué sans rames dans son esquif, après que je lui eus donné ses premiers mots, eux-mêmes plus surgis que préparés. Qu’une intention ait présidé à l’écriture de ce poème (ici mon obsession du temps qui passe, en écho au titre du recueil : Le ciel passant) c’est incontestable. Mais la suite, comme toujours, m’a en grande partie échappé : j’ai rencontré des mots, des rapprochements qui se sont invités dans le déroulement du thème. Et ce que l’ensemble a donné, une fois le poème achevé, m’a comme d’habitude surpris moi-même. L’inconscient avait joué son rôle avec ses lois propres. Je me retrouvais face à un « objet » qui ne trahissait pas le thème initial mais l’avait parcouru en moi et hors de moi. Alors, vous avez raison de dire que le poète est le plus souvent « inconscient de la totalité sémantique de ce qu’il a composé. » Un poème suggère, propose mais n’impose rien. Dès lors, le poète n’a pas à donner « une interprétation stricte. » Dans un texte intitulé Poésie parlote, Jacques Réda répondait ainsi à un organisateur de conférences qui l’invitait à éclairer sa poésie: « Puisque vous insistez, à défaut d’un de ces coups de phare dont vous demandez aux poètes d’aller scruter les profondeurs de leur création, le plus simple pour moi serait de vous envoyer maintenant et sans autre commentaire quelques poèmes. Car je suis d’un tempérament un peu obscurantiste, c’est-à-dire méfiant devant les prétentions à éclairer ce qui me paraît lumineux. » En accord avec Réda, je dirais que c’est paradoxalement par l’aspect surprenant qu’a pris le poème au cours de son écriture, qu’il paraît, in fine, lumineux. Mais explique-t-on ce type de lumière et doit-on refuser aux lecteurs d’en être éclairés différemment ? Evidemment non. D’ailleurs, vous dites fort justement que « (votre) œil possède sa propre histoire. » Alors pourrais-je, sans même le vouloir, conjurer ce temps terrible « par la magie du verbe » ? A cette question je répondrai par une autre : « Pourquoi pas ? » Je crois à la magie, ou plutôt pour moi à la force du verbe et surtout à la vérité que le verbe poétique propage et qui peut s’immiscer dans le tissu de mensonges de la parole actuellement apparemment dominante pour le trouer, le brûler à petit feu. Peut-être n’est-ce pas le poème qui nous occupe qui le fait à lui seul, mais l’ensemble de ceux que j’écris, surtout quand ils font bloc avec les autres paroles magiques, fortes et vraies d’autres poètes comme celles réunies dans L’Anthologie de la poésie des profondeurs que vous avez constituée avec Matthieu Baumier.
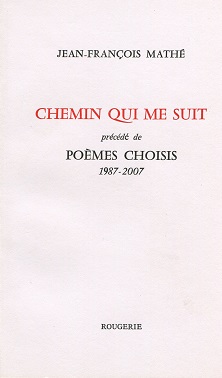
En 2007 parait aux éditions Rougerie une anthologie de vos poèmes, Chemin qui me suit, précédé de Poèmes choisis, 1987-2007. Vous y faites, en introduction, le point sur ce choix de poèmes, comme un homme fait le point sur sa vie. Nous pouvons y lire, par exemple, ce superbe poème :
un jour tu regarderas
se replier dans ta main
cette feuille
que tu prenais pour ma main
elle aura eu printemps été automne
mais jamais l'arbre
où tenir plus fort qu'à toi
Les poèmes marquent-ils la cadence, comme cardiaque ou métronomique, ou comme des amers, semés dans la navigation de votre existence ?
A ce jour, je distinguerais deux périodes dans ma vie : la première, la plus longue, disons des années 1980 aux années 2000, où je pourrais dire que le poème rythmait ma vie avec régularité. Les périodes de travail et celles de vacance(s) consacrée(s) à la poésie alternaient harmonieusement. Je savais que dans le silence des périodes de non écriture se préparaient les poèmes qui, en effet, arrivaient en leur temps, comme des trains à l’heure. Les moments d’écriture du poème étaient à la fois une mise à jour de ce qui avait d’abord, pendant quelques mois, seulement balbutié intérieurement et une relance de la vie, comme une marche reprise après avoir bu à une source. Et je sortais de la période d’écriture comme renforcé et si j’ose dire « éclairé » sur mon rapport au monde. Puis vers 2000, ce rythme bien cadencé s’est rompu et je suis resté plusieurs années sans écrire de poèmes et même sans en lire beaucoup (et pour dire vrai sans en souffrir).
Quand le désir du poème a ressurgi (vers 2005 ?) j’en ai été surpris et heureux. Mais dès lors il n’y eut plus de cadence métronomique, mais des à-coups, des surgissements imprévisibles du besoin d’écrire. Intuitivement, je compris que j’écrivais dans la deuxième optique qui termine votre question : c’est-à-dire pour laisser trace de moments d’existence soulevés du temps ordinaire par le poème. Connaître le pourquoi de ces états de fait m’indiffère : que le poème passe par moi ou pas, avec régularité ou pas n’a jamais remis en question ma certitude de la nécessité de la poésie. Cœur régulier ou arythmique, le poème a néanmoins ajouté à ceux de mon cœur des battements précieux.

Le dernier livre que vous avez publié, et dont nous avons rendu compte dans Recours au Poème est La vie atteinte. Nous aurions pu, chacun d'entre nous, ne pas atteindre la vie. Mais par notre naissance, nous avons atteint ses rives. René Char, dans un vers célèbre de son poème Commune présence, parle au jeune poète : "tu es pressé d'écrire/comme si tu étais en retard sur la vie". Et cette impression, effectivement, semble commune : être conscient que nous sommes en vie, mais souffrir de ne pas être absolument dans la vie, que la vie nous devance, que l'on n’arrive pas à la rattraper ou à l'épouser, à faire un avec elle. Votre livre, par son titre, semble proposer un autre angle de vue.
Cependant, dans cette vie, puisqu'atteinte, à quoi sert donc le poème, dont vous certifiez de la nécessité ?
La vie atteinte est un titre qui s’est imposé à moi par sa polysémie, polysémie soulignée dans l’épigraphe empruntée à un poème d’Anne Perrier : « Vivre est une royauté fragile ». Bien entendu, comme vous le dites, on atteint déjà la vie en naissant. Mais pas la conscience de ce qu’est la vie. Cette conscience s’acquiert au fil du temps (et Cluny, pour en revenir à lui, considérait même que la vraie naissance à la vie était l’adolescence). Les premières connotations de ce titre renvoient donc à la conscience de la vie acquise à un âge où les découvertes, les rencontres, les expériences, les épreuves… ont jeté sur elle quelques lumières. Pour moi, s’il y a une « royauté » dans la vie d’un homme âgé, c’est celle qui nous fait maître d’un domaine redoutable : la lucidité. Cette lucidité qui selon la célèbre et superbe formule de René Char « est la blessure la plus rapprochée du soleil. » Dès lors, le poème, dans cette acception du titre, est l’outil idéal pour creuser cette lucidité, l’approfondir pour mieux l’éprouver et lui faire mettre en relief ce qu’elle révèle. Outil idéal dans la mesure où l’écriture poétique ajoute et mêle au regard conscient sur le monde et soi le droit de regard de l’inconscient qui construit aussi notre rapport à l’existence.
L’autre connotation de ce titre, qui se retrouve dans l’adjectif « fragile » employé par Anne Perrier, renvoie à une interprétation « douloureuse » de mon adjectif « atteinte ». Il s’agit alors des blessures de tout ordre qui marquent une vie et s’ajoutent les unes aux autres. Le poème est alors le réceptacle de ces blessures : les mots vont vers elles et tentent de les restituer au plus vif dans la vibration, l’intensité de la langue poétique qui oblige le langage usuel à aller au-delà de ses insuffisantes capacités à dire les vérités. La vie atteinte n’est pas la mise au repos, au silence, de la poésie. Au contraire, elle a besoin d’elle pour peser gains et pertes et leur pourquoi. J’ajouterai même, qu’à ce moment de l’existence, le poème ajoute au titre que j’ai élu le point d’interrogation par lequel je ne l’ai pas terminé : une vie est-elle jamais atteinte ? C’est pourquoi, certainement, la dernière partir du livre s’intitule Avant la suite. Autrement dit, le poème demeure nécessaire, aussi bien pour sonder ce qui nous a faits ce que nous sommes que pour révéler et aborder les incertitudes et les émotions que nul bilan ne peut prétendre avoir englobées. La vie atteinte reste mystérieuse dans son passé que le poème, dans le même temps, recueille et interroge, et tout autant dans son présent et son avenir. On pourrait orienter en ce sens l’expression « poésie ininterrompue » d’Eluard et dire qu’on n’en a jamais fini avec le poème tant qu’on n’en a pas fini avec la vie par la mort biologique.
Dans cette époque de grands bouleversements, de grande mutation, où la poésie est tant ignorée, voire rejetée par l'essence du système capitaliste, et semble faire si peu partie de la vie et des préoccupations des individus, pensez-vous que la poésie puisse être bénéfique "aux citoyens", et de quelle façons ?
Question difficile ! J’ai toujours pensé que la poésie s’adressait à l’homme dans son intimité, dans son individualité, intimité et individualité étant à mes yeux les meilleurs réceptacles de ce « langage dans le langage », polysémique, ambigu qui ne peut cheminer que dans des sensibilités particulières qui l’épouseront, chacune à sa manière. Cela suppose une solitude, voire un retrait en soi, alors que l’homme-citoyen, qu’il le veuille ou non est plutôt en avant, tourné vers l’extérieur, systèmes, événements collectifs et autres hommes en général. Alors à cet homme plus extériorisé, plus collectif qu’individuel, qu’est-ce que la poésie peut apporter, surtout de « bénéfique » ? Ce n’est pas une question que je me suis vraiment posée, mais je pense que la poésie peut au moins, dans sa vie sociale, ne pas lui faire oublier sa vie intérieure enrichie par la méditation, l’imaginaire, maintenir en lui cette individualité venue des profondeurs et qui empêche les systèmes agressifs de tous ordres de le laminer, le réduire à l’ectoplasme dont l’idéologie capitaliste a grand besoin. L’esprit, la spiritualité, la découverte émue de l’humanité comme de la nature, insufflés, entre autres, par la poésie ne sont pas choses faciles à formater.
Et puis, si l’on met le mot citoyen au pluriel, on peut alors songer à ces poésies à voix fortes qui s’adressent à des peuples entiers pour leur restituer leur Histoire, leurs valeurs, les inciter aux légitimes aspirations et aux révoltes qui en résultent au nom de la liberté, de la justice, de la reconnaissance : Césaire ou Senghor ont fait beaucoup pour la « négritude » et donc pour chacun des citoyens qui la composent, de même Darwich en Palestine ou Amichaï en Israël. Il y eut de cela aussi au XIXe siècle romantique avec la poésie de Hugo pour ne prendre qu’un exemple emblématique, aussi, plus récemment, dans la poésie de la Résistance. Est-ce qu’aujourd’hui dans le faux confort et la fausse facilité (qui encouragent tant de passivité) on peut espérer le retour de ces voix fortes ? Il faudrait qu’avant cette poésie revienne l’Histoire, mais il paraît que nous sommes dans la post-Histoire… Alors, à défaut de soulèvements, espérons qu’au moins la poésie telle que je l’évoquais au début de la réponse, préserve chez les « citoyens » une âme et une volonté de résistance, une manière de vivre où chacun regarderait l’autre en tenant compte de sa profondeur complexe, de sa dignité, conditions pour que l’être prime sur l’avoir, le vrai sur le spectaculaire, l’amour du monde sur son exploitation marchande. Peut-être, pour détruire la débile post-Histoire avons-nous à inventer une nouvelle pré-Histoire où la citoyenneté serait un art de vivre ensemble. Après tout, les utopies ne sont pas faites pour les chiens. Malheureusement les contre-utopies non plus…
Dernière question, cher Jean-François : y a-t-il un poème, ou des poèmes, qui sont pour vous des compagnons, des poèmes connus par coeur, et qui vous accompagnent et vous soutiennent dans les moments cruciaux de votre vie ?
Des poèmes qui m’accompagnent, et me soutiennent dans différents moments de ma vie, il y en a d’innombrables. Il serait fastidieux et il me serait même impossible de tous les citer.
Ils sont de toutes époques, aussi bien français qu’étrangers, mais je dois reconnaître qu’ils me reviennent surtout par bribes, par fragments : j’ai un peu perdu l’habitude d’en apprendre par cœur dans leur intégralité, mais à chaque fragment qui me revient je pars en quête du livre où je retrouve le poème complet et je le relis, souvent à voix haute. Pourtant, certains poèmes, tenaces, me sont restés intégralement en mémoire : en particulier deux de François Villon qui est, avec quelques autres, au sommet de mes admirations. L’un est la célèbre Epitaphe de Villon popularisée sous le titre « La ballade des pendus », l’autre, dans son Testament est le Rondeau qui commence par :
Mort, j’appelle de ta rigueur,
Qui m’a ma maîtresse ravie…
Deux chefs-d’œuvre puisés au plus profond du tourment humain, de l’épreuve de vivre et mourir.
Et dans le même registre, ce poème bref, daté de 1983, du poète allemand Rainer Kunze que je citerai in extenso :
Meurs avant moi, juste un peu
avant
afin que ce ne soit pas toi
qui aies à revenir seule
sur le chemin de la maison
Je dois tout de même préciser que je connais des poèmes par cœur, mais je ne les dis pas à haute voix… Je les chante en m’accompagnant à la guitare : les musiques qui les portent, qu’elles soient de Brassens, de Ferré, de Léonardi, de Ferrat et de bien d’autres, sont d’excellents supports pour la mémoire. Là, je retrouve Aragon, Luc Bérimont, Hugo, Lamartine, Paul Fort, Ronsard, Rutebeuf ou Genet… Les poèmes chantés ne font pas concurrence aux poèmes écrits et dits, ils les prolongent en leur donnant une autre couleur et souvent, une grande force de pénétration dans la sensibilité. Ils ont aussi l’avantage de les rattacher aux racines populaires de la chanson qui, pour moi, n’est nullement un art mineur.
Je rends grâce à la poésie, sous quelque forme que ce soit, d’avoir la force de nous hanter.
Merci, cher Jean-François Mathé, de nous avoir accordés temps et parole.