Jean-Louis Rambour, Pauvres de nous, Le Travail du monde
Un volume qui n’existe pas
Frères humains, qui après nous vivez,
N’ayez les cœurs contre nous endurcis,
Ah, on ne pend plus comme il y a six cents ans, au bon temps de Villon et de sa Ballade des Pendus, du moins, chez nous, ne pend-on plus au bout d’une corde (encore qu’au bout du rouleau on puisse ainsi en finir sans l’aide de personne) mais au bout d’une chaîne de travail ou de sa chienne de vie de laquelle on a été violemment décroché – on n’aurait pas fait l’effort de s’accrocher, dis donc, vil fœtus, on aurait milité pour ne pas être que de la viande à produire, on aurait lâché la Cordée de la Réussite, on aurait même manqué de Résilience, de ce « concept à la con » comme dirait le poète Philippe Blondeau (cet autre poète picard et ami), on aurait manqué de cette grâce de survie douteuse, curieusement dans le vent du bien-être universel et auto-suffisant, de cette menterie scandaleuse qui disculpe voire escamote le bourreau et taxe la victime d’inapte à la réussite, et tout cela en douceur, les bras en croix. On aurait failli, quoi.
On dit qu’il n’y a plus d’ouvriers, qu’ils ont été spectralisés, pardon, virtualisés, même plus « manœuvres », ou qu’ils se sont enrichis par ruissellement et même qu’ils seraient passés de communistes à fachos, avec un gilet jaune aux carrefours pour qu’on les voie mieux. Quelle impudence… On dit tellement de choses à tort et à travers qu’on ne sait plus qui dit quoi ni d’où il cause, qui voit qui ni d’où il voit. Il suffit pourtant de poser, comme le fait notre poète, son regard humain sur l’humain, dans le respect des formes, des formes poétiques pas tout à fait abandonnées à elles-mêmes, non pas résilientes, mais résistantes.
Jean-Louis Rambour est l’auteur d’une soixantaine de recueils poétiques, sans compter les ouvrages collectifs, les nouvelles, et cinq romans. Il nous écrit depuis un demi-siècle, une sacrée paye, gagnée – et c’est précieux – à l’huile essentielle de son front penseur, discrètement frondeur, perspicace, ironique - mais d’une ironie facétieuse qui jamais ne se départit de la tendresse, cette vertu (étrangère aux boursoufflures contemporaines) qui récuse toute violence et sait s’immiscer, avec l’empathie de l’innocent, au cœur de l’objet d’observation pour le mieux dresser sur ses pattes, le défendre et le revendiquer.
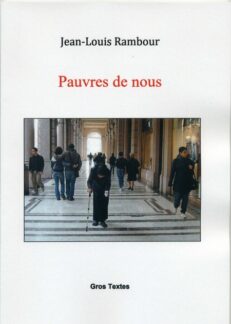
Jean-Louis RAMBOUR, Pauvres de nous, Gros Textes, 2020, Photographies de l’auteur, 75 p., 12 €.
Il est rare en écriture d’être incisif dans la souplesse et la minutie, sans s’émousser. Les deux ouvrages sortis coup sur coup en cette douloureuse année 2020 se penchent sur les laissés pour compte, qu’ils soient les gueux de la rue, dans Pauvres de nous ou les travailleurs exsangues dans Le travail du monde, deux livres qui accueillent en poésie ce qui ne vaut pas un kopek. Qu’on soit clair : nul pathos vendeur, nulle complaisance voyeuriste, nulle fantaisie distopiste ; non plus une poésie militante à sigle. Ecrire de la poésie n’est-ce déjà un acte de barricade contre la laideur d’un monde inféodé au profit ? N’est-ce déjà se viander dans ce qui n’a pas de prix ? N’est-ce verbaliser l’encore ineffable et l’inaliénable ? Jusqu’à quand ? Encore faut-il que poésie ne copule pas avec l’abscons, le moi débraillé, la néantitude métaphysique ou la poéréalité de gondole.
Ici, nous sommes en terre sobre, compacte, à grains serrés, à la limite d’un hyperréalisme toutefois subjectif, infléchi par une affection naturelle pour la déréliction. Qu’ont-ils d’intéressant (« être parmi ou entre » !) ces moins que rien, clodo, SDF, junkies, alcoolos, punks à chien, mendiants, clochards célestes ou encore ces ouvriers d’usine, chômeurs, déclassés, tourneurs, infirmières, apprenti tailleur, conducteur de pelle mécanique, mineurs, fileuses, grévistes ? Eh bien, ils sont « Pauvres de nous », des éclats de notre miroir en sursis, des fugitifs de notre paradigme branlant, des exemples de notre mémoire en devenir – c’est-à-dire en voie de disparition. Ecrire c’est aussi remembrer, dans l’urgence, rétablir des haies pour qu’y chantent à nouveau les espèces presque décimées, c’est se recueillir – pour les recueillir – sur les presque disparus, ceux dont le volume n’existe pas au regard de la société productiviste. Ceux qui ne sont rien et qui peut-être, comme chez les fourmis, sauveront le groupe exténué, font la fine fleur des poèmes de Rambour. Sous forme de quinzains libres dans Pauvres de nous, sous forme de dizains d’alexandrins non rimés (le gueux ne rime à rien qu’à lui-même) dans Le travail du monde.
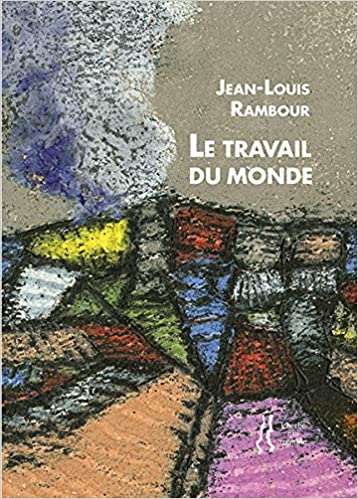
Jean-Louis Rambour, Le Travail du Monde, L’herbe qui tremble, 2020, Peintures de Jean Morette, 130 p., 15 €.
Le premier est assorti de clichés de l’auteur qui, loin d’être des images d’artiste, sont des saisies par surprise à partir desquelles décrypter la profondeur d’un être au monde, sur lesquelles poser un regard curieux et surpris car le poète effectue des écarts d’univers ou des cuts qui rompent l’horizon d’attente : si bien qu’on aimerait être / l’enfant accueilli dans cette poitrine de laine entre / le sourire du mouton et les zébrures du foulard ou C’est la seule marque / de respect qu’il peut s’offrir : ne pas laisser penser / à l’échoué que sa déchéance a été numérisée. Ici encore : retrouver le cri primal / qui vaut mieux que le silence gelé et minéral/ d’un coin qui exclut la belle révolution des astres. Et puis là : A genoux, dans le temps où / les mannequins des vitrines se déshabillent. C’est que ces images, bien que ou parce que brutes, sont propices à des incursions sociologiques, anthropologiques ou esthétiques. Elles sont le médium d’un regard par-delà les apparences, ainsi que des photomancies. Jean-Louis Rambour lit ses clichés et nous en délivre les mystères, à hauteur d’assis, de vautré ou de couché. On songe à ce film bouleversant Au bord du monde, de Claus Drexel, 2013, dans lequel le cameraman filme à hauteur des exclus, afin de leur restituer un volume, une densité qu’ils ont perdus. Les images deviennent des archives pour qui ne saurait ou n’aurait pas su regarder, des états irrécusables d’un monde fracturé. Malgré tout, l’observateur y va parfois de sa pointe d’humour noir, avec un lapin blanc, Charlie Chaplin, les bankomats qui rendent la vie des mendiants plus légère… parce que tous les signes avant-coureurs de la mort ne doivent pas s’étouffer sur eux-mêmes mais s’offrir la vacance d’une hésitation de l’âme, aux prises avec son absurdité.
Le second livre, Le travail du monde, de plus belle facture éditoriale, à notre avis, est scandé par des craies de Jean Morette, sombres, enfumées, granuleuses, aux géométries brouillées qui disent l’asphyxie du monde du travail. Tous les dizains d’alexandrins, ici, se terminent par une manière de chute qui brandit le poème tout entier comme un calicot de protestation : Ils sont les spectres munis d’un marteau sans faucille.Ou : On dirait de la chair priant les engrenages. La variété des domaines du labeur évoqués trahit une connaissance des métiers les plus pénibles. C’est que le poète n’est pas perché mais inclus dans la cité et sa mémoire qui fait irruption de la façon la plus inattendue parfois ne lui fait pas défaut : chemise à carreaux, béret, fléau à blé, Bardot, Belmondo, sherpas d’Annapurna, le tunnel sous la Manche, Mireille Mathieu, Ava Garner… Le poète insaisissable se permet des embardées d’images qui font de chaque poème un objet imprévisible. Il revisite le monde du travail pour en faire le Travail du monde car tous ces métiers travaillent le monde, le sculptent – il ne faudrait quand même pas l’oublier. On y laisse sa peau, à force, des lambeaux de pages blanches qu’il faut noircir.
Poésie prolétarienne ? A tout le moins une poétique du travail, sans effets de manche que ceux qui la font se retrousser pour une mise à l’ouvrage bien faite, si loin des clichés poéréalistes contemporains et vendeurs. En ces deux recueils qui se complètent, le lecteur, touché par l’exercice d’un verbe intime à son objet, entend la mort œuvrer au cœur de tous ceux que la société a « ratés » tout autant que dans les mécanismes du travail aliénant. La poésie ici s’engage sur la voie d’une rêverie exacte. Tout poème y est un acte politique puisqu’il entend soustraire son corps et celui dont il parle à toute forme d’emprise. La poésie comme salut, à saluer.
.
