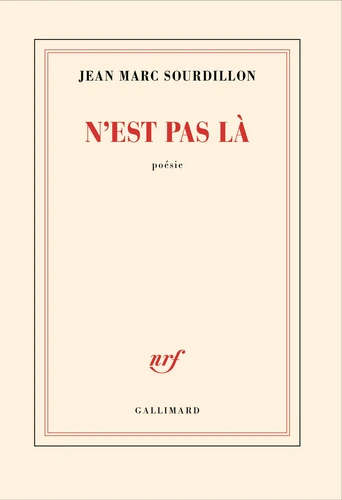Veiller la nuit, l’hiver, ce n’est pas veiller contre
elle, ni à cause d’elle
comme si elle était une ennemie. Ce n’est pas
endurer le temps obstrué, attendre l’aube
qui tarde à venir.
Veiller la nuit, c’est veiller sur elle, comprendre
que ce n’est pas moi qui souffre mais elle,
comme si elle, la grande nuit, elle était
petite et qu’elle avait la fièvre.
Comme s’il y avait dans sa part obscure mon
double au féminin,
et qu’il fallait que je l’accompagne dans sa
montée, présence qui souffre et qui attend,
et qui chante en montant même si on ne
l’entend pas, d’abord un ruisseau pris dans
de la glace, puis l’ombre déployée d’un arbre
sur de la neige et pour finir cette graminée
contre le ciel, crépitante de froid où je la
reconnais, la voie lactée, celle que j’aimais.
Comme s’il fallait, ce mouvement, oui, que je
l’accompagne, que j’en fasse le double au-
dedans de moi dans ma parole, pour que
quelque chose, ou bien quelqu’un, à travers
lui naisse et s’accomplisse,
quelque chose ou bien quelqu’un qui n’était pas,
de très humain, de très fragile,
presque invisible, un battement d’ailes ou bien de
cils, une hésitation dans le lointain, qui
scintille et qui fait que dans le chant quelque
chose se brise, est sur le point toujours de se
briser et finalement ne se brise pas.
Les Miens de personne, La Dame d’onze heures (2010)