Deux textes sont superposés : un texte à caractère culturel qui décrit une société archaïque se modernisant lentement, un autre sur les mots, l’écriture, les livres et leurs rôles dans les mains du narrateur. Par la lecture, l’homme acquiert « le savoir, la loi, la possession », monde à ordonner et ordonné. Le narrateur possède un don : maintenir les autres en vie, les guérir à condition de trouver le mot juste. L’écriture est une rébellion contre le temps qui passe et que l’on peut arrêter. Ecriture comme puissance sur le mot, comme devoir et révélation.
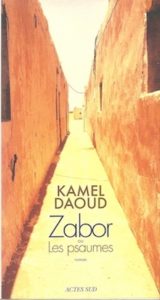
Kamel Daoud , Zabor ou les psaumes, Editions Actes Sud 21 euros.
Ecriture pour faire vivre, faire revivre, écriture comme marque d’éternité. « Les cendres d’un livre parlent toujours. C’est un livre à la gloire du livre.
Le narrateur est en opposition avec son milieu, en révolte, en colère. Il apparaît comme l’inverse du monde dont il est issu avec une identité autre, une culture déviante. Ce qui le sauve : le monde est un livre écrit ou à écrire « rien qu’avec des mots ». Ecrire, c’est éclairer, mettre de l’ordre, tracer une ligne, une voie/voix pour tenter une saisie du monde. Il y a dans ce roman, quelque chose de confus, de fragile, de subtil et de ténu : « des cendres à raviver », « tout étant futile et sans issue ». Le roman saute beaucoup d’une chose à l’autre comme un spectateur qui regarde la T.V.
La concentration de la pensée échappe : histoire s’imbriquant dans une autre. L’auteur a un faible pour les « digressions ». Elles assurent un tout, reviennent sur les mêmes événements tirés les uns des autres, elles éclairent progressivement le récit pour l’enrichir et le rendre plus présent à la compréhension.
Zabor : « qui va te croire quand tu parles en prophète », en poète ?
C’est toute l’histoire d’un village, d’une famille, des individus qui lentement ressort, c’est la partie sociologique à côté de la partie onirique : un don que possède Zabor qui n’est lié qu’à la mort ou la maladie. Il y a une superposition entre la page d’écriture et l’éloignement de la mort. Les faits semblent issus de la page et non l’inverse, c’est l’écriture qui influe sur le réel : « à la trente-neuvième page, il a presque bougé la tête ». « La langue est un couvercle sur le vide ». La linéarité du temps est brisée, le roman s’enroule autour de lui-même par cercles concentriques qui vont s’élargissant, augmentant la quantité d’informations. Il semble se libérer de la pesanteur, de son message vers une poésie ou tout au moins un appel à celle-ci. Le présent vécu et dévisagé nous laisse notre espérance, notre vie à accomplir jusqu’au bout, jusqu’au dernier espoir. L’apprentissage de l’écriture et des mots s’ouvre comme un monde de la proximité et de la vie directe. Monde « devenu souverain en multipliant les mots ». Le monde se perpétue par sa description.
« La langue parfaite et précise provoque la réponse du muet « Même la pierre y avait langue », découverte que le mot n’est pas la chose, qu’il y a une faille. Une chose est désignée par des mots différents dans d’autres langues. L’écriture s’infiltre dans le corps comme une présence et une matière qui se prolongent au-delà de la dernière page du livre.
« En attente de la langue parfaite, je ne pouvais vivre que dans le désordre ». C’est un retour à l’idée du chaos avant la mise en place d’un monde plus calme consigné dans de nombreux cahiers propices par l’écriture à décrire et comprendre le monde tout en permettant l’exercice du don. Vie muselée par les croyances et les coutumes, « comment pouvait-on arrêter un homme au nom de dieu ou d’un livre» C’est une révolte contre une culture ancestrale et stérile menée au moyen de la raison et de la liberté mais aussi de l’irrationnel par la présence d’un don peu compatible avec cette raison. Le narrateur reste attaché à sa culture dont il refuse certains aspects essentiels. « C’est une admirable rébellion » contre « le livre unique qui avait dévoyé les autres livres » qui appelle à la liberté de pensée et d’action, peut-être en relation avec la colonisation. A d’autres moments, le narrateur apparaît comme le Christ des chrétiens capable de « résurrection », le visage tourné désespéré vers le ciel. Il efface une culture et sans cesse la rappelle à lui. C’est un conte qui cherche l’impossible et l’improbable, qui aide à comprendre le monde pour tenter de l’améliorer. Pour ce faire, il vit à l’inverse des autres : « la nuit, je suis libre » et surtout seul, solitude imposée par sa différence avec les autres. N’est-ce pas le livre des apparences, surtout celles que l’on se donne ? Le monde moderne y est présent joint au monde passé. Il y tente un acte essentiel qui le guérit du monde : enterrer des cahiers la nuit car celle-ci affrontée devient lumière, présence et présence humaine dans sa volonté d’ordonner le chaos.
Tous les cahiers écrits sont un « rempart contre l’effacement. » Pour ce « Voyageur imaginaire », « L’ultime défit du don : faire aboutir la langue à son impossibilité ». « Une écriture dont émergerait une main tendue. » Ecriture comme moyen de se sauver et de sauver le monde contre l’absurdité, rendant sens jusqu’à l’acte de fraternité. Appel parfois répété au nom des personnes et des choses, comme la vie regardée en face et qui soulage de toutes les peurs. Le mot « met de l’ordre dans le chaos du monde ». Le mot vers « la familiarité du monde », le soulagement, la vie reconquise par les choses qui ont un nom. Il y a un lien entre la paternité et le nom des choses. Deux langues inconciliables se superposent : celle des autres, le dehors, la sienne propre, le dedans : « tout mon univers réclamait une langue nouvelle. » L’apprentissage de cette langue fut un combat gagné contre la pauvreté ». La langue est proche du corps avec des influences réciproques pour que le mot et soi ne fassent plus qu’un. Une langue pour lutter contre l’effacement, l’oubli, la mort.
Une troisième langue permet d’atteindre le dessus des choses. Elle est « royale » et personnelle. Une troisième langue « dont personne n’était le gardien » qui allait par la transformation du corps changer le monde et surtout sa vision. Il découvre le texte libre qui n’est pas une leçon ou une morale mais une présence charnelle qui mettait en évidence sa sexualité d’adolescent : celle tournée vers lui et celle tournée vers les autres. Livre baroque, touffu malgré la ligne droite qu’il dégage et le rapport serré entre la vie et les mots, source de vie. Tout se termine par une course entre l’événement qu’il faut maintenir à l’extérieur et l’écriture qui doit le guider et le forcer à se réaliser. Un seul événement comme l’arrivée du sable en déclenche d’autres oniriques, fantastiques cependant attachés à un réel. Les points de repère ont disparu. Cela rappelle Rimbaud, dans les Illuminations, où réel et irréel ne sont qu’un mais le tout reste sensible à la limite du possible mental où le réel est récupérable mais reste à fuir.
Pour le narrateur, « la langue française, étrangère, signifiait un pouvoir sur les objets ». « La création s’avançait vers moi » et la langue devenue la langue de la licence des mœurs fait tout se passer à l’intérieur. L’orgie n’est pas vécue mais simplement décrite. Le narrateur est devenu voyeur, la langue est son amour qui le libère jusqu’à une sorte de folie comme donner la main à un frère ennemi. Une soif de lire mais surtout de relire tout texte, notice, livre…qui lui tombent sous la main fait que la langue dépasse tout ce qui est lu. Elle est précise et rigoureuse. Voilà sa force où l’on peut imaginer. Le monde finit par ne plus exister que dans la langue, sa pleine liberté, l’imaginaire mis à nu et en mouvement.
Tout finit dans l’agitation et la perte du don, la dispersion des écrits, la perte de l’écriture. « Cette langue m’a libéré ». « J’ai atteint l’équilibre du sang et du sens, entre l’évocation et la vie. » C’est le retour à la vie ordinaire.
- Marilyne Bertoncini, L’anneau de Chillida - 9 décembre 2024
- Stéphane Sangral, Là où la nuit / tombe - 14 octobre 2019
- André du Bouchet, la parole libre de son mouvement - 5 novembre 2018
- Berbard Desportes, Le Cri muet - 4 septembre 2018
- Philippe Lekeuche, Poème à l’impossible - 3 juin 2018
- Kamel Daoud, Zabor ou les psaumes - 5 mai 2018
- Lionel Seppoloni, La Route ordinaire - 24 octobre 2017
- Philippe Mathy, Veilleur d’instants - 19 octobre 2017
- Stéphane Sangral, Des dalles posées sur rien - 10 avril 2017
- Stéphane Sangral, Là où la nuit / tombe - 10 avril 2017
- Fabien Abrassart, Si je t’oublie - 10 avril 2017
- Fil de Lecture de Jean-Marie CORBUSIER - 7 mars 2016
- Jean-Marc Sourdillon, Jaccottet écrivant Au col de Larche - 13 septembre 2015
- Philippe Jaffeux, Autres courants - 10 mai 2015
- Philippe Jaffeux, Courants blancs - 9 novembre 2014






