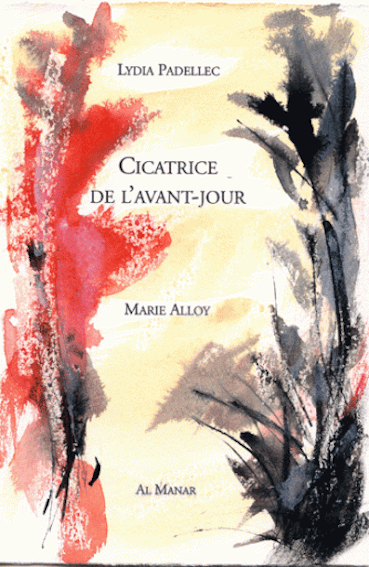Lydia Padellec ou l’attention à l’infime
Beaucoup a déjà été écrit sur La maison morcelée de Lydia Padellec, et notamment sur sa dimension proustienne, évocation du temps qui toujours se dérobe aux retrouvailles sauf sous la forme elliptique du fragment. Une dimension a peut-être été moins soulignée : c’est cette attention à l’infime, qui, au-delà d’une poésie du quotidien, peut en outre être reliée à l’amour bien connu de l’auteure pour les différentes formes de la poésie japonaise (haïku, tanka, haïbun…). Si les textes réunis dans ce recueil ne reprennent nullement la forme de ces différents genres poétiques, on y retrouve pourtant cette considération égale accordée à tous les êtres, à toutes les formes de vie, si dérisoires qu’elles puissent paraître, qui imprègne la poésie japonaise et traduit entre autres ses liens avec le bouddhisme.
Ainsi, cette maison désertée de son occupante originelle n’est pas pour autant exempte de toute vie, mais peuplée de minuscules habitants : abeilles, grillons, mouches, libellules, araignées, crabes, chenilles…Le frôlement de leurs ailes et le chatouillement de leurs pattes composent la véritable bande originale de cette ultime visite de la maison d’enfance. Ils ne sont cependant pas les seuls vivants qui demeurent en ce lieu : sous la plume de la poète, les plantes et même les objets les plus insignifiants agissent et se personnifient « Le frigo ronronne, se lèche les parois… », « des iris bleus prennent la pose », « les géraniums baissent la tête… », « Il [le tabouret] ne semble pas souffrir de l’amputation ». La frontière entre les règnes s’estompe, de même que la ligne de démarcation entre le vivant et le non-vivant, comme pour retrouver l’unité originelle d’un monde qui serait entièrement animé (au sens de l’animisme), un monde d’avant la chute où la vie grouillerait partout, là où on l’attend le moins. Peut-être est-ce aussi une manière d’atténuer la charge mortifère de la perte, comme si ce pan d’existence à jamais révolu s’était en quelque sorte transféré sur les êtres et les objets les plus élémentaires, qui portent désormais tout ce qui reste de vitalité en ces lieux.
Si Lydia Padellec n’a pas son pareil pour évoquer tous ces « petits riens » qui tissent la trame de nos existences, il serait pourtant réducteur de ne voir dans son écriture qu’une poésie du réel, fût-elle éminemment sensorielle et subtile. L’image y garde toute sa place, et rayonne même par moments avec d’autant plus de fulgurance au milieu du dépouillement de l’ensemble : « l’arbre au milieu d’un champ rêve d’oiseaux », « une odeur de shampoing (…) perce l’obscurité de ses doigts carnassiers », « le linge gémit dans son sommeil ». On est parfois au bord du songe : « le pied transi de mer devient galet » « Une musique : Lady sings the blues. Elle traverse les pièces de sa robe bleue. (…) Ses pieds nus frôlent à peine le dallage. ». Des visions oniriques qui disent avec d’autant plus de force le morcellement, qui n’est pas seulement celui de la mémoire, mais aussi celui du corps : « les doigts caressent les poils de la nappe » « assise sur le lit, la bouche interroge le regard de la méduse » « les mains flottent, détachées de leur bras, dans l’air saturé ». Car par-delà l’apparence anodine des notations, c’est bien d’un arrachement qu’il s’agit ici. Du paradis perdu, on ne peut que ramasser les miettes. Comme dans le haïku, toutefois, l’émotion est toujours retenue, jamais livrée avec pathos, et s’accompagne d’un effacement du je. Elle n’en est pas moins présente. Ainsi “objectivée”, n’est-elle pas même d’autant plus réelle, tangible, partageable ? « La petite fille est morte en même temps que la mésange ». « Le ventre a mal ».
- Alena Meas, Piliers - 14 janvier 2014
- La maison morcelée de Lydia Padellec - 26 octobre 2013