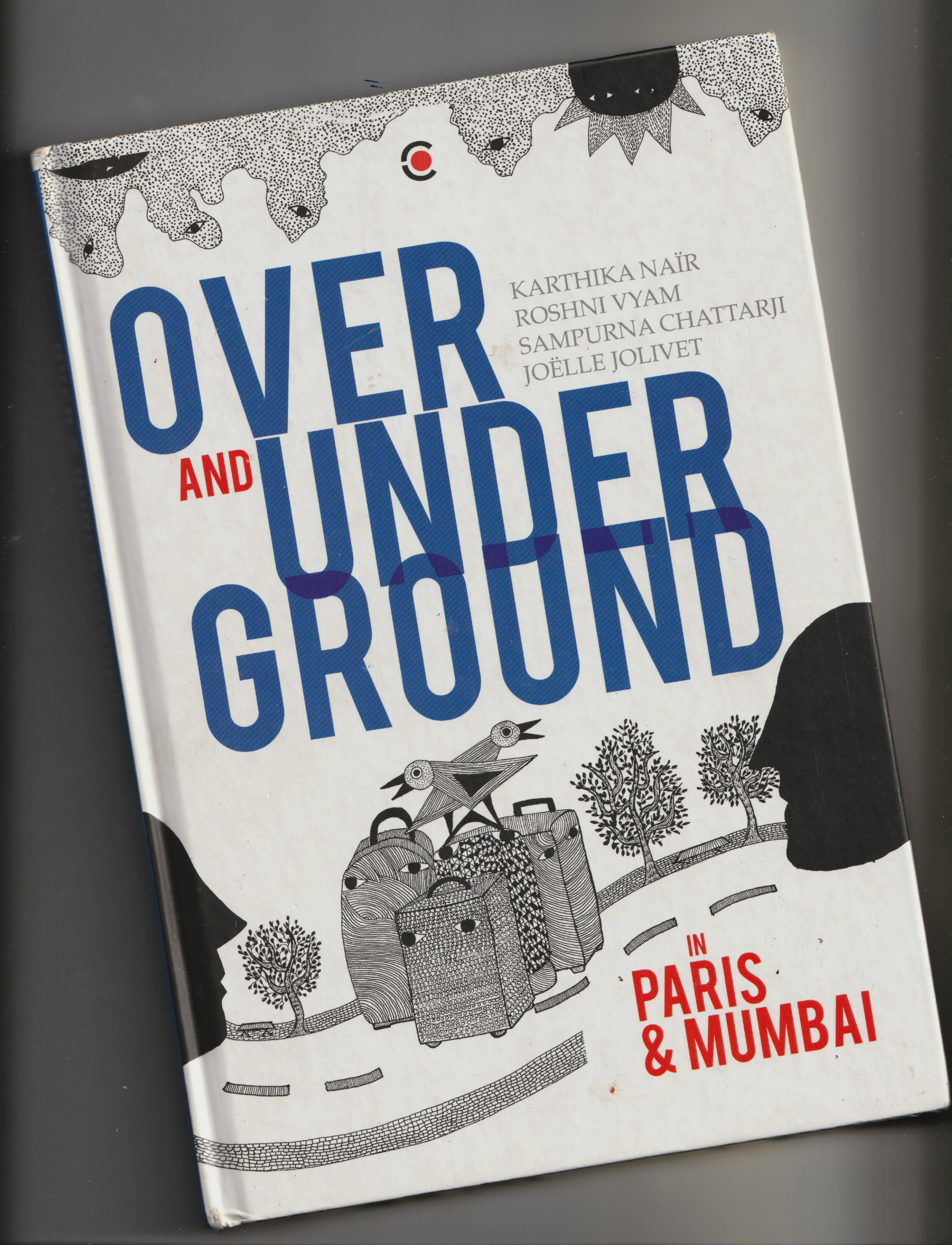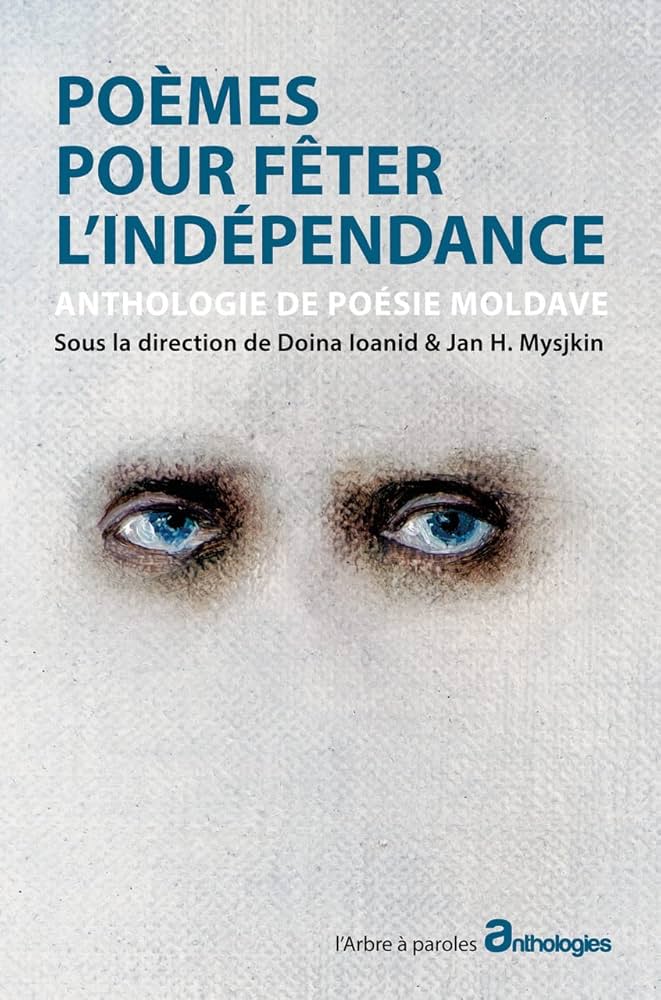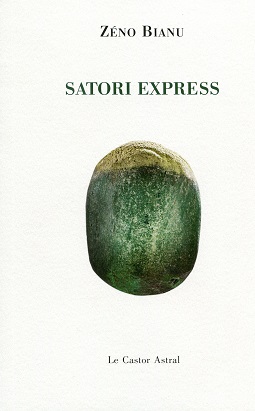Un cinéma en quête de poésie renoue avec l’approche par la réception de la définition du fait poétique essayée depuis 2013 par Nadja Cohen avec Anne Reverseau1, et au programme alors défini : mettre en avant les discours – examens critiques, écrits de cinéastes, jusqu’aux usages triviaux du terme « poétique » rejetés par la plupart des études – pour ouvrir (enfin) le champ du poétique à de nouvelles œuvres et pratiques cinématographiques. Ce pas de côté que l’on pourrait qualifier d’approche pragmatique signale la volonté de discuter d’abord d’une pratique discursive et non d’une qualité essentielle des films, d’une stratégie critique plutôt que d’une catégorie esthétique : en un mot, d’une rhétorique qui fait du « poétique » non plus un attribut des œuvres mais un état particulier tissé par la relation du public à une certaine qualité et matérialité d’images et de sons.
Outre la confirmation de l’importance de cet axe pragmatique, ce recueil d’articles porté par N. Cohen possède l’indéniable qualité de renouveler le vivier de cinéastes proposé·e·s à l’étude historique et à l’analyse esthétique du « cinéma de poésie ». Nombre d’artistes font ainsi leur entrée à côté des canons du genre rappelés dans l’introduction et encore discutés dans l’ouvrage. Voisin·e·s de Bela Tarr, Sergei Paradjanov, Agnès Varda ou Jean-Luc Godard, d’autres bénéficient d’une salutaire mise en lumière comme la cinéaste avant-gardiste américaine d’origine lithuanienne Marie Menken, mais aussi de jeunes auteurs et autrices comme l’Italienne Marina Spada ou le Français Damien Manivel.
Le livre se présente en quatre parties qui ouvrent chacune un programme de recherches distinct : la première questionne l’étiquette critique du « poétique » (chez les « réalistes poétiques » français comme chez Godard) ; la seconde – via la discussion obstinée de la possibilité ou non d’identifier comme métaphores certaines pratiques filmiques commentées tout au long de l’histoire du cinéma – se penche sur les procédés à l’œuvre dans les films dits « poétiques ». Une troisième partie veut reconstruire « l’effet poétique » dans la tension entre le monde et le regard du ou de la cinéaste (notamment chez Varda ou les néoréalistes italiens), tandis qu’une quatrième interroge les possibles transferts de la qualité poétique de la vie d’un poète vers son biopic (qu’il s’agisse de figures historiques, le Rimbaud de Richard Dindo ou l’Antonia Pozzi de Marina Spada, ou de personnages fictifs comme chez Jim Jarmusch ou Damien Manivel).
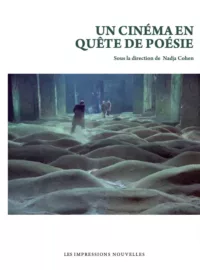
Un cinéma en quête de poésie, sous la direction de Nadja Cohen, Bruxelles : Les Impressions Nouvelles, coll. « Caméras subjectives », 2021, 416 p.
Au côté d’une approche esthétique de la question du « cinéma de poésie » dont le sillon (inventorié en introduction) se poursuit dans le recueil, deux lignes nouvelles se dessinent. D’une part un approfondissement de l’approche pragmatique ouverte par N. Cohen et A. Reverseau, interrogeant les stratégies critiques du recours à la notion de « poésie » pour déterminer son efficace lexicale aussi bien que son rôle stratégique dans la sociologie du champ. D’autre part, de manière plus souterraine, une approche matérialiste se dessine au gré de la référence insistante des contributeurs et contributrices du recueil à une « poétique du matériau », à la réalité concrète ou à l’objectivisme, et qui cherche enfin à penser de manière frontalement politique le recours au poétique.
Pour une pragmatique du poétique
Après un tour d’horizon qui rappelle les scansions historiques des relations intermédiales entre cinéma et poésie, tradition majoritairement écrite par des cinéastes (Dulac, Cocteau, Epstein, Deren, Pasolini, Tarkovski, Ruiz…), l’introduction copieuse de N. Cohen fait retour sur l’idée – canonique depuis les formalistes russes (Chklovski, Tynianov) – d’un « cinéma de poésie » caractérisé par sa faible narrativité, par la ténuité du dramatique au profit d’une maximalisation de l’effet (et donc de la prise en compte de son public). Le parcours du livre sera ainsi tendu par ce chemin parcouru, d’une critique intéressée à la définition de l’essence des œuvres jusqu’à la caractérisation du poétique comme effet de réception, porté par le bel idéal d’Éluard qui, dans « L’évidence poétique » (1936), nommait poète « celui qui inspire, bien plus que celui qui est inspiré ». Une même « naissance du spectateur et de la spectatrice » du cinéma de poésie est proclamée, remarque N. Cohen, dans les écrits du cinéaste Andreï Tarkovski, pour qui le public et le cinéaste partagent « la joie et la souffrance de la naissance de l’image ». L’auteur de Stalker, qui donne sa couverture à l’ouvrage, ne concluait-il pas, comme une invite, à la définition du poétique comme d’une liaison : « Nos émotions, nos pensées, ne sont-elles pas toujours comme des allusions inachevées2 ? ».
L’ouvrage ne cantonne cependant pas cette approche à une étude de la réception individuelle des films, et le programme qu’il suit vise plutôt à nouer cette démarche à celle, cette fois collective, de l’interprétation critique du signifiant « poésie/poétique ». Ainsi, après une enquête lexicographique (allant de Man Ray à Pierre Alféri), Jérôme Dutel propose ainsi d’étudier les « ciné-poèmes » du festival de Bezons, réunis en DVD et publiés sous cette appellation par le réseau scolaire Canopé, comme l’exemple d’un rapprochement « spontané » du fait poétique et du champ cinématographique. Certes, plusieurs critères esthétiques se dessinent à la faveur d’une étude surplombante de ce corpus de vingt-et-un court-métrages : la brièveté de la forme (pour des raisons économiques, auctoriales, mais aussi d’intensité esthétique) ; le choix de l’animation ou de l’expérimental (surtout la vidéo) ; le travail sur la langue… Mais, clarifiant bien l’approche préférée par l’ouvrage, « plutôt qu’à chercher dans chacune des œuvres présentées ce qui ferait d’une œuvre cinématographique une œuvre poétique », l’auteur souhaite « avant tout pointer la polyphonie et la polysémie pises à l’épreuve par la volonté de réunir ciné et poème dans une perspective didactique » (p. 47). Mentionnons encore trois autres articles qui démontrent la portée heuristique manifeste d’une telle approche.
En questionnant une œuvre de cinéma établie, et non plus un ensemble réuni ad hoc, Célia Jerjini propose une passionnante enquête sur les relations que Jean-Luc Godard entretient avec le signifiant poésie au cours de sa longue carrière artistique etcritique. En étudiant la relation avec l’équipe originelle des Cahiers du cinéma (Jacques Doniol-Valcroze, Pierre Kast, André Bazin, et surtout Jean Cocteau) et le corpus critique du futur « jeune Turc », l’autrice démontre les rapports que le jeune Godard entretient avec le poète du cinéma Cocteau, parrain de l’entreprise critique par le biais du ciné-club qu’il anime alors, Objectif 49, ou du Festival du Film Maudit de Biarritz qu’il préside la même année. À partir de remarques judicieuses sur le montage par Godard de son propre passé de critique dans le recueil de ses écrits (Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard), C. Jerjini note la discrète mais bien réelle constitution de « JLG » (acronyme choisi par le cinéaste pour signifier la filiation de son œuvre de cinéaste et de critique, selon l’autrice) en poète du cinéma. Elle prend ainsi pour exemple la mise en vis-à-vis de la critique de l’Orphée (1950) de Cocteau et de celle, si décisive pour Godard et notamment pour la réalisation du Mépris (1963), du Méditerrannée de Jean-Daniel Pollet :
Ériger Pollet, cinéaste moderne associé à la Nouvelle Vague, en poète orphique sous l’égide de Cocteau, est, pour Godard, autant un moyen d’assimiler leur approche et de l’inscrire dans la veine d’un cinéma de poésie, que de défendre leurs films respectifs. (p. 65–66)
Cette étude de la « posture d’auteur » du cinéaste que JLG met en œuvre (C. Jerjini parle d’une « attitude de poète ») est encore parachevée par la récente exposition Le Studio d’Orphée, adaptation-installation du JLG/JLG. Autoportrait de décembre (1995) mise en œuvre à la Fondation Prada de Milan à l’hiver 2019–20203, et dans laquelle le cinéaste vieillissant se coule dans les pas de son prédécesseur « exemplaire ». Godard n’est d’ailleurs pas le seul à construire une carrière cinématographique majeure à l’école de Cocteau, et un travail similaire pourrait être effectué à partir de Chris Marker, critique d’Orphée dans la revue Esprit dès 19504. C. Jerjini propose par la suite une étude des mentions du terme dans les discours du cinéaste : on pourrait encore souhaiter que cette étude soit mise en regard de la présence du terme « poésie » dans les films de Godard eux-mêmes, notamment dans ceux où la voix de commentaire est si proche de l’écriture critique du cinéaste (Deux ou trois choses que je sais d’elle en 1967, déjà rapproché avec profit de la poésie de Francis Ponge5, ou bien de la présence de la poésie d’Éluard dans Alphaville en 1965).
Nathalie Mauffrey présente dans une même direction son enquête approfondie de la relation parfois conflictuelle d’Agnès Varda avec l’idée de poésie et de cinéma poétique (l’autrice relate une anecdote parlante à ce sujet, la cinéaste invitant tout artiste à « ouvrir la porte et partir en courant […] quand on entend dire “poétique” »). Malgré cette apparente conflictualité (ou peut-être ce rendez-vous manqué entre la critique et une cinéaste tentant de gagner sa place au sein d’une profession vue comme essentiellement masculine : « n’est pas Marker qui veut » se verra-t-elle asséner), l’autrice démontre la grande productivité de ce terme dans l’histoire critique consacrée à la cinéaste, de La Pointe courte (1954) aux Plages d’Agnès (2007). Certes, il s’agit d’abord d’une certaine férocité vis-à-vis de ses jeux de mots jugés faciles (N. Mauffrey rappelle l’« abri côtier » élu par la cinéaste dans Les Plages d’Agnès), ses « commentaires mièvres », et la forme « mineure » de littérarité que choisit Varda pour entrer en poésie ne satisfait pas les critiques.
C’est par l’image en revanche qu’elle acquiert ses galons de cinéaste « poétique » : La Pointe courte est pour Jean-Louis Bory un « poème en image », Lorenzo Codelli qualifie Mur murs de « poème visuel », Jacquot de Nantes estun « documentaire poétique » pour Pierre Murat et les Plages d’Agnès un « mélange de poésie et de quotidien » pour Stéphane Delorme (l’ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma étant d’ailleurs abondamment cité par les auteurs et autrices de l’ouvrage comme l’un des critiques les plus prolixes concernant la poéticité du cinéma…). Cette étude de cas de Varda permet à N. Mauffrey une conclusion utile à plusieurs contributions de l’ouvrage :
Le cinéma poétique n’est donc pas un cinéma littéraire, […] et lorsque qu’il [est poétique], il l’est cinématographiquement, parce que le regard porté sur le monde par la cinéaste […fait] ressentir la beauté des choses, et que subséquemment le regard du spectateur s’ouvre sur une autre réalité qui éveille son imaginaire. (p. 88)
Dès lors Varda elle-même tient à distance la comparaison avec la littérature, pour favoriser une « cinécriture » défendue dès 1981 (sous le terme de cinémature d’abord, mot-valise de cinéma et littérature) :
Quelque chose qui serait du cinéma et des mots : des images en tant que mots, avec leur signification propre, sans être liées par une syntaxe, un écrit ou une logique, de même qu’en poésie, on utilise des mots en tant que mots, plus que les phrases que forment ces mots.
La poésie compensatoire d’un quotidien prosaïque que pratique Varda est bien celle d’un « style » visuel et artistique, développé comme traduction d’une vision intérieure et volontiers proche d’une référence à l’onirisme du cinéma. Ainsi N. Mauffrey conclut-elle à un véritable « pacte poétique entre regard et style » (p. 99) à l’origine d’un sur-réalisme (« élever d’un ton la réalité ») du film poétique selon Varda : une pratique soigneusement développée « à l’abri » des regards de la littérature (et des critiques).
L’article d’Esther Hallé-Saito propose de décentrer la perspective du cadre français pour évaluer la place que prend le terme « poétique » dans les écrits des auteurs italiens du « groupe Cinema » des années 30–40 (regroupant, comme les « jeunes Turcs » des Cahiers deux décennies plus tard, de futurs cinéastes, tels Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Antonio Pietrangeli ou Giuseppe De Santis). L’attention portée à cette poétique critique préalable à une pratique formelle et filmique, que proposait déjà C. Jerjini dans son article sur Godard, permet de mettre au jour le « désir poétique » visible dans les manifestes critiques de ces proto-cinéastes.
Ce désir de poésie est lié d’emblée à la question du paysage. Son rôle matriciel est déjà évident dans le projet de film d’Antonioni sur le fleuve Pô (écrit en 1939 mais réalisé finalement, sous le titre Gente del Pô en 1943), qui cherche à opérer un « déplacement poétique », un « tremblement symbolique » (p. 232) à même de transmuer la réalité ethnographique en survivance mythique, proche des films postérieurs de Pasolini, qui louera d’ailleurs le Deserto rosso (1964) du cinéaste pour sa qualité poétique dans sa conférence sur le cinema di poesia de Pesaro en 1965. L’autrice rappelle également la référence, sensible chez De Santis ou chez Pietrangeli par exemple, au « réalisme poétique » français d’un Renoir (que Visconti assiste pour Les Bas-Fonds et Partie de campagne) : pour les critiques, c’est le paysage qui permet au Lantier (Jean Gabin) de La Bête humaine, de s’ « exprime[r] en poésie » Analysant « occurrences et significations », « motifs et enjeux » du poétique, dans le but de croiser ces qualifications à la visée documentaire et ethnographique de l’esthétique néoréaliste, E. Hallé-Saito ne manque cependant pas de signaler ce qui, dans l’usage de ce terme, tient de la « stratégie de légitimation relevant d’enjeux de distinction spécifiques » (p. 215), propices à structurer un champ cinématographique alors en pleine recomposition.
Dans un tel contexte, nous pouvons comprendre la référence à la poésie dans les textes du « groupe Cinema » comme une manière d’affirmer la spécificité d’un réalisme distinct de celui qu’avait déjà revendiqué la génération des hommes de lettres [des années 30 : les auteurs dits calligraphistes comme Mario Soldati]. (p. 226). Le terme, inutile à la reconnaissance du groupe après 1942, n’est plus autant employé – preuve que même le signifiant poésie n’est pas exclu du jeu social et que son emploi est diversement indexé sur l’échelle des valeurs selon les époques et les besoins de reconnaissance institutionnelle.
Du matériau au matérialisme : nouvelles approches
Mais le recueil n’est pas qu’une poursuite de la méthodologie pragmatique de son introduction, et une autre orientation critique se dessine, suggérée par les échos entre trois articles à cheval entre les dernières parties du recueil : le rappel insistant d’une tendance « objective » du cinéma de poésie. « Ceci n’est pas l’histoire d’un poète. Le cinéma utilise le langage des objets » ? ouvre Sayat-Nova (1968) de Paradjanov commenté par Nikol Dziub, tandis que la référence à la poésie américaine objectiviste de William Carlos Williams sature le Paterson (2016) de Jim Jarmusch étudié par Matthias De Jonghe. Enfin l’étude « matérialiste » de la poétique de la cinéaste expérimentale Marie Menken par Bárbara Janicas achève de présenter le matériau comme le souci principal du film « poétique ».
Bárbara Janicas cherche dans son texte à faire tenir ensemble la réhabilitation d’une figure longtemps oubliée par l’historiographie (et notamment l’œuvre maîtresse de l’histoire du New American Cinema, Un cinéma visionnaire de Paul Adams Sitney), sa poétique avant-gardiste reposant sur le travail matériologique du médium filmique « en lien avec l’expérience cinégraphique des années 20 » (Loïe Fuller, Germaine Dulac), et enfin « l’expérience somatique de l’improvisation en danse » explorant les trois « dimension[s] matérielle, expérientielle et corporelle » du cinéma. Participer à la redécouverte de Marie Menken constitue ainsi un acte fort, en cela que sa figure constitue une alternative à la fois au concept de « ciné-danse » de Maya Deren mais aussi à la malheureuse propension des critiques masculins à dessiner une histoire biaisée des mouvements artistiques : « comme si, dans les moments charnières de [l’histoire] du cinéma, il n’y avait eu de place que pour une femme à la fois », Germaine Dulac dans les années 1920 ou Deren dans les années 1940–1960. Sitney lui-même est revenu à deux reprises sur l’absence de Menken de sa première histoire publiée en 1974 (dans la préface à la troisième réédition du Cinéma visionnaire en 2002, mais également dans Eyes Upside Down, en 2008, où il consacre un article entier à la cinéaste6), au point d’en faire une figure matricielle. (Là aussi, comme avec Deren, la compensation de l’oubli ne se fera qu’au moyen d’une valorisation un brin sexiste – celle de la figure maternelle). Cet article constitue donc une louable tentative d’identification de la figure plutôt que de la flouter dans le continuum vague du New American Cinema ou du « cinéma lyrique » de Sitney.
En guise de prolégomènes, B. Janicas identifie deux voies propices à l’affirmation du potentiel poétique du cinéma. D’une part celle, littéraire, de voie d’accès à l’inconscient, à la spiritualité ou à l’onirique (via l’association d’idées et d’émotions) que l’on pourrait qualifier de symbolisme, de subjectivisme et de lyrisme. D’autre part, celle, plus formaliste, qui recourt à des analogies de procédés et de principes de construction (rythme, vitesse, répétition) et qui en vient à « considérer la poésie comme l’âpreté du graphisme visuel de leurs films abstraits » (p. 258). Ce partage, identifié dès les années 1920, reste pertinent dans la seconde partie du siècle. Lorsque Sitney reconstruit l’histoire du cinéma américain (à partir de l’influence post-romantique et de la tradition picturale de l’expressionniste abstrait) en le qualifiant de cinéma « visionnaire » ou mythopoétique, il lui oppose ainsi, quelques années plus tard, une seconde tendance : un cinéma « structurel », propice à l’abstraction, héritier du direct film et du cinéma d’animation graphique. L’éloignement de la tradition lyrique semble alors consommé pour Sitney, mais pour d’autres historiens comme Alain-Alcide Sudre, le cinéma structurel n’a pas coupé les ponts avec la dimension rythmique de la poésie, en ce qu’il tend « vers une formalisation des démarches artistiques qui, contrôlées, à l’instar de la poésie, repose sur un jeu de contraintes décidées a priori7 ». Or, selon B. Janicas, Menken se situerait ainsi très exactement entre ces deux traditions lyrique et structurelle, ce dont témoignaient déjà les seules lignes que Sitney consacrait en 1974 à Menken, où il loue sa « structure rythmique » singulière, et comparait ses films aux Jeux des reflets et de la vitesse (1923–1925) d’Henri Chometteet à l’Étude cinégraphique sur une arabesque (1929) de Dulac. Menken pourrait ainsi être considérée comme une synthèse originale – et peut-être unique – entre l’approche lyrique et l’approche matériologique (« structural/material » dans les termes de Sitney), que l’historiographie avait jusqu’alors considérées comme irréconciliables.
Nicole Dziub poursuit son travail entamé dans le numéro de LhT consacré au « cinéma de poésie » dirigé par N. Cohen et A. Reverseau, et cherche cette fois chez Sergueï Paradjanov une nouvelle manière de reposer la question de l’intrication du poétique et du politique8. Elle trouve chez le cinéaste arménien, et notamment dans son célèbre Sayat-Nova. La Couleur de la grenade (1968) un autre cas d’affirmation par le cinéma d’une « langue mineure » de poésie, comparable au duel entre langue de prose et langue de poésie que Pier Paolo Pasolini dessinait pour son compte dans La Rabbia (1963), puis sous des formes renouvelées dans sa célèbre conférence de Pesaro sur le cinema di poesia de 1965. Mais le projet du cinéaste arménien prend rapidement une direction toute différente, alors que le refuge monacal choisi par le grand poète Sayat-Nova diverge de la poésie enragée du « poète civil » Pasolini, comme le définissait son ami Alberto Moravia.
N. Dziub dresse d’abord une analyse détaillée de la référence au fait poétique chez Paradjanov, qu’elle identifie à une ligne de fuite lui permettant d’échapper au monopole culturel-linguistique russe pour devenir « ambassadeur des cultures “marginales” au sein de l’URSS », « tentant d’échapper à l’emprise de l’homo sovieticus et de résister à l’effacement des passés “nationaux” », ce qui le rapproche d’autres cinéastes soviétiques, comme l’Ukrainien Alexandre Dovjenko et son pastoral La Terre (1930), mais aussi de la défense des socio-cultures ouvrières et paysannes chez Pasolini. Comme chez l’Italien, vanter les valeurs poétiques du cinéma permet au cinéaste de développer un discours « localiste » : « importance de la terre natale, célébration des traditions (notamment païennes), respect des coutumes et des mœurs locales, recours au folklore musical et poétique » (p. 279). Un tel discours est en rupture avec l’impérialisme stalinien et l’écrasement des petites nations qu’entreprend le régime communiste. C’est sur ce duel linguistique, héritier de l’objectif politique souvent laissée dans l’ombre des linguistes du formalisme russe, que N. Dziub propose de fonder politiquement le poétique cinématographique, fermement ancré dans un contexte socio-historique et un discours social déterminés Si le poétique possède alors une vertu politique, c’est peut-être celle proche de la « créolisation » proposée par le poète antillais Edouard Glissant, culturellement plus inclusive que le rouleau compresseur national :
Si Paradjanov s’intéresse à [la poésie de Sayat-Nova], c’est parce qu’elle est celle de l’universelle singularité :si elle tisse des liens entre les peuples, c’est sans pour autant gommer leurs différences. (p. 281)
Cependant, N. Dziub note rapidement qu’une telle poétique devient fatalement « antirévolutionnaire, puisqu’[elle] privilégie la continuité et la répétition au détriment de la rupture et de la nouveauté » (p. 283) « Le poète est celui qui est chargé de sauver la mémoire, d’assurer la continuité, en écrivant, mais aussi en prenant soin des livres… ». La « sacralité du livre » que N. Dziub remarque en notant la superposition difficile d’une logique aristocratique (le poète prophète) et démocratique (l’éducation des masses) offre là encore prise à une confrontation avec La Rabbia et les invocations poétiques d’un Pasolini proclamant que « seule la Révolution peut sauver le Passé ».
La dernière partie du film et du commentaire de l’autrice démontre ainsi la sacralisation à outrance du phénomène poétique, devenu une tentative de respiritualisation de l’art par la parole sacrée. La retraite dans un couvent du poète arménien correspondrait à un désir de « rejoindre le monde des enluminures » identifié à la posture du cinéaste lui-même : « de la même façon, Paradjanov semble vouloir se réfugier dans le monde immatériel mais sacré que construit son film, comme pour se retirer de la Cité communiste. » N. Dziub s’appuie ici sur Qu’est-ce que la littérature ? de Sartre, pour qui « le poète refuse le langage », compris au sens des « mots de la tribu » vilipendés par Mallarmé, pour montrer que le retrait du monde public de l’utilité […] interdit au poète toute ambition politique, toute action sociale – bref tout engagement. En d’autres termes, recourir au poétique, ce serait s’exiler volontairement de la Cité. […] On est donc bien loin, ici, de la conception vertovienne du cinéma de poésie : si pour Vertov, il s’agissait de lutter contre la logique narrative “bourgeoise”, pour Paradjanov, pratiquer un cinéma poétique, c’est se soustraire au matérialisme pragmatique et à la toute-puissance du politique propre à la Cité soviétique. (p. 284–285)
C’est donc en un sens double sens que N. Dziub peut proposer en conclusion l’antagonisme : « Poésie contre matérialisme » (p. 288). D’une part, l’analyse conclut que la dimension politique du cinéma de poésie de Paradjanov peut être interprétée comme « négative » puisqu’elle « il invite au désengagement ». N. Dziub y perçoit tout de même in fine une vertu politique : « thématiser la poésie et mettre en scène des poètes » permettrait déjà de se libérer de l’omniprésence du politique que met en œuvre le monde soviétique. La poésie alors serait fondamentalement un refuge contre « le politique » dans son ensemble, entendu comme une bataille déjà perdue contre ce que N. Dziub dénomme le « matérialisme pragmatique » de l’État soviétique omniprésent (désignant ici un dévoiement de la philosophie politique issu du matérialisme scientifique). Mais pour parvenir à cette conclusion, l’autrice aura néanmoins dû mettre en place elle-même, et avec un profit substantiel, une grille d’analyse « matérialiste » à même de fonder sa propre interprétation du cinéma de poésie. Cet article permet ainsi de mettre au jour à fois le caractère rétif de la poésie à être envisagée sous l’angle d’une analyse matérielle et politique, mais en même temps, dévoile la grande pertinence d’une telle approche – y compris chez des auteurs non-révolutionnaires, où le poético-politique a souvent été cantonné (on pense à l’importance donnée par Didi-Huberman à Godard, Pasolini ou même à Brecht).
Une approche matérielle et/ou matérialiste serait ainsi possible malgré les refus du film poétique lui-même, comme le démontre à son tour l’article de Matthias De Jonghe consacré au film de Jim Jarmusch Paterson (2016). Celui-ci questionne en effet frontalement le potentiel démocratique de l’écriture en amateur que pratique le protagoniste éponyme du film et dessine la carte des influences du film jusqu’à la poésie objectiviste américaine. Certes, à première vue, les potentialités politiques ouvertes par le film ressemblent à la « résignation » et au refus du monde social dont Sayat-Nova faisait le constat à la fin du film de Paradjanov. L’écriture de poésie y est en effet décrite comme un « secret » bien gardé dans l’intimité d’une vie, permettant de préserver la sérénité de celui qui pourrait autrement apercevoir que sa situation existentielle ressemble bien à l’aliénation « minutieusement programmée par les innombrables ramifications, notamment idéologiques, de l’hypercapitalisme globalisé » (p. 339). À cet égard, Paterson relègue « soigneusement » hors du cadre la situation sociale de l’espace urbain qu’il prend pour chronotope. M. De Jonghe note cependant, à partir d’une esquisse convaincante (malgré les dénégations répétées de l’auteur persuadé de manquer son objet !) de la biographie artistique de Jim Jarmusch, les fondements idéologiques de l’acte de création selon le cinéaste. Sa passion du bricolage et de l’horizontalité de la pratique créative désamorce l’idéal romantique du génie, et s’approche de la « poésie du dimanche » (Jan Baetens) de son personnage. Cette conception est très proche du poème de William Carlos Williams dont le film reprend le titre et l’ambition : tracer la ressemblance entre l’esprit d’un homme moderne et la ville (« the resemblance between the mind of modern man and a city »). Son programme esthétique aussi : pas d’idées, sinon dans les choses (« No idea but in things »). « Tout peut servir comme matériaux, tout… même une liste d’épicerie fine », comme l’écrit Williams dans son poème Paterson. Jarmusch, du reste, ne dissimule pas ses emprunts à la New York School de la poésie américaine (outre Williams, citons les poètes « objectivistes » Frank O’Hara, ou Ron Padgett), dont il déclare même souhaiter être considéré comme un « équivalent cinématographique » (p. 351).
Le trait principal de cette poésie, rappelle M. De Jonghe, serait de sauvegarder ce qui constitue la valeur princeps du poétique (elle en est peut-être son adaptation à l’heure de l’aliénation des travailleurs et travailleuses dans les sociétés post-capitalistes) : la liberté – d’écrire ou de ne pas écrire, du moment de l’écriture, de la publication, du thème et du sujet. Paterson serait alors la mise en scène de ce « poétariat » théorisé par Jean-Claude Pinson, classe socio-littéraire issue de la « dominicalisation » de la pratique artistique, et qui correspondrait à un moment important de démocratisation de l’écriture littéraire : désacraliser et rendre commun sont les enjeux principaux du poème moderne selon les objectivistes, opérant une profanation de la sacralité artistique héritière du xixe siècle. Cette « multitude créatrice, avatar contemporain du prolétariat et du précariat, qui concilie d’après lui son impouvoir dans le domaine social et sa détresse économique avec une inventivité débrouillarde de tous les instants » (p. 362) serait le nom de la « résistance passive » qui s’organise dans la pratique amatrice, dont le but politique – certes modeste – serait la « déprise de la grandeur » (Pinson). Son efficace poétique, que M. De Jonghe déduit enfin des théories des formalistes russes et de la célèbre définition de la poésie désautomatisante de Viktor Chklovski, aurait pour visée une rénovation de la capacité attentionnelle : « abaisser les seuils de perception pour se rendre sensible à ce qui, d’ordinaire […] échappe à l’appréhension » (p. 355), « déjouer et dépasser l’aliénation associée au sentiment d’un retour abrutissant du même » afin de « rénover la sensibilité » et même de « cultiver une forme de conscience » pour « répondre à la crise de l’attention » du monde occidental.
Ici, plus que jamais, l’enjeu du poétique prend une dimension socio-politique, anthropologique presque : il est le nom du développement d’une technique de « résistance », un déploiement de stratégies individuelles en réaction à une mutation socio-politique généralisée. On reconnait ici les thèses défendues par Yves Citton (Pour une écologie de l’attention) que M. De Jonghe cite de concert avec l’historien de l’art et théoricien des media américain Jonathan Crary (7/7. Le Capitalisme à l’assaut du sommeil). Ces références sont le signe d’une tentative de dépassement du littéraire au profit d’un questionnement d’un « poétique » haussé (ou dégradé ?) au niveau matériel du politique. Au terme de l’analyse du film cependant, l’impression est là encore ambivalente tant le gain politique ne semble pas dépasser l’ordre du micro-politique. La matière poétique de l’œuvre sert à accréditer l’idée d’une résistance individuelle du poète, loin des passions politiques collectives que d’autres cinéastes, eussent-ils été à l’étude dans ce recueil, auraient permis de figurer.
***
Les deux termes, pragmatique et matérialiste, qui s’imposent à l’évaluation des nouvelles directions critiques esquissées par ce livre, signifient bien le renouvellement des enjeux qu’il opère. Tournée vers l’action et vers le monde, la critique contemporaine se déprend peu à peu de l’approche formaliste et essentialiste qui lui avait longtemps servie de programme de recherche (via la référence répétée à Jakobson notamment) pour chercher hors du livre ou du film les enjeux et les effets du poétique. Via l’intérêt constant pour l’enquête spectatorielle ou pour la signification socio-politique de l’acte poétique et de son usage critique, les essais rassemblés ici dessinent un stimulant dé-cloisonnement du poétique de la chose littéraire, et « branchent » – selon le mot deleuzien – délibérément la poésie de cinéma sur son dehors.
Notes
1 Voir Nadja Cohen et Anne Reverseau, « Qu’est-ce qui est poétique ? Excursion dans les discours contemporains sur le cinéma », Fixxion, n°7, 2013, p. 173–186 ; « Un je ne sais quoi de “poétique” : questions d’usages », Fabula-LhT, n° 18, « Un je-ne-sais-quoi de “poétique” », avril 2017.
2 Andreï Tarkovski, Le Temps scellé, traduit du russe par Anne Kichilov et Charles H. de Brantes Editions Philippe Rey, 2014 [1984], p. 28–30.
3 Occitane Lacurie et Barnabé Sauvage, « Portrait de l’artiste en Toutankhamon. À propos du Studio d’Orphée de Jean-Luc Godard », Débordements.
4 Dans le numéro d’Esprit de novembre 1950, on peut notamment lire cette définition du poète en « appareil enregistreur » : « On sait l’importance que Cocteau attache aux ondes, aux signaux, à tous les moyens de révélation mécanique. Le poète apparaît souvent chez lui comme une sorte d’appareil enregistreur. Et sans doute considère-t-il la caméra comme une machine à multiplier, à aiguiser les sens, une lampe à rayon X qui révèle davantage ce qu’on lui livre, un outil pour surprendre les secrets. “Les surprises de la photographie” était un sous-titre du Sang d’un poète, où Cocteau, “pris au piège par son propre film” mettait sur le compte du discernement de l’appareil la révélation de son visage à la place de son héros. » (p. 694–701).
5 Sam Di Iorio voit par exemple dans le film de Godard « un des premiers essais pour s’approprier certains aspects de la pensée pongienne au cinéma. » Voir « Ponge et Godard : deux ou trois choses », dans Jean-Marie Gleize (dir.), Ponge résolument, ENS Editions, 2004, p. 193–203.
6 Paul Adams Sitney, « Marie Menken and the Somatic Camera », Eyes Upside Down: Visionary Filmmakers and the Heritage of Emerson, Oxford University Press, 2008, p. 21–47.
7 Alain-Alcide Sudre, « Structurel (film) », dans Alain Virmaux (dir.), Dictionnaire du cinéma mondial, Éditions du Rocher, 1994, p. 338.
8 Nikol Dziub, « Le “cinéma de poésie”, ou l’identité du poétique et du politique », Fabula-LhT, n° 18, « Un je-ne-sais-quoi de “poétique” » », avril 2017.
Première publication de cet article : Acta fabula, https://www.fabula.org/revue/document13534.php