L’histoire du génie humain, quelle que soit la forme par laquelle celui-ci s’exprime, est l’histoire de ses fulgurances. On n’y entre pas, comme lecteur ou contemplateur, comme on le ferait pour la banale création d’un « faiseur ». Cela demande du souffle, l’endurance de l’effort et le risque de s’y perdre – pour en sortir métamorphosé. Quiconque a réellement affronté Dante, Lautréamont, Proust ou Artaud comprend ce que signifie plonger dans une œuvre aux profondeurs abyssales. Il faut dès lors faire nôtre cette injonction que le professeur Lidenbrock lance à son neveu, dans le Voyage au centre de la Terre 1 : « Regarde, me dit-il, et regarde bien ! Il faut prendre des leçons d’abîme ! ».
Nul d’entre nous, se souvenant de sa première entrée dans La Divine Comédie ou La Recherche du temps perdu, n’oubliera sa « première leçon de vertige… 2 »
Si la valeur d’un individu se mesure non à ce qu’il méprise, mais à sa capacité à admirer les merveilles de l’entendement humain, il nous sera donné d’être engloutis par la puissance de ces grands intemporels – engloutissement qui n’a rien que de lumineux tant nous en sortons transfigurés. La puissance de ces génies est de donner à l’âme l’élargissement illimité d’une illumination.
Mais que le lecteur ne se méprenne pas : en aucune façon les lignes qui suivront n’auront la moindre lueur de mélancolie. L’ambition de cet écrit n’est nullement larmoyante – mais combattante. Pour en rester à la seule poésie, un danger la guette si le minimalisme et le sentimentalisme l’envahissent durablement. Le sentiment n’est que le vecteur, non la fin d’une œuvre. Pour que celle-ci demeure et qu’une alchimie s’opère tant chez le poète que chez le lecteur, il est nécessaire, pour reprendre un extrait de l’auteur du Théâtre et la culture, qu’une symbiose se fasse entre l’acte, le corps et l’être :

The Divine Comedy, by Dante Alighieri (1265–1321), 1465, by Domenico di Michelino (1417–1491), fresco, Basilica of Saint Mary of the Flower, Florence. Italy, 15th century. • Crédits : DeAgostini — Getty
« Il faut insister sur cette idée de la culture en action et qui devient en nous comme un nouvel organe, une sorte de souffle second : et la civilisation c’est de la culture qu’on applique et qui régit jusqu’à nos actions les plus subtiles, l’esprit présent dans les choses3 »
La pensée, la révolte, l’incomparable énergie d’Artaud nous demeurent éclairantes en ce XXIe siècle. Sa puissance apparaît, entre autres4, dans l’affirmation, déjà inaudible en son temps, selon laquelle poésie et métaphysique sont inséparables pour donner à toute œuvre une puissance d’arrachement à la pesanteur sociale et d’ancrage dans le réel. Dans Le Théâtre et la peste, il donne corps à cette fusion dans une injonction que l’on peut appliquer tout autant à la peinture, à la poésie qu’au théâtre : « leur grandeur poétique, leur efficacité concrète sur nous, vient de ce qu’elles sont métaphysiques, et que leur profondeur spirituelle est inséparable de l’harmonie formelle5 ».
Seulement, il convient urgemment de ne pas faire de contresens sur l’acception qu’Antonin Artaud donnait au terme « métaphysique ». La méfiance envers ce mot extrêmement connoté était déjà bien vivace à l’époque du poète et dramaturge. Mais la portée qu’il lui donne est telle, sa puissance à ce point sismique, que c’est elle qui va nous inspirer ici.
Artaud ne nomme pas « métaphysique » ce qui nous détache de la réalité, mais tout au contraire ce qui nous y enracine toujours plus. C’est à la fois une pensée et un style qui empoignent, agrippent à pleines griffes le concret, le corps et le percent jusqu’aux viscères. Quiconque en doute peut relire les pages du Théâtre et la peste où nous sont montrés les carnages de l’épidémie dans toute leur réalité crue. Il peut faire de même dans nombre de poèmes de L’Ombilic des Limbes dont celui commençant ainsi : « Une grande ferveur pensante et surpeuplée portait mon moi comme un abîme plein. Un vent charnel et résonnant soufflait, et le soufre même en était dense. Et des radicelles infimes peuplaient ce vent comme un réseau de veines, et leur entrecroisement fulgurait.6 » Ce rapport au corps, paradoxalement si l’on se réfère à toute la tradition philosophique et mystique, renforce le lien et le rend indissociable de la métaphysique. Dans Héliogabale ou l’anarchiste couronné7, il rappelle les hallucinants rituels au cours desquels se produisaient des torrents d’excès dignes des processions dionysiaques évoquées par Nietzsche. Seulement, « au milieu de cette barbarie métaphysique, de ce débordement sexuel qui, dans le sang même, s’acharne à retrouver le nom de Dieu8 », Artaud y sent se raviver ce que pourrait être l’état d’esprit du poète authentique se replongeant dans la vie à sa racine. De même, Abdulrahman Almajedi, dans le poème Le cheval du désir que l’on peut lire sur le site Recours au poème, exprime superbement cette l’image de la métaphysique au sens d’Artaud, où l’on sent le corps faire bien plus que dire le réel, il le prend, le forme à son image : « laissant des vagues furieuses de sang / dans les artères et ruisseaux / dévaler, remonter / Tes battements augmentent / et tu trembles ». Toujours chez Recours au poème, on trouve écrit par Brice Bonfanti, dans Homme foyer, un poème incantatoire où se fait jour le lien métaphysique de l’âme, du corps, et de l’unité mystique oubliée avec le Feu originel : « Je suis l’Homme au Foyer. / J’entretiens le Foyer et son Feu, le Foyer de son Feu, Feu du Feu. / Je suis l’Homme Foyer, Foyer fait chair, fait Homme, Âme en Feu qui fait foi par sa chair. /En Moi, tout converge, tout converge vers Moi, tout converge au Foyer, tout finit par y tendre, trouver son Toit, si tendre – après l’errance, les accidents, les divergences. / En Moi, tout revient, tout revient sous mon Toit, où tout commence et tout finit, Je suis l’Homme Foyer infini, suis l’Humain quand il rentre au Foyer, le Foyer de tout homme, de toute femme, de l’infini de chaque femme et de chaque homme, /Je suis l’Humain premier, où chacun naît tout ce qu’il est, où naît tout ce qui est, puis hors de Moi devient ce qu’il n’est pas, et puis revient : redevenir tout ce qu’il est, tout ce qui est. (…) Je suis Fidèle à l’infini du monde, au milieu infini de ce monde, ce monde qui peut être Fidèle mais mal, malaisément, exceptionnellement. »
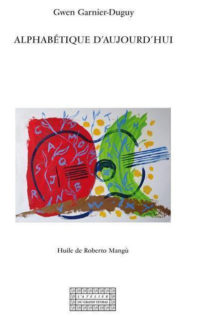
Gwen Garnier-Duguy, Alphabétique d’aujourd’hui,
Collection(s) : Glyphes, n° 38.
Ainsi, il y a bien dépassement dans la perception d’Artaud et ces autres poètes, mais ce dépassement se fait vers le lien inconditionnel entre le symbole, la nature et l’homme. Dans le Théâtre et la peste, il rappelle que les signes présents dans toute œuvre unique « constituent de véritables hiéroglyphes, où l’homme, dans la mesure où il contribue à les former, n’est qu’une forme comme une autre, à laquelle, du fait de sa nature double, il ajoute pourtant un prestige singulier 9. » Ce dernier est la capacité poétique de l’homme à projeter, à extraire de lui cette énergie créatrice pour en faire une réalité concrète qui élucide ce que nous sommes.
Chez Artaud – mais il en est également ainsi dans les sublimes Chants de Maldoror, ou dans l’Enfer et je pourrais continuer la liste – l’ancrage dans l’être de l’homme se fait par un style qui nous met – de force – face à face avec le réel dans toute sa nouveauté. Seuls les génies savent le percevoir avec clarté, comme l’exprime superbement le poète Georges Rose : « Louveciennes/Pissarro plonge une main dans l’univers/personne d’autre ne savait l’endroit 10 » L’homme est tout entier de ce monde et en ce monde. Mais cette simple affirmation qui pourrait – à juste titre – sembler bien banale, change de nature quand on la perçoit non comme le résultat, mais comme un maillon dans la longue chaîne menant à la lucidité.
Dans Le Théâtre et la métaphysique, Antonin Artaud nous le rappelle : il est indispensable de se confronter à ce qui est « inquiétant par nature, capable de réintroduire sur la scène un petit souffle de cette grande peur métaphysique qui est à la base de tout le théâtre ancien 11. » Nous terminerons par ces deux citations explicites, à savoir que « la vraie poésie, qu’on le veuille ou non, est métaphysique et c’est même, dirai-je, sa portée métaphysique, son degré d’efficacité métaphysique qui en fait tout le véritable prix 12 », et ainsi, pour le théâtre comme pour toute autre forme, « tirer les conséquences poétiques extrêmes des moyens de réalisation c’est en faire la métaphysique 13. » Cette dernière n’est pas une fuite, une désertion de notre monde – ces poètes nous y ramènent avec l’acharnement tragique d’un halluciné !
La nécessité pour la poésie d’être traversée par cette pensée métaphysique ne fait qu’une avec celle du cheminement vers l’unité. Des siècles de rationalisme borné – je n’y insère pas Descartes, bien plus subtil et divers que ne le pense une longue tradition – et de matérialisme fade ont asséché notre rapport au monde – et ont remplacé une superstition par une autre. Certains scientifiques ou « savants » peuvent égaler les « croyances de grands-mères » dans la paresse intellectuelle, au point de nous avoir fait croire que l’homme et le monde sont deux réalités séparées. Gwen Garnier-Duguy 14 donne à penser, par une superbe image, cette triste réalité : « Car l’hiver a pris ses quartiers / dans toutes les saisons. »
Or une résistance poétique est depuis bien des décennies à l’œuvre, et elle a d’illustres et lumineuses origines.
Les Fragments d’Héraclite, six siècles avant Jésus-Christ, sont l’expression éclatante des signes évoqués par Artaud ci-dessus. Ces fragments sont la pure présence phénoménale de la pensée qui fait signe vers le logos, qui se rend réel dans le même temps où il se cache, à l’image de l’antique αλήθεια. On y trouve ainsi cette unité puissante, autant physique que spirituelle, traversant la totalité dans les quelques extraits suivants, tirés de ce qui a été miraculeusement sauvé dans le marasme que l’on sait où tant de manuscrits ont disparu : « Unis sont tout et non tout, convergent et divergent, consonant et dissonant ; de toutes choses procède l’un et de l’un toutes choses » ; « Ce cosmos, le même pour tous, aucun des dieux, aucun des hommes ne l’a fait, mais toujours il a été, est et sera, feu toujours vivant, allumé selon la mesure, éteint selon la mesure » ; « Les conversions du feu; d’abord la mer, et de la mer, la moitié terre, la moitié ouragan. La mer s’écoule et est mesurée dans le même logos qu’avant l’apparition de la terre » ; et enfin :« Le un, cet unique sage ». Cette unité se retrouve de même, de nos jours, chez un George rose 15 faisant signe vers ce qui, en nous, est partie prenante des origines : « Le froid interstellaire / côtoie les arbres noirs / Un grand ciel sombre / se confond avec la ville » ou encore : « La brillance d’un lieu sombre / éclaire loin dans l’indicible », et enfin, mettant en relief l’aveuglement humain : « Le visible n’a pas encore ouvert l’invisible / ce fouillis d’instants n’est pas le temps / Que faudrait-il d’autre que l’univers / ceux qui sont nés ne se reconnaissent plus ». Du penseur antique au poète contemporain, une parenté s’installe dans le désir de saisir le lien universel, également présente chez Gwen Garnier-Duguy s’exprimant ainsi : « C’est hier que tu es entré dans ce royaume d’arbres / et quand tu parles à haute voix / l’écho te renvoie une présence ancienne. » Comment définir cette présence ancienne, sinon celle nous ramenant à la source originelle d’où tout émane ? Si chaque créateur est indiscutablement unique dans ce qui fuse de son entendement, la source qui nourrit ce dernier, cet amont mystique se prolonge dans ce que ce monde est depuis toujours. L’homme demeure aussi ce que fut l’univers depuis l’origine.
Cela se retrouve dans les écrits des poètes contemporains, chez qui le dire métaphysique, traversant le verbe, nous met face à face avec la réalité de l’enchâssement universel des êtres. Ainsi, dans L’Univers ressemble 16, Georges Rose donne-t-il à voir la réalité du lien : « La lumière jusqu’à l’étoile / commence à nos yeux ». Le premier vers du recueil nous met de même dans l’atmosphère mystique : « L’univers se cache-t-il dans l’univers ». On retrouve cette évocation métaphysique chez Gwen Garnier-Duguy de la parole intemporelle venant à la rencontre de qui sait écouter : « Ils auraient gardé / en leur mémoire fossile / la prononciation / pour l’heure où la parole, / les verticalisant, / leur donna l’Univers / en ses fraternités / pour tout sésame de lumière. » Cette insoumission des poètes à tout esprit de pesanteur frappe de nullité les Cassandre de la fin de toute mysticité.
Il est certain, en effet, qu’il y a dans l’âme humaine un fond universel, et c’est ce que l’expérience poétique, artistique ou mystique nous enseigne depuis des siècles. Montaigne le devinait déjà, qui décrivait ainsi son projet, en insistant non sur sa particularité, mais sur ce qui, en lui, rejoint « l’humaine condition » : « On attache aussi bien toute la philosophie morale, à une vie populaire et privée, qu’à une vie de plus riche étoffe : Chaque homme porte la forme entière, de l’humaine condition. Les auteurs se communiquent au peuple par quelque marque spéciale et étrangère : moi le premier, par mon être universel 17 ». Plus politiquement engagé, le poète Achille Chavée, dans La brigade internationale18, évoque avec hargne cette force qui traverse chaque individu, le porte et lui permet de dialoguer, de comprendre par-delà toute langue. Un mot y semble la clé : celui de signe. Il en est de même de celui intitulé Verdict qui scande la nécessité d’une sorte d’impératif catégorique, avec l’anaphore de « nous », transitivement assené comme ce qui nous rappelle sans cesse à l’ordre. L’âme de tout un chacun ne fait qu’un, en profondeur, avec l’âme universelle. Derniers vers en forme d’interpellation éthique : « Demain tantôt qu’allons-nous faire / de cet instant précis qui déjà nous observe ? » annonce le poème d’Abdulrahman Almajedi, Ainsi parlait le ciel, qui proclame tragiquement : « Et mon ciel hurlait en regardant la pluie s’abattre sur la terre ». C’est ici plus qu’une simple figure de style, c’est la pure personnification de l’unité s’efforçant de résister au néant. Pour rester dans cette éthique métaphysique, Brice Bonfanti, dans le poème Mais s’il surgit ? Comme un voleur dans notre nuit ?, marque de son rythme une pure jouissance des sonorités et des mots, tout en nous mettant face à face avec le drame de l’inconscience criminelle de l’homme : « l’univers fait parfait qui sera : l’Un divers, / lui qui ne voulait pas nous forcer, / lui qui voulait coopérer / – opérer avec nous : son imminent avènement en nous. / Il partira. / Mais nous, nous le croirons demeuré là : nous aurons maintenu sa grimace à sa place, nous croirons qu’elle est lui, et à sa place nous aurons sa grimace. / Pour fuir le pire, faire advenir l’ère à venir ». Ces différents poètes ont en commun la conscience de l’unité de ce que, à l’époque de la Renaissance, on nommait « microcosme » et « macrocosme ». L’oublier, c’est apparaître un « esprit aveugle ».
Pour scander le dire métaphysique de la destinée humaine et projeter l’unité mystique dans sa réalité, le poème est une arme qui s’écrit et se vit avec l’état d’esprit de ne pas concevoir « d’œuvre comme détachée de la vie 19 ». L’acte poétique demeure un investissement existentiel qui engage l’être et ne supporte pas le dilettantisme. Un dernier poème de Gwen Garnier-Duguy nous le dira magnifiquement : « Qui aura le dernier mot / entre le mal et le poème / parlant à travers ta voix / pour articuler la parole / perdue dans la profondeur de / l’inoubliable ? / L’homme de coeur te recueillera-t-il, te cachera-t-il dans sa bouche / avant que l’ennemi te masque ? / Bougera-t-il alors les lèvres / laissant s’éployer l’évidence / du monde en prononçant / l’immuable 20 ? »
Image de une : Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, Gallimard, collection Idées, 1964.
Notes
1 Voyage au centre de la Terre © 2003, RBA Fabbri France pour cette édition, p. 55. En italiques dans le texte. Le professeur Otto Lidenbrock s’adresse ici à son neveu, Axel, narrateur-personnage du roman.
2 Idem. P. 56.
3 ANTONIN ARTAUD, Le Théâtre et son double, Folio/essais 14, © Éditions Gallimard, 1964, pages 12–13.
4 Est-il nécessaire de préciser que, à aucun moment, nous n’ambitionnons de réduire le fleuve sublime du génie d’Artaud aux lignes qui vont suivre ? Les possibilités de s’enrichir en s’y plongeant sont comme l’univers dans lequel nous sommes : infinies ! Le soleil éclaire les humains depuis des siècles ; où voit-on que sa puissance ait diminué de ce que nous en faisons ?
5 Op. cit. Le Théâtre et la peste, pages 53–54.
6 Antonin Artaud, L’Ombilic des Limbes, © Éditions Gallimard, 1956, p. 53.
7 Antonin Artaud, HÉLIOGABALE OU L’ANARCHISTE COURONNÉ, © Éditions Gallimard, 1979.
8 Id., p. 15.
9 Op. cit., p. 59
10 Georges Rose, Dans l’intimité de l’immensité, éd. Littérales, 2016
11 Le Théâtre et la métaphysique, p. 65.
12 Id., p. 66.
13 Id., p. 68.
14 Gwen Garnier-Duguy, Enterre la parole suivi de La Nuit Phœnix, Revue NUNC, Éditions de Corlevour, 2019, p. 36.
15 Op. cit.
16 Georges Rose, L’Univers ressemble, Éditions La Licorne, 2019.
17 Montaigne, Essais, III, 2.
18 Ce poème, ainsi que les suivant d’Abdulrahman Almajedi et de Brice Bonfanti, peuvent être également lus sur le site Recours au poème.
19 Antonin Artaud, L’Ombilic des Limbes, op. cit. p. 51.
20 Op. cit., p. 73.
- Pascal Boulanger – la poésie comme méditation et combat - 6 janvier 2024
- Gwen Garnier-Duguy, Ce qui se murmure par-delà l’indicible - 20 mai 2023
- L’approche du silence - 6 mars 2023
- Marilyne bertoncini, La Plume d’ange - 12 octobre 2022
- Agencement du Désert – Quand le feu irascible se dompte dans la forme - 6 septembre 2020
- Georges Rose, Jeunesse de l’instant - 6 avril 2020
- Carole Carcillo Mesrobian, Ontogenèse des bris - 20 décembre 2019
- La poésie comme enchâssement dans l’unité métaphysique - 6 novembre 2019
- La poésie et l’indicible - 6 septembre 2019
















