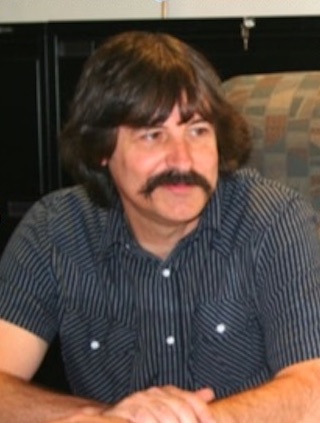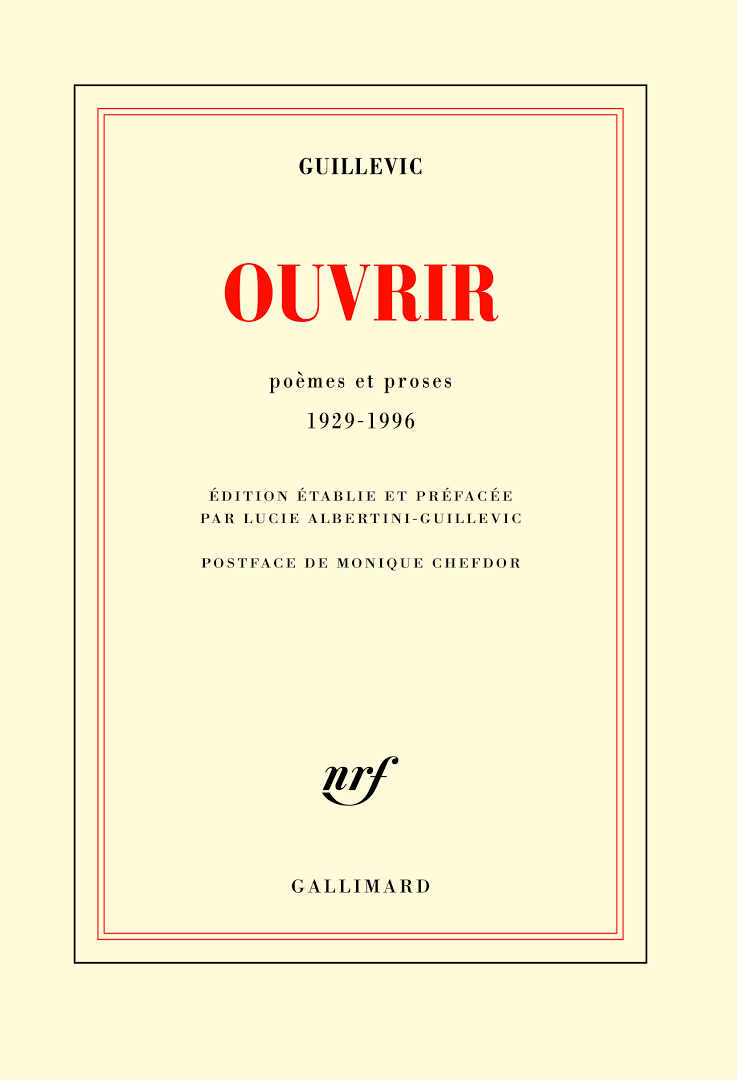« Plus jamais je n’aimerai la poésie poétique/ tant qu’il y aura une lumière incarcérée/ tant qu’il y aura un nouveau-né affamé/ déjà rattrapé par les canines du néant » clame dans un désert, André Laude dans Vers le matin des cerises. Voilà, en quatre vers, résumée par lui-même toute l’œuvre poétique d’André Laude, heureusement réunie par les éditions de la Différence. Un pavé que ces sept-cent vingt-neuf pages ! Mais que sont donc les poèmes d’André Laude sinon des centaines de pavés lancés dans le marigot d’une poésie mondaine et salonarde qu’il conspuait, à moins que ce ne soient les pavés d’une barricade, hâtivement érigée pour s’insurger contre le conformisme des « foules de béton , les buildings de chair morte ». « J’ai soif d’une vérité qui flambe enfin dans les yeux » écrit-il car c’est bien d’Absolu, plus encore que de vin rouge, qu’avait soif André Laude, et l’anarchiste qui brandissait un poing crispé était aussi, surtout, un idéaliste qui, dans ce poing, serrait un cœur saignant de trop d’amour, voire, sans que cela ait une connotation religieuse, un « mystique ». « Lui, le barricadier, l’insurgé – comme ce mot de Vallès lui va bien- l’iconoclaste, l’anarchiste, le contempteur d’idoles, le poète incendié, incendiaire, l’insulteur des pouvoirs, l’imprécateur révolutionnaire » comme le dépeint Yann Orveillon, était un poète de l’émotion, de la vibration, de la pulsation du sang, de la brûlure, de l’incandescence. S’il incendiait les mots et les vers, s’il attisait les cendres du sens, s’il brandissait les braises de l’imaginaire, s’il était ce « voleur de feu », c’était pour ranimer les cœurs ramollis par le confort matériel, c’était pour rallumer quelques étoiles dans les yeux éteints de trop de vies humaines sans âme, c’était pour faire rejaillir une flamme d’espérance dans trop de cœurs résignés.
Quand il est mort , le poète, c’était en pleine treizième édition du Marché de la poésie, place Saint-Sulpice, ce 24 Juin 1995, comme un dernier pied de nez , et le poète Serge Pey, qui préfère le « marcher de la poésie » à son marché , lui avait rendu cet hommage : « Il y avait toute la malédiction, la clandestinité, la résistance de la poésie qui passait à travers lui » . Malédiction, le mot est lâché, avec son cortège de clichés absurdes qui voudraient que la misère soit une garantie de talent et que seuls les « poètes maudits » écriraient de la vraie poésie. Pourtant, Serge Pey avait raison, car s’il est bien un poète français de la seconde moitié du vingtième siècle dont on peut dire que pesait sur lui la malédiction, c’est André Laude, qui est mort à force d’espoirs déçus, de trop de souffrances, de trop passions dévorantes …
La foi a déserté nos cœurs.
Elle a fait place à la terrifiante lucidité.
Mais la lucidité est plus amère que le plus pauvre pain.
Nous nous tenons au bord de l’aube, au bord de la nuit , nous écoutons les voix sourdes des camarades qui agonisent dans les prisons bâties par des mains d’hommes. Et nous creusons des labyrinthes pour parvenir jusqu’à eux, dénouer les haillons, déchirer les chaînes .
Révolté donc, à la manière de Jean Giono, et il aurait pu faire sienne la phrase de ce dernier : « Je suis révolté, et si la société a su annihiler en toi tes facultés de révolte, je suis révolté pour t’obliger à l’être ». Car s’il fustige la mollesse des hommes, leur lâcheté et leurs veuleries, c’est parce qu’il aspire à « une pureté de neige » et veut planter dans les « terres du verbe Amour /Toujours vierges… du maïs et des visages/ Des oiseaux et des chants.
A propos des poètes : Franz Kafka a écrit : « Les poètes tendent leurs mains vers les hommes, mais les hommes ne voient pas des mains amicales, ils voient des poings crispés visant leurs yeux et leur cœur » et c’est bien de ce malentendu- là qui a eu raison d’André Laude. Il aurait pu être amer, il aurait pu être désespéré : « Je connais toutes les blessures/ par leur noms. Toutes./je connais tous les déserts/lugubres tatoués de solitudes froides./ je connais l’amer jus des mots / la mer qui recule dans les poumons/ l’air peuplé d’agonies de visages/ Humains les visages. Humains. Mais j’avance racine et psaume. /J’avance et d’autres me suivent/Par ténèbres vers la clarté/ nous acheminons les lettres d’espoir des hommes. » Mais c’est d’amour qu’il parlait …
Oui, c’est bien un chant d’amour fraternel et d’espoir qui s’élève, malgré tout, à travers les clameurs et les cris de nombre de ses poèmes, un amour qui ne rendrait pas aveugle mais au contraire rendrait lucide. « Jusqu’à ce qu’apparaisse nimbé d’or et de pétales/ les pieds posés sur un globe de feu /l’Ange à trompette de justice et d’amour », combien de nuits l’a‑t-il attendu cet ange ? André Laude est un poète « voyant », un veilleur et un éveilleur. Il est sur une tour, d’où il domine l’histoire. C’est à lui qu’il appartient d’annoncer la venue du jour à la multitude des hommes plongée dans la nuit. « Veilleur, où en est la nuit ? Qu’en est-il de la nuit, Veilleur ? ». Cela ferait bien rire André Laude de se voir comparer au prophète Isaïe, lui, le mécréant et pourtant, qu’a –t‑il fait sinon attendre et espérer et annoncer une aube nouvelle ? S’il pensait , comme Thérèse d’Avila que « La vie n’est qu’une nuit à passer dans une mauvaise auberge », au point de mettre cette phrase au fronton d’un de ses recueils, il aura passé les milliers de nuit de sa vie à tremper sa plume, pas toujours dans du vin doux, en brulant la chandelle par les deux bouts, pour graver des vers aussi évidents que ceux-là, comme un rien de lumière dans la nuit :
Au nom d’un amour que la parole ne peut nommer
Je me suis dressé au-dessus du plais d’ordures
J’ai saigné pour la beauté de l’aventure
J’ai prétendu à l’étoile et à la vérité
J’ai eu froid faim J’ai rêvé dans les fers
Au nom d’un amour qui doit advenir
J’ai vécu en silence la misère des paysages où seul un enfant
Une petite fille de l’école des archives
Poussant devant elle un caillou de marelle :
Paradis et enfer
Donne le courage d’explorer le Présent , d’où surgit
Déjà l’Avenir, qui n’appartient à personne.
Oui, « un jour viendra, couleur d’orange », comme l’a écrit un autre poète que vous n’appréciez guère… En attendant, Monsieur Laude : Que la poésie vous garde