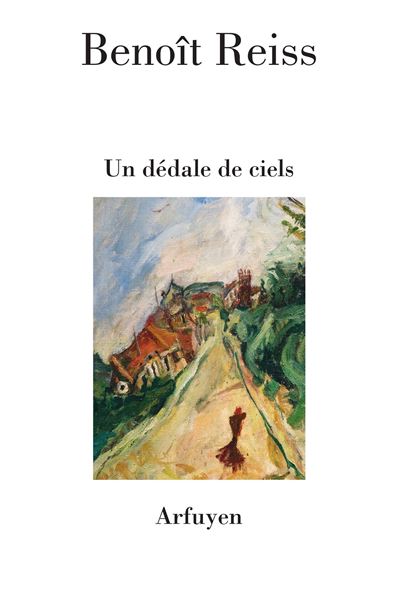Marie Cosnay, Eléphantesque
Eléphantesque entreprise que de chercher à apurer la dette de l’histoire envers la vérité. A plus forte raison au travers d’un de ses nombreux épisodes, inconnus, qui n’en contribuent pas moins au récit national, dans les marges, en repli. Le récit dont il est question ici implique directement son auteure, Marie Cosnay, au regard de sa propre mémoire à reconstruire, ainsi que celle de sa famille.

Marie Cosnay, Eléphantesque, éditions Cheyne, 128 pages, 19 €.
Puisqu’il concerne un cousin éloigné, résistant, maquisard, mort en 1945 à l’âge de 20 ans, arrêté et torturé par la gestapo, envoyé en camps d’internement et d’extermination en Allemagne, avant de revenir en France pour y mourir des suites de ses mauvais traitements. Comment plaider pour pareille cause sans la nourrir de ses simples affects ?
C’est sur des photos, des lettres et des procès-verbaux que le travail d’investigation de Marie Cosnay se fonde pour reconnaître et rendre hommage à cette légende filante que fut Marc Bourguedieu. Cette approche la contraint à un procédé de narration non linéaire, voire interactif, qu’on retrouve chez certains réalisateurs de cinéma. Est-ce la diversité désordonnée des éléments à disposition qui la conduisent à ce dispositif narratif ? « Eléphantesque énergie » quoi qu’il en soit pour retranscrire un passé qu’on veut s’approprier, où l’on n’existait pas encore, devant une liste de noms mêlant victimes et bourreaux (l’un d’eux s’appelle Couteau, ça ne s’invente pas). Il est nécessaire de polir les pièces du puzzle qui se sont altérées avec le temps avant de chercher à le former. Les acteurs de cette tragédie apparaissent peu à peu, avec leur fonction sociale, des traits psychologiques plus ou moins visibles sous des liens de cause à effet avec leurs choix idéologiques, leurs gestes si lourds de conséquences dans un tel contexte. Marie Cosnay est aidée par son frère et sa mère pour cette entreprise. Les lettres de Marc Bourguedieu, tantôt prisonnier, tantôt libéré mais hospitalisé, adressées à ses parents, extrait par extrait, phrase par phrase, locution par locution, passent par la voix de l’auteure qui les ressasse noir sur blanc, en émaille son « rapport d’investigation » avant de les livrer dans leur intégralité. Un choix formel qui force le lecteur à participer activement, à recontextualiser ces extraits, illuminés en italique, s’il veut ajuster son espace mental à celui de Marie Cosnay en fermentation. Elle, cherche le bon éclairage, en technicienne scénique, avant toute vérité. Sur le personnage principal d’abord, afin que ses paroles rapportées prennent sens, fassent monde dans un passé codifié et dévoilent les raisons qui l’ont mené à son combat. Même si « (…) il y a une pudeur » à dire les choses au plus juste (c’est là son combat à elle), « Une pudeur parce qu’on ne sait pas mettre ensemble tête brûlée, enfantillage, aventure de gosse avec ce qu’on n’a pas compris d’abord qu’il avait vécu, et puis on a compris », de profundis. L’auteure aborde les traits de caractère et de comportement de son cousin avec prudence car au scalpel, traque ses tropismes, le ressenti de ce qui l’aura guidé vers ses choix et ses actes. Elle voudrait faire sienne sa fierté, ou plutôt, celle précisément qui lui aura fait défaut, du fait de sa personnalité de jeune homme humble mais déterminé se construisant sur l’histoire en sa fabrique ; amoureux de la vie mais courant vers la mort, acteur jouant une seule représentation comme sa seule destinée possible. Il y a jusqu’au geste d’écriture de Marc que Marie Cosnay s’approprie (« sa façon de ponctuer ») lorsqu’elle recopie ses lettres. « J’ai gardé le verbe embrasser (dit-elle) transitif indirect comme c’est chez lui et comme c’est chez moi. Je vous embrasse à tous ». Elle met en perspective l’implication politique irréductible de Marc, indéfectible de son affection spontanée et authentique pour les siens. Elle l’annonce comme en slogan résumant son testament : « Craint non tant de revenir que d’expliquer ». Les parcours des héros morts trop vite, trop jeunes forcent admiration et respect. La mémoire n’est jamais figée et il n’est jamais trop tard pour faire ressurgir le passé dans le présent, remettre en cause la représentation officielle de l’histoire, l’historiographie, amnésique, lacunaire, pleine de raccourcis. Arrangeante ?
Les noms des lieux forment une cartographie digne de l’épopée d’un héros troyen, de Saint-Laurent de Médoc à Neuengamme, en passant par Bordeaux, Compiègne, Dachau, la Hollande, la frontière du Danemark. Les vestiges aussi voyagent, avant de se voir examiner, classer, archiver, de se laisser rendre au monde en son devoir de mémoire. Comment ne pas grandir plus vite que la normale devant certains événements ? Et surtout sans séquelles ? Ainsi, la taille physique de Marc est souvent évoquée dans le texte, à maintes reprises, comme un marqueur historique d’une vie trop courte, passée en trombe. Il n’atteindra jamais la majorité (pour l’époque) mais malgré tout cet âge d’homme qui se défend pour aboutir aux idées de sa place. On pense à Marc comme l’exact opposé du Lacombe Lucien de Louis Malle.
Eléphantesques, confiance en soi, probité, rectitude, sagesse, force d’âme et force morale, connaissance de soi qu’il aura atteintes alors, en menant sa guerre dans la guerre, en exploitant et instrumentalisant justement ses souffrances dans l’adversité et les horreurs de celle-ci de la façon la plus positive possible. Sens pratique de l’émancipation on dira (quand d’aucuns ne parleraient que de dignité), de l’élévation de sa conscience dans l’aventure de l’esprit humain.
Le ton est plus libre dans les dernières pages, en guise d’épilogue, tout au moins libéré de ses inflexions que trahit à juste titre une certaine émotion. Et comme en libération du poids de cette mémoire trouble, incertaine pour Marie Cosnay, avec ses aspérités et ses failles réduites par écrit. Parce qu’il aura fallu tout ce chemin pour que le souvenir puisse vivre. Et grandir enfin.
*
Benoît Reiss, Svetlana
Roman sous forme de longue prière désespérée et de confidence d’une narratrice qui, pour sauver son mari et son fils retenus dans les prisons du « Grand Commissariat », s’adresse à la jeune fille du tyran, Svetlana, aperçue aux actualités. Parole qu’on pourrait imaginer sous forme de lettre ou sur un support communicant précis mais aucun détail ne le laisse entendre. Svetlana est le symbole de la raison inséparable de la sensibilité qu’offre la jeunesse.

Benoît Reiss, Svetlana, éditions Cheyne, 2018, 128 pages, 19 €.
La narratrice le sait, elle qui reste tout le long du livre innomée, une citoyenne lambda. Elle qui tente de résister à la violence du système autoritariste, sans aucun doute marxiste-léniniste (« homme du peuple », « camarades », « Comité »).
De sa bouche même, le dispositif pour faire entendre sa parole s’appuie sur un conte populaire qu’elle immisce en exergue dans les premières pages. Sa parole optimise son effet communicant, s’incarne, se matérialise en tissant alors un fil jusqu’à la fille du tyran, afin qu’elle seule l’entende. Son tutoiement à l’adresse de l’enfant est aussi bien celui employé à une déesse de miséricorde. Les (soi-disant) fautes de ses fils et mari, respectivement « Danya et Grisha entrés dans la nuit qui ne prend rien », apparaissent à la toute fin du livre. Elles en sont la cause mais pas le propos fondateur, faisant écho à l’absurdité à son paroxysme que Kafka dénonçait dans son Procès. L’histoire ici n’est que prétexte à une parole tangible, réifiée, destinée comme dans le conte en question à sauver une vie. « Le fil que je lance vers toi n’est pas une parole ordinaire (…) le fil de mes mots, je le sens qui s’échappe entre mes doigts, glisse hors du lit, il est si fin qu’il passe sous la porte » insiste la narratrice dont le but est de se frayer un chemin vers sa réceptrice dans un monde où chacun se surveille mutuellement. De quoi sombrer dans la paranoïa au point de l’affirmer sans pudeur (« Dans quel état ils m’ont mise – ceux-là avec leurs oreilles et leurs yeux faufilés partout ? »). Ce pour quoi la parole est double, duelle ; et ainsi susceptible d’instrumentalisation. « Chaque parole prononcée est saisie et détournée, chaque parole finit par se retrouver dans la pièce où ils travaillent et où ils décident ». L’enjeu principal de cette voix réside dans son inflexion. La narratrice remet en cause le système totalitaire de manière subtile, au travers de ce qui peut paraître comme de simples failles. D’une part, culte de la personnalité oblige, elle flatte le tyran, à la fois père de Svetlana et de la nation : « Père est bon, il est généreux et juste… Dis-lui que Danya et Grisha sont d’honnêtes travailleurs. Ils suivent toujours les ordres du Parti, sans jamais rechigner », d’autre part, elle crée une parabole à rebours en identifiant clairement, selon les contestations plus ou moins avouées de tout un peuple, le Grand Commissariat aux contes issus de la mythologie slave croque-mitaine (la fameuse « maison sur pattes de volaille ») ; en référence donc à des racines culturelles ancrées définissant le mal. Quoi de mieux pour atteindre l’esprit d’une jeune enfant. Mais sa vraie arme (secrète) consiste à redéfinir le sens de la liberté par un hymne à la vie, à sa beauté puisée dans la nature créatrice (résistant à tout système) et ses plus simples éléments avec leurs nuances, leurs couleurs et leurs formes. Comme pour faire admettre qu’il est un luxe de continuer de s’étonner de tout, du début à la fin de sa vie ; jusqu’à « l’horizon de nuit » perceptible du haut de l’immeuble qu’il est interdit de franchir suscitant une défaut de comportement du jeune Danya autrefois, dont le sens épris de liberté est mis en parallèle avec celui supposé de Svetlana, constante irréductible chez l’être humain. Un livre confidence où nombres de détails apparaissent sur la vie intime de l’auteure de cet appel à la clémence. Qu’il se fasse l’écho d’une « pensée-grain », d’une « pensée-pierre », il est marqué avant tout d’une pensée-refuge qui s’évade pour conquérir la sensibilité d’une petite fille dont le prénom rime avec Sainte-Rita (qui peut donc beaucoup). Ce livre d’un seul souffle se lit d’une seule traite, et tisse son cri vers toi, lectrice, lecteur : un cri silencieux. Toi pour qui langage rime avec liberté, toi qui as désormais le pouvoir de Svetlana.
- Florence Trocmé, P’tit bonhomme de chemin - 31 octobre 2021
- Jean-Claude Leroy, ÇA contre ÇA - 25 septembre 2019
- Marie Cosnay, Eléphantesque, Benoît Reiss, Svetlana - 1 avril 2019
- Les carnets d’Eucharis (portraits de poètes vol. 2) - 5 novembre 2018
- Mérédith Le Dez,Cavalier Seul - 5 mai 2018
- Géraldine GEAY, Les Immaudits - 26 avril 2017