Nimrod, Petit éloge de la lumière nature
Depuis Saint-John Perse, on sait ce que recouvre ce terme d’éloge, genre poétique qui relevait autrefois de la louange et du chant funèbre, revisité par la modernité (Pierre Oster, René Char, Guy Goffette…), revivifié par l’enfance, cet âge d’or élevé au rang de mythe où se revit le temps non séparé. Le poète Nimrod s’approprie le genre à sa manière dans un recueil salué en 2020 par le prix Apollinaire.
Une blessure « originelle », « abyssale », ouvre le recueil : la perte de la langue maternelle, la langue kim parlée par une peuplade minoritaire au sud du Tchad, pays natal de Nimrod. Double exil pour le poète car il s’agit pour lui d’une langue doublement interdite : langue orale trop rare pour lui permettre la transmission et langue trop écrite (car biblique) pour la littérature perçue comme un blasphème par la rigoriste religion protestante.
/…/
je suis nu et j’ai froid
interdit en moi-même
comme une bille qu’on débite.
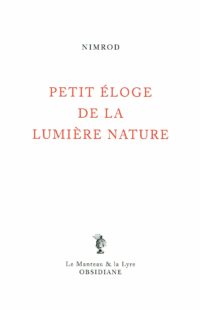
Nimrod, Petit éloge de la lumière nature, Le Manteau & la Lyre Obsidiane, 2020, diffusion Les Belles Lettres, 110 pages, 14 euros.
Désormais le cœur offrande n’ira plus « aux dieux mais à la patrie sans rivages où piano marchent les filles. »
Plusieurs périodes rythment ce recueil rassemblé en cinq mouvements sous un titre rimbaldien (cf. l’exergue, l’éloge consistant aussi à dire ce que l’on doit à qui.) La lumière salvatrice qui nourrit les poèmes témoigne d’un rapport sensible au monde et à ses éléments. Arpenteuse, voyageuse, elle unit tout : la joie, la tristesse, les époques, de l’enfance à aujourd’hui, les espaces, de l’Afrique à l’Europe (Tchad, Côte d’Ivoire, France), les régions, de la Normandie à l’Ardèche, les paysages, sables et forêts, villes et campagnes, la végétation, baobabs, rôniers, acacias et châtaigniers… Qu’y a-t-il de changé ? Au bord de la Seine, « L’air et la lumière sont les mêmes en dépit de la sécheresse qui prévaut dans mon pays. »
Des textes en prose se mêlent aux poèmes, des vocables rares aux accents persiens tels ces « oiseaux allusifs » voisinent avec des mots plus quotidiens, certains à la pointe amusée, d’autres ouvertement critiques sur l’état du monde. L’éloge, qui est le genre de la libre revivification, permet de vivre l’écart entre ailleurs et ici, entre hier et maintenant, entre le oui et le non et, s’il ne le comble pas, il en révèle la pleine étendue, une « illusion ou intuition qu’on se fait après coup des matières mythiques, volubiles. »
La nature, de toujours, est un refuge pour le poète, un immense « réservoir d’amour » qui lui permet de « Marcher toujours au plus intime du voyage », le poète, comme le puits pour la lune, étant « sa chambre d’échos ». Avec elle, le monde lui est rendu en ami souverain. Consolatrice, rassurante lorsque tangue le navire, elle détourne des « jérémiades », du « goût de la plainte ». C’est elle la langue mère, nourricière, qui embarque l’homme et l’enfant dans ses voiles.
/…/
Je barre vers la lumière
Convaincu de bâtir
Avec un matériau chaotique.
Entre exil et nostalgie, la quête de l’enfance est celle d’un âge à jamais perdu, perte du « vrai lieu » que le poète n’a de cesse de retrouver dans ses pérégrinations : « Certains jours de flânerie, mon enfance remonte par des chemins entravés. »
Malgré cette détresse fondatrice, le poète se tient toujours « au matin du monde », son enfance lui est « sans cesse redonnée avec sa rasade de soleil » car partout son amour le devance, écrit-il. Tel est le pouvoir de la création, salut spirituel au monde et à la vie, capable de réinventer les mondes avec leurs flots de sensations, leur présence ineffable, inépuisable, à jamais réactivée par le pouvoir des mots-lumières.
Qui dit éloge dit retour aux origines, à l’origine, dans un élan qui porte et magnifie. Tension entre fulgurances et silences, permanence et immanence, néant et communion, effacement et célébration, la lumière-poésie donne à voir un monde lointain et proche à la fois. « Je t’ai attendue et tu es venue, tempérance du temps, amertume qui enfin prends eau ». Tous sens et éléments convoqués, le poète, « nu au seuil le soir », se situe au croisement de l’élémentaire et du vivant. Il porte une attention aiguë à ce qui l’entoure, fleuve, arbres ou insectes. Son souffle est celui de l’émerveillement. Ainsi la rose peut-elle réunir sous une même épitaphe le père disparu et son fils qui pense à sa future fin.
Et ce rêve de fleurs sur la tombe disparue
Fleurs séchées leur absence persistante
Et moi qui refuse l’évidence
D’un rêve de fleurs sur la tombe disparue.
Rien d’antique ou de funèbre dans cet éloge. Il ne s’agit pas de pleurer le monde perdu mais de le ressusciter, de le revivifier au contact du présent, quelles que soient ses réalités, agréables ou douloureuses. La poésie, nourrie de pertes et d’acquis, connaît, comme la lumière, l’ombre de la mort. Elle est le lien qui dure entre les morts et les vivants, tout le vivant. Et c’est ce qui rend l’éloge si attachant : cette superposition de l’enfant et de l’adulte dans un même lieu, une même sensation comme si le temps magicien mêlait ses êtres, ses chemins, ses lumières dans une même alliance « pourpre et or ».
Mon cœur d’adulte arpente mon cœur d’enfant comme si le second était le père du premier – son guide, son proche parent.
Rutilances et chatoiements, Nimrod écrit une langue sensitive ciselée aux éclats diamantins. Une noblesse intérieure, toute princière, s’allie à une douceur de regard, à un cœur de bois tendre qui se sait proche du gouffre. Rien de grandiloquent dans son éloge – l’emphase serait un risque car le fleuve est « toujours en excès sur les mots » – mais un lyrisme désirant allié à une prosodie libre, aux notes incantatoires, une distance bienfaisante qui permet l’accord.
/…/
par la parole la vue le toucher
j’espère la beauté
sa trace au fond de moi
une âme à la remorque du soleil.
