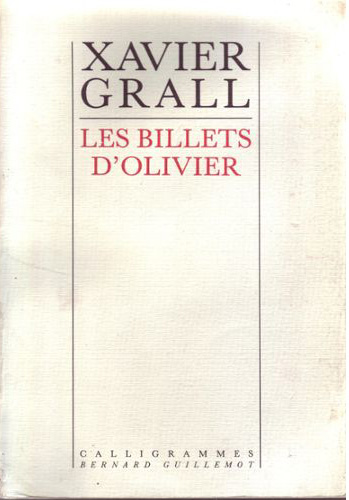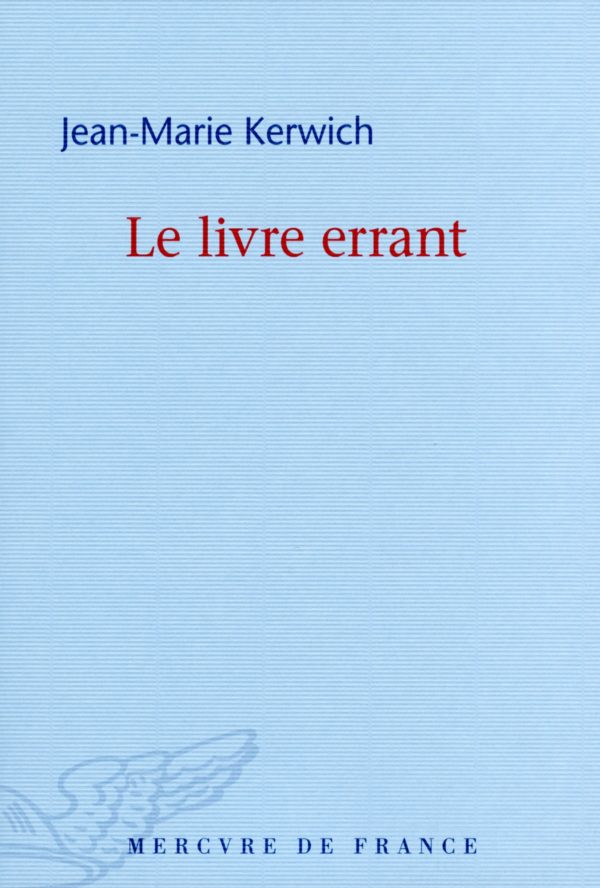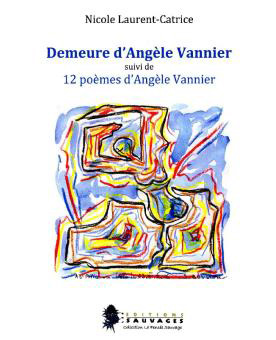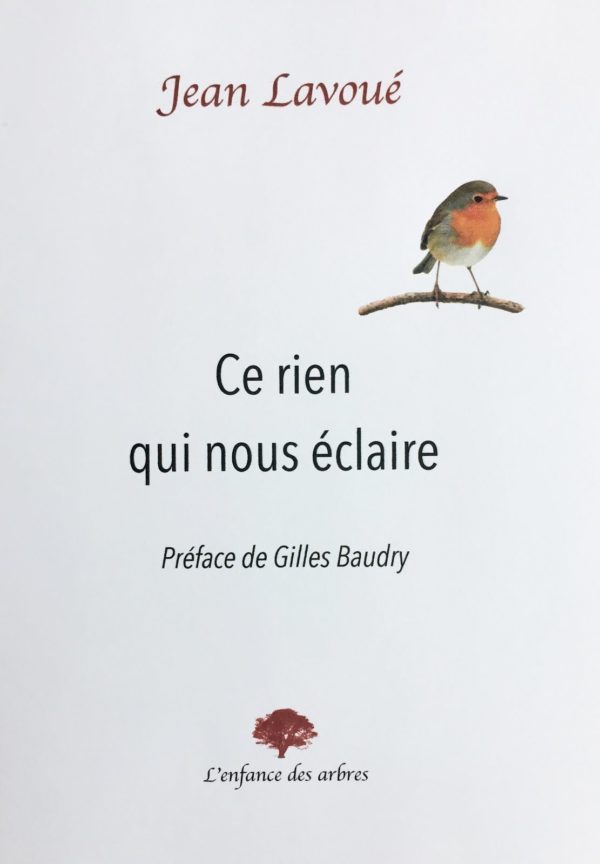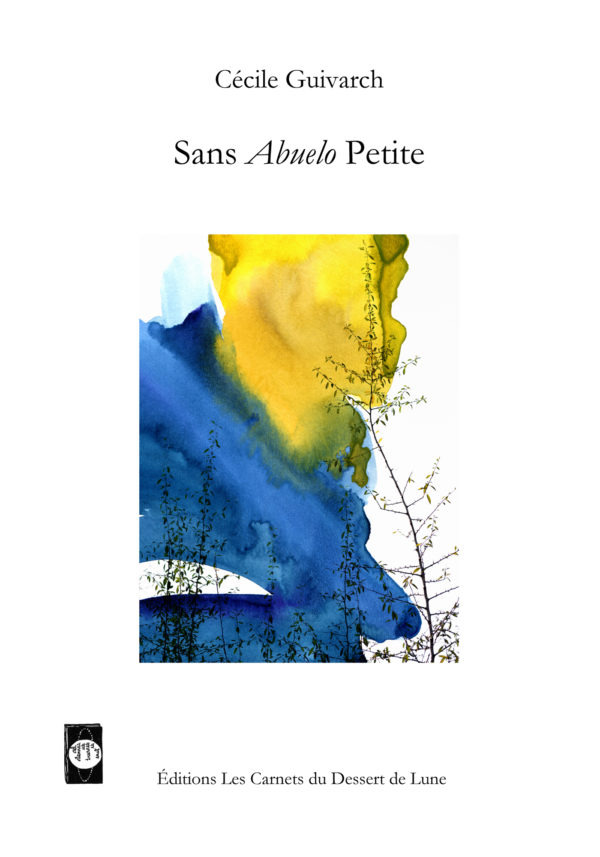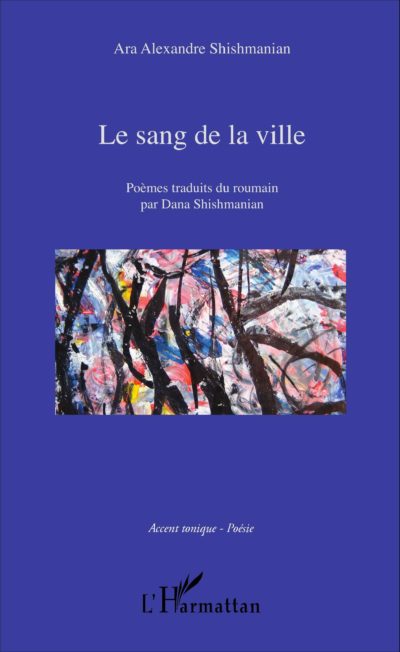Un chêne
A peine avais-tu fui qu’un chêne te stoppa net. Son cœur était ouvert, luisant d’une blancheur de chair noueuse, de fibres déchirées. Il suintait à grosses gouttes. Sublime. Obscène. Son écorce craquelée de toutes parts disparaissait presque à vue d’œil.
C’était grand jour de fête au village. À chaque coin du parc, ça tirait, pétaradait, s’interpellait. Ça sentait partout la satisfaction du devoir accompli s’octroyant au soleil un peu de bon temps. Visiblement à l’aise, ton père, visage gonflé à l’extrême, paradait, notabilité oblige, de stand en stand, de petit verre de blanc en petit verre de rouge. Sans ta mère. Sans toi. Sans ton frère ni ta sœur. Il vous avait déjà tous condamnés, au grand jour, à l’isolement le plus absolu.
Un ring avait été disposé au beau milieu de l’étang ‒ ce qui obligeait les catcheurs à prendre une barque pour l’atteindre. Dès qu’ils y entraient, chacun tentait de déséquilibrer l’autre pour le faire tomber dans l’eau. Ah, que c’était drôle.
Entre les cordes, toutes raclées, chutes, éructations semblaient assourdies par la souveraine indifférence du plus haut des cieux. Sur la rive, l’écœurante odeur d’herbe fraîche coupée, piétinée, trempée de graisse et de suie, occupait tout l’espace. Frites et côtelettes à gogo. Haut-parleurs crépitants, têtes de Turcs abattues entre deux rires et tout le tintouin... Chercher la mort sans jamais la trouver.
Aux premiers tremblements, tu compris que cela commençait à t’envahir. Il te fallut alors décamper au plus vite, rompre avec éclat toutes les barrières sur ton passage, rejoindre une trouée où cacher tes trésors de guerre, où trouver en plein bois le repos.
Le chêne s’avançait vers toi à l’aveugle. Qui aurait pu l’esquiver ? Il régnait ‒ magnifiquement, douloureusement ‒ avec toi seul pour témoin. Malade, pustuleux, il jetait ses ultimes forces dans ces instants solennels. Alentour, plus un souffle de vent. Plus le moindre bruissement d’insecte. Un silence. Obstiné.
Et c’est là. C’est là que tu t’es senti pour la première fois regardé, écouté ; c’est là que tu as cru, comme si c’était la dernière fois, regarder, écouter ce qui ne peut se voir, se dire, s’épeler.
Pourquoi as-tu toujours pensé que ce chêne ‒ depuis longtemps coupé sans doute, jeté au feu ‒ t’avait sauvé la vie ?
Profession solennelle
À Marguerite Baudry
In memoriam
I
Tout était fait pour que cette cérémonie fût l’acmé de cette kyrielle de minutes insoutenables que t’avait réservées cette année-là. Chaleur poisseuse, promiscuité, soumission mécanique aux rituels en vigueur, obéissance aveugle à des ordres venus d’en haut devant lesquels systématiquement tu te cabrais. Mais tout arrive. Quelques jours plus tôt dans une sacristie, un frère, votre instituteur, vous avait affirmé comme la chose la plus naturelle au monde : « Lorsque le prêtre étend les bras sur le pain et le vin, il fait un miracle. » Il n’y avait pas à en douter, et toi qui alors doutais de tout jusqu’à la nausée, tu avais tressailli ; en tes entrailles cela prit force d’évidence, quoi qu’il dût arriver. Ce n’était déjà plus toi qui vivais.
Les jours suivants, on te trouva étrangement doux, affable, angélique…Ce dont surtout tu te souviens, c’est de ta crainte à devoir passer par ce moment dont tu pressentais qu’il allait être unique ‒ le seul depuis longtemps que tu n’aurais pas à faire tomber dans l’oubli.
Quelque chose, néanmoins, eût pu tout gâcher, et à jamais : le récit de la vie de Jésus par un autre frère, estropié lors d’on ne sait quelle guerre, capable de tenir en haleine une salle bondée de jeunes turbulents, à peine sortis de l’enfance. Dans cette même salle, vous aviez vu l’avant-veille un de ces films franchouillards auxquels vous conviait l’école, et le contraste était saisissant.
Le mime de la passion te parut durer des heures.
À la fin de chaque station, ponctuée par le choc de sa jambe de bois sur le parquet, le frère suppliait de ne surtout pas l’applaudir, quoi que vous en eussiez. De part et d’autre des rangées, il guettait cependant les signes d’acquiescement réprimés à chacun de ses foudroyants triomphes.
Fallait-il en passer par là pour vous faire prendre conscience que ce récit était bien en dessous de la réalité, que la passion que ce naïf histrion essayait de rendre sensible à vous autres gamins ‒ tout pénétrés d’histoires de cow-boys et d’Indiens ‒ était la porte étroite de la vérité ? Il le fallait, au moins pour toi. Et depuis lors tu n’as jamais pu lire, écouter, prier les douze stations sans que te reviennent aussitôt les expressions grotesques, tragiquement grotesques, qui les entourèrent. Le Christ pouvait commencer à vivre en toi.
II
Cortège interminable de cierges. Amas de blancheurs amidonnées. Chants de joie véhémente. Perles de sueur en cascade. Parfums de lis et de cire mêlés. Haut-le-cœur. Hoquets.
L’évêque t’appela par ton nom. D’un pas somnambulique tu t’avanças et offris ton cierge « comme pour confier à l’Église », était-il annoncé, « ma foi encore fragile ». « Fragile » ? « Fragile » ? Non ; seulement, à l’heure de l’affirmer aux yeux de tous, tu tremblais de te voir déjà happé par ce que supposait impliquer cette foi : une entrée dans l’inconnu tellement désirée, mais inséparable de l’adhésion au monde adulte que tu défiais par de constantes attaques en sous-main.
En ce magnifique dimanche de mai, l’église n’avait jamais été aussi comble, et toi jamais aussi pleinement seul. Comme si le monde entier, sous le regard du Christ, t’accordait définitivement de vivre en solitaire le long combat qu’il te restait à mener contre les forces de mort qui, de nuit comme de jour, ne manqueraient pas – et n’ont pas manqué – de t’assaillir.
Tu appris alors que ce point dans l’univers auquel tu te résumes est aimé par bien plus haut, bien plus large que l’univers lui-même. Que tu t’assoies ou que tu te lèves, le Christ en gloire pénètre tes pensées, envahit ta chair, sonde tes os. Ce n’est plus seulement toi qui vis.
Une main qui t’est infiniment chère t’offrit sur le parvis ce que tu avais demandé : une bible. Elle est toujours là.
La récitation
À Christophe Langlois
Il s’en est fallu de peu. De vraiment peu : expulser C’est un large buffet de tes lèvres. Cependant, avec ta langue collée à ton palais puis à tes dents de devant cerclées de fil de fer, cet effort apparaissait tellement démesuré. La suite s’enchaîna, fluide, et de la plus belle des manières visiblement :
… sculpté ; le chêne sombre,
Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ;
Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre
Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants…
Tu avais trouvé la voie. Plus rien ne serait comme avant.
Dès la fin de la première strophe, il se fit un silence dans la classe. Tous écarquillèrent les yeux, les tournèrent vers les tiens, comme s’il était clair soudain que tu avais uniquement vécu jusqu’alors pour être à la hauteur de ces quelques minutes. Comme si se jouait là ton destin. Tu ne dominais rien, même pas ta voix. Timbre grave, plus grave que jamais, accordée à tes cordes vocales cassées depuis six mois déjà, scellant ta mise à l’écart du chœur des anges. Mais le frère instituteur – encore lui ‒ t’avait désigné. Avec autorité, son regard te confirmait qu’ici plus qu’ailleurs tu étais à ta place.
De la première à la dernière seconde, le frère, dans son enseignement, offrait sa vie à ses élèves ‒ qui n’en demandaient pas tant. Rêvasser, siffloter, échanger des niaiseries en aparté, lancer ni vu ni connu des boulettes en papier aux premiers rangs, stopper en songe un tir splendide, faire nonchalamment crisser ses billes au fond de ses poches, tout, pour tuer le temps, semblait permis.
Naturellement, tu étais le pire des élèves. Je ne dis pas cela pour te flatter, pour honorer je ne sais quel héroïsme à rebours dont tu aurais été le parangon. Mais il est vrai que, par principe, par esprit de résistance à tout et à n’importe quoi, tu en faisais avec un soin rare le strict minimum. Et sans doute tes ficelles se révélaient-elles trop grosses car tes maîtres, chaque année, te repêchaient au nom d’une bienveillance que tu te glorifiais de vomir, toi qui ne souhaitais rien tant que l’on te passât par-dessus bord, et vite. Le frère t’avait, sans en avoir l’air, percé à jour. Il avait deviné combien âpres, humiliantes, ruineuses, pouvaient être tes journées posé là, à distance respectueuse de ce qu’il expliquait au tableau comme des réponses de tes camarades. Irais-je jusqu’à dire qu’il t’admirait ? En tout cas, il devait estimer l’endurance du petit gars tenant tête ainsi au monde entier.
À la fin, tu n’as pas eu le réflexe de t’asseoir aussitôt. Un silence étrange – attentif – s’était installé une fois récité
… et tu bruis
Quand s’ouvrent tes grandes portes noires.
Les yeux bleus profonds du maître se plissèrent légèrement, son visage s’illumina. Ce que tu essayais de cacher – il l’avait compris – n’était pas vain. C’était ce papillon qui partout cherchait une issue dans l’angoisse de ne pas mourir à l’air libre.