Fil de lecture de Carole Mesrobian : Autour de Tristan Felix, Laura Vazquez, France Burghelle Rey, Collectif de l’Atelier du Bocage.
Autour de Tristan Felix, Laura Vazquez, France Burghelle Rey, Collectif de l’Atelier du Bocage.
Un appareil paratextuel qui soutient l’univers sémantique dessiné par le titre du recueil, Sorts : la couverture de ce petit livre, en noir et blanc, propose une illustration qui donne à voir l’au-delà d’une réalité appréhendée par l’artiste peintre Isabelle Clément. Travail sur la matière et restitution d’une émotion, les paysages peints révèlent la respiration de ce que recèle une nature dont le support est saisi dans son immanence. La quatrième de couverture propose un extrait du texte liminaire :
« Jette-toi du haut qui penche
à six faces débraillées
Mets bas ton ciel criblé d’oiseaux
L’inepte féérie compte sur les osselets
Pour saisir l’identique sous l’autre
Quel sort cueille quoi de rare ?
Son coup sonne au cou du condamné
Il n’en rit qu’à la pointe des pieds
Qu’il a de boue tiède oints
Pour s’absenter
Du sol »
La langue de Tristan Félix ne peut être autrement illustrée que par ce morceau tiré du tout premier texte du recueil. Un emploi syntaxique déstructuré qui permet au poète de mettre en exergue les signifiants, de secouer le sens protocolaire des mots et de créer un univers fait d’images et rythmé par des assonances et des allitérations. L’espace scripto visuel est lui aussi mis à contribution dans la création de cet univers poétique inédit. Et le propos de l’artiste est merveilleusement servi par ces dispositifs, car en effet le rythme ainsi créé et l’emploi d’un vocabulaire dont les acceptions usuelles sont malmenées par le travail syntaxique sont de nature à rendre compte de cette perpétuelle posture à la marge d’exister. L’énonciateur propose une vision au vitriol du réel, et prend la parole au nom d’une humanité portée par l’emploi des pronoms personnels.
« vous tous autant que nuls
êtes invités à
coucher sur bitume :
soi ou l’autre
qualité
suture
matricule
profil bas
se rendre au grand hachoir
sa viande en sac
doigt sur couture
fuite inutile. Stop.
et sur le pont de corde
à bout d’abîme
l’homme cousu attend
sa danseuse araignée qui l’étourdira »
L’évocation de la mort qui sous tend nombre de textes jouxte le constat d’une impuissance à conjurer le sort auquel est soumis l’être humain que rien ne semble pouvoir mener vers un avenir fait d’espoir.
« il fait lent la rame
à trace de l’eau
ont-ils sué les moines à tirer
à tisser la nappe visqueuse
sous leurs genoux !
désormais la toile
aventure ses accrocs
parmi notre temps
enfin dévasté
Marais V »
Clos par des groupes nominaux en italique qui initient un emploi tout à fait inédit de l’appareil tutélaire, la plupart des poèmes de Tristan Félix énoncent ainsi le sort inéluctable d’une humanité soumise à la fatalité d’exister. Mais les propos de l’auteure ne se bornent pas à passer en revue les affres existentielles de ses semblables. La présence du poète ponctue le recueil, qu’il s’agisse de saisir quelques bribes d’éléments biographiques ou bien de l’énonciation de la posture de l’artiste. L’écriture y apparaît comme un moyen d’opérer une rédemption plus individuelle que collective.
« il se balancera à dos d’homme
il sera facétie
il peindra la terre avec ses cheveux
blancs
il se cassera le nez contre la
transparence
il se videra de sa boue
pour atteindre les sorts
Goudron
(du Petit Théâtre des Pendus) »
Le poète apparaît ici comme étant celui qui est apte à montrer l’au-delà des évidences, et à guider les autres. L’emploi du futur et l’évocation d’une sagesse amenée par la vieillesse évoquée par le couleur d’une chevelure à la blancheur emblématique confèrent au discours poétique et à celui qui l’énonce le pouvoir quasi magique de révéler l’au-delà des apparences afin de restituer à ses semblables la limpidité d’un avenir lumineux. Et le verbe de Tristan Felix opère d’ores et déjà cette mutation du métal présent dans notre réalité pesante en un or offert par les visions sans concession mais salvatrices de sa poésie.
Tristan Felix, Sorts, La Main aux poètes, Editions Henry, Montreuil-sur-Mer, 2014, 94 pages, 8 euros.
*
Un livre dont la couverture ainsi que la typographie qui y est apposée déploient une évidente sobriété. Le corps des lettres respecte l’espace bleu roi qui offre un écrin délicat aux textes justifiés, déposés sur un papier épais qu’une trame crème entoure chaleureusement. L’horizon d’attente se veut ainsi placé sous les auspices d’une poésie amenée sous l’égide du classicisme. Mais déjà à feuilleter le recueil l’aspect non conforme à une métrique régulière et les jeux que promet la disposition des vers sur l’aire scripto visuelle créent une dichotomie que corrobore le message présent dès le titre : La main de la main. Cette redondance du substantif revêt l’apparence sémantique d’une tautologie mais elle n’en est pas moins annonciatrice de la poétique de Laura Vazquez : il s’agit bien de révéler le dedans du dedans, d’aller au fond d’une réalité montrée dans son quotidien le plus banal. Cette poésie servie par un emploi sémantique et syntaxique tout à faut protocolaire n’en offre pas moins une vision symbolique et inspirée des tableaux de l’existence. Ainsi au fil des textes se révèle une écriture dont la modernité n’est pas uniquement dévolue à un emploi inédit de la langue. Le verbe du poète employé de la manière la plus littérale qui soit et maintenu dans sa fonction référentielle n’en offre pas moins une poésie puissante et qui ouvre les horizons du signe et surtout ceux d’une appréhension mystique du réel.
« Ecoute-moi
J’ai plié ma langue, comme je sais le faire.
Alors les molécules ont fait leurs petits pas.
Des géomètres ont tracé plusieurs lignes sur ma figure.
J’attends l’armée des fourmis.
Ecoute ce que tu dois me dire.
Que ta parole soit grosse et répétitive.
Qu’elle soit très lourde et qu’elle colle.
Qu’elle soit lourde
comme le beurre frais,
comme le bain trop chaud.
Que le soleil s’en aille au milieu du ciel et qu’il reste
En place des mois et des mois et des années, des siècles.
Alors les petites plaies
font les petites croutes
et le soleil reste au milieu du ciel.
Alors les soldats lui jettent des pierres
et rien ne bouge
jamais.»
L’énonciateur est présent aux propos grâce à l’emploi du pronom personnel de la première personne. L’organisation rythmique et les récurrences phoniques et syntaxiques confèrent à l’aspect formel de l’énoncé un caractère mystique. Le langage maintenu dans sa fonction référentielle permet la juxtaposition de tableaux dont la confrontation révèle les perceptions du locuteur grâce la création d’images poétiques.
« Apportez-moi une chaise,
un bout de pain et un livre,
apportez-moi l’ordinateur
et l’alphabet de la langue des signes,
apportez-moi une boite de bois
pour que je me lève,
pour que j’écrive,
pour que je commence . »
La langue des signes semble être celle que décrypte le poète qui sait ouvrir à une dimension cachée du réel, source d’une écriture toute métaphorique. La reprise anaphorique structure la plupart des textes, et l’emploi des pronoms leur confère une dimension incantatoire. La prière de Laura Vazquez sera exaucée, car écrire fut fait et continue pour le plus grand bonheur de ceux auxquels elle offre ses vers. Et au fil des pages de son recueil elle propose une lecture de l’existence qui confère à chacune de ses visions un caractère mystique.
« Comme les choses invisibles
Comme nous avalons notre salive
au réveil.
Comme nous sentons le goût du sang
dans les verres d’eau.
Comme nous vivons dans cet ordre.
Je te parle. »
Laura Vazquez, La Main de la main, Cheyne Editeur, Le Chambon-sur-Lignon, 2014, 57 pages, 16 euros.
*
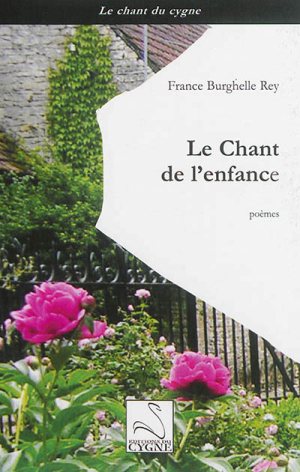
Un si joli recueil, paru aux Editions du Cygne, et dont la couverture printanière opère un ravissement tel que l’envie de découvrir les textes de France Burghelle Rey s’impose. D’autant que le titre souffle un vent enchanteur sur les massifs de fleurs qui illustrent la couverture. Le Chant de l’enfance s’annonce donc comme un hymne à la vie, au rythme doux et lent qui mène l’être vers demain avec cet évident et inévitable cheminement qui est ici associé à celui incontournable de la nature. L’allusion au chant présente dans le titre, Le Chant de l’enfance, n’est de surcroît pas sans évoquer la veine lyrique, et le lecteur s’attend à une poésie de l’intimité et de l’effusion, des réminiscences énoncées sur le ton de la confidence. Cet horizon d’attente se voit confirmé dès le texte liminaire :
« Perdre son temps à réunir des bribes
ruines de nids de nous
qui sommes oiseaux de cage en cage
Je versifie comme au temps des cerises mon nom de Venise
Voler chaque saison de
souvenirs en souvenirs seul
J’interroge ma vie heure après heure déchiré par
les à-dieu qui dorment en mémoire
Je versifie le chant de mon enfance perdue
autant d’amis me manquent
Que sont-ils devenus ?
En canon chantent leur peine et la mienne »
Invitant le lecteur à entrer in medias res dans son univers le poète se tourne vers son passé. Mais il ne faudrait pas passer outre les références qui émaillent ce tout premier texte : Marguerite Duras évoque une modernité qui côtoie la poésie lyrique dont Rutebeuf a été l’un des tout premiers chantres. Complainte donc dévolue à un syncrétisme générique et temporel, le rythme est donné d’une allure lyrique certes mais aussi d’une parole réflexive sur la nature de la création ainsi que sur la parole poétique. C’est ce qu’annonce l’épigraphe :
« Je cherche pour le temps le chant qui vaille
Philippe Delaveau »
Et nous savons combien ce poète a accordé d’importance à la musicalité du poème, à son ancrage avec une tradition qu’il s’est agi de reprendre sans jamais l’imiter, mais en ayant assimilé ses formes au service d’une poésie qui mène à la révélation d’une immanence. C’est bien à cet objectif que France Burghelle Rey soumet son verbe. Dans une langue tout à fait classique, qui ne soumet ni la syntaxe ni l’emploi sémantique protocolaire du signe à une distorsion quelconque, elle parvient à mener le lecteur vers une révélation sans cesse renouvelée : celle du temps qui passe, thématique classique s’il en est, mais dont l’écoulement est accepté dans la sérénité, car il s’agit bien de l’évocation d’un parcours initiatique, où les épreuves, évoquées dans la plupart des textes du recueil, ont opéré une métamorphose :
« J’avais si peur de la musique
mon souffle était coupé
J’avais si peur de la musique mes mots
Sans leur rythme étaient mort-nés
Il fallait vivre des autres
mon émotion mariée à mes amours
Il fallait vivre des autres mes mots
veufs de leur langue pleurée
D’enfants de mes enfants ma joie
a accouché mon émotion
c’est ma naissance à la vieillesse
mariée à leur beauté »
Cette maturité est celle d’une écriture qui magnifie le passage du temps. L’expérience soutient et façonne l’invention d’une poétique qui prend matière dans le réel. Le chant devient alors celui d’une sérénité et d’une sagesse qui mène au seuil de la contemplation. Et le poète invite le lecteur à trouver en lui cette source de paix.
« Si las des adieux
sentir l’odeur du lilas
amoureux des oiseaux leurs miettes
semées par des doigts de fée
Je n’ai plus envie de m’enfuir
Ma terre est le chant le présent mon espoir
Ne plus attendre l’aube mais
aimer la pluie sans craindre l’orage
l’ami des cœurs à prendre
Tu frissonnes fiévreux
reviens sur tes pas pour
prendre le lilas dans tes bras »
France Burghelle Rey, Le Chant de l’enfance, Le Chant du Cygne, Editions du Cygne, Paris, 2015, 57 pages, 10 euros.
*

Le Collectif de l’Ateliers du Bocage propose, sous l’égide d’un syncrétisme artistique, un ouvrage servi par Cécile Beaupère pour les dessins, Jeanne Robert pour les danses, Mary Géra pour les textes et Emmanuel Spassoff pour la photographie. Le titre, d’être plus que nu, est apposé au dessus d’une des photographies de ce dernier en noir et blanc qui donne à voir le bas d’un corps dont la nudité est mise en scène dans le décor de l’atelier. Une épigraphe d’œuvre annonce déjà la teneur du propos :
« Un livre doit être la hache
pour la mer gelée en nous.
Franz Kafka »
Le recueil est donc placé sous las auspice de cet auteur dont l’œuvre est encore perçue comme étant celle de l’homme soumis à une modernité dévastatrice. Les propos que le lecteur s’attend à trouver au fil des pages prennent une couleur toute particulière. Le texte liminaire, tout en faisant allusion à Gustave Courbet qui osa montrer le corps nu d’une femme dans son expression la plus crue, et par là même la référence au réalisme dont il fut l’un des représentants, pose les prolégomènes de ce qui va suivre :
« D’être plus que nu
Et offrir à l’autre
De porter son regard
Sur l’origine du monde
De plonger ses yeux en dedans »
Ce texte, qui fait face à la photographie qui figure également sur la couverture, propose de porter le regard plus loin que la vision de la nudité. Se fait jour le questionnement présent aux propos et qui guide les œuvres et les poèmes qui suivent : qu’est-ce que la nudité, et comment regarder le corps comme vecteur d’une transcendance qu’il s’agit de révéler grâce à l’art :
« Travailler sur soi jusqu’à l’évanouissement
Ne plus voir que sa peauUn point écrasant le cœur
Obligeant sa main
A s’éloigner pour voir l’autre
Creusant aux entrailles de soi
L’entre-cuisses brûlée de fusain
Des mains couvertes de peinture
Sortant des enfers
Derrière le rideau
Le mystère pourrait bien
Entrer dans ton ventre
Comme un coup »
Cette méditation sur la nudité est le support d’un discours sur l’essence même de la représentation. Le syncrétisme artistique à l’œuvre ici permet de multiplier les approches sur la thématique qui sert de fil directeur à l’ouvrage. Les fusains et les dessins, hymnes au mouvement et à la vie, d’une rare force, viennent dire le hors cadre des clichés d’Emmanuel Spassoff. Celui-ci propose de multiples clichés qui mettent en scène et dévoilent la nudité de son modèle. Le travail de répétition produit une continuité qui permet de créer une histoire où chacun peut apporter selon son imaginaire l’interprétation qu’il souhaite. Les textes viennent ponctuer ce travail iconographique et proposent une visée réflexive non pas dans un commentaire des images mais dans un dépassement théorique sur la nature du nu et sur l’essence même de ce qu’est l’acte de représenter :
« RASSEMBLE TES CARTOUCHES
PRÉPARE TOI À CHARGER
ET SHOOT
NE FAIS PLUS QUE SHOOTER
LA NEIGE, LA BRISURE, LE PEU
SHOOT LA MAIN QUI RETIENT,
LES CREVASSES ET LES FISSURES
SHOOT LES ZONES D’OMBRE
ET LA CIORDE D’ENFANCE
SHOOT CES MOTS
CONSUMÉS D’AVOIR ÉTÉ TROP ÉCRITS
À PLEINES MAINS,
RECCUEILLE LEUR ESSENCE,
ET DANS UN ULTIME SHOOT
TIRE DES MOTS SECS ET BRUTAUX
MAIS LIANTS
ET EN ACCORD
AVEC L’ORIGINE DE TA VOIX »
Ce recueil qui est tout d’abord un très beau livre mène donc le lecteur à s’interroger sur sa propre nudité, à enfin oser regarder celle-ci. Sous l’image ainsi que sous la peau il y a du sens, et cet ouvrage, d’une très belle densité sémantique, ne cesse de le révéler.
Collectif de l’Atelier du Bocage, D’être plus que nu, Jacques André Editeur, Lyon, 2013, 91 pages, 20 euros.