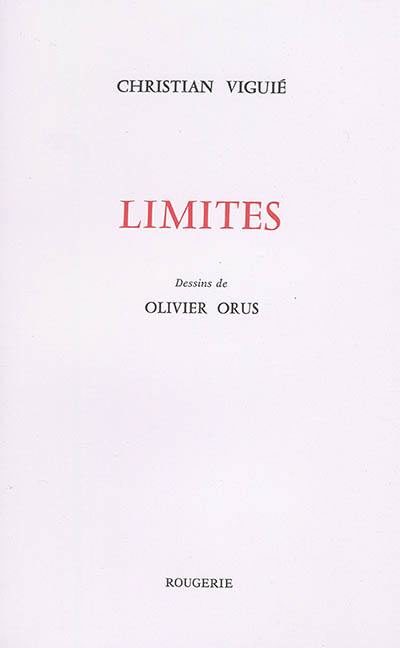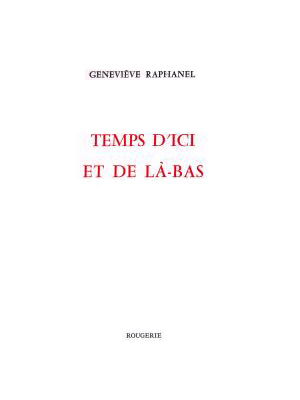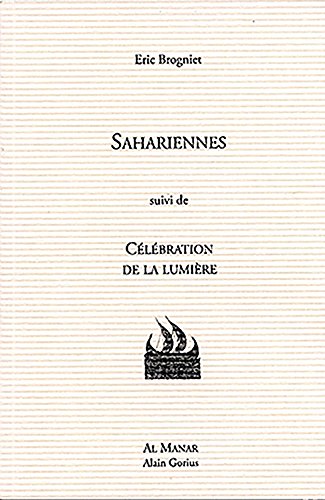Hans Limon, Barbarygmes et autres bruits de fond
Traversé(e)
je suis de ceux qui foulèrent
le saint parvis
de la mosquée Omari
de ceux qui
passionnés
convaincus
remplirent les avenues
de mille slogans têtus
jeunes optimistes
démocrates utopistes
de ceux qui
révolutionnaires éphémères s’abouchèrent
et bouchèrent
les canons des blindés
qui recouvrèrent de fleurs idylliques
bucoliques
les métalliques chars de la terreur
fils de Deraa l’ancienne
nous étions
invincibles
indéfectibles
insubmersibles
nous portions dans nos âmes
et nos cœurs
la haine de l’infâme
et le droit vainqueur
fils de la liberté
nous fustigions
l’oppression
la corruption
nous réclamions
à cor et à cri
l’abdication
sans délai
du potentat zélé
fêlé
notre voix retentit
résonna
jusqu’à Homs et Hama
jusqu’à Banias et Kamichli
dans les détours du faubourg d’Harasta
notre voix traversa
les pieds secs
la rivière Barada
s’engouffra
sans crime
dans le vaste selamkik
du Palais Azim
nous étions les bourgeons confiants
d’un éternel printemps
nous fûmes décimés
par le Sort et l’armée
le pays tout entier
suffoqua
dans l’odeur des charniers
des hauteurs de Kerak
s’exhalèrent
des relents de cloaque
il fallait vivre
il fallut fuir
les chars et les Bachars
et laisser derrière soi
le tendre émoi
d’une mère en pleurs
mater dolorosa
il fallait cheminer
en terrain miné
Liban Turquie Égypte
déserts plaines et cryptes
passer du tendre émoi
d’une mère en pleurs
au pâle effroi
d’une mer de douleurs
mare nostrum
rejoindre Ankara
trouver un passeur
et pourquoi pas
tenter sa chance
et dans une juvénile ardeur
atteindre le rivage
de l’Eldorado France
puis tout se mêle
et s’emballe
tout se précipite
et me presse
et m’excite
et m’irrite
le temps l’espace
autour
le vent les traces
les vautours
tout se condense
et danse
et concourt
et conspire
à ma fuite
les agents de voyage
en dernière classe
les grossistes
en mirages
les marchands de soleil
en éveil
les pourvoyeurs d’espoir
les promoteurs
des quarts d’heure de gloire
les courtiers en espérance
puis
l’argent dépensé
l’essor des pensées
les rêves prodigues
brisant les digues
puis
les tentatives avortées
les projets emportés
les vedettes italiennes
à l’affût
telles des chiennes
encerclant assiégeant
le chalutier bondé
peuplé
de Syriens
d’Africains
d’Iraniens
jetés sur les flots
par la misère
et les maux
sans fin
tyrannies avanies
conscriptions abjections
pléthorique foule
malmenée par la houle
il fait noir
tout est noir
et sombre
tout n’est qu’ombre
et reflets d’ombre
quelques lampes de poche
dessinent des fantoches
des murmures obscurs
abscons
frissonnent
et se défont
dans le silence
sans fond
les vagues s’amassent
en montagnes
en masses
les hydres maritimes
guettent leurs victimes
l’embarcation d’infortune
tangue éperdue
perdue
sous un ciel sans lune
nous flottons
secoués par le vent
nous pleurons
survivants
nous prions tous les dieux
nous fermons les yeux
puis
survient la trombe
un homme
se cogne et tombe
est-il mort
le paquebot
pour tombeau
mausolée désolé
est-ce qu’il dort
la conscience
en partance
je crie je prie
dans mes litanies
vont et viennent
l’Italie
Vintimille
Alpes
et scalps
massacres et simulacres
je revois
Maman
les mains tendues
mon frère de sang
parmi les pendus
je tremble
de froid
de faim
de peur
l’angoisse m’étreint
m’embrasse
m’écœure
m’enserre les reins
alors
je grave
je trace
de mes ongles écarlates
je griffe à la hâte
mes initiales
sur un tabouret
bancal
le navire prend l’eau
ma raison chavire
des hélicoptères survolent
les passagers s’affolent
qui se souviendra
qui témoignera
qui racontera
dans un jour
dans un mois
le calvaire
le naufrage
dans quelques années
l’asphyxie
de nos vies
de nos âges
en pleine
Méditerranée
Alep
nous avons rafraîchi nos cœurs purs, nos fronts secs
sur les bords limoneux de la belle Quoueiq,
nous avons chuchoté les secrets de nos droits
sous les arcs bariolés des grandes madrasas
bien avant la curée, bien avant les rebelles,
nous avons bombardé les murs des citadelles
de nos joies désarmées, de nos éclats de voix,
de souvenirs charmés, de couplets maladroits
obstinés, laborieux, généreux, volubiles,
nos aïeuls ont planté sur les terreaux bénis
d’Abu Kamal, Tinnip Azaz, Zabadani,
les oliviers noueux, le coton qui s’effile
sueurs de chair
sueurs de temps
lueurs de terre
lueurs de champ
les yeux exorbités de terreur fascinée,
sous un ciel de mitraille opaque, à sec, à pic,
nous voyons s’exhaler la fumée dystopique
des mosquées calcinées, des vies déracinées
le sang des réfugiés se mêle aux eaux limpides
sillonnant les vallées, néants béants, sordides,
les oliviers dénoués jouent les épouvantails,
les moucherons diaprés gangrènent le bétail,
les espoirs éventrés saturent les trottoirs,
les monuments sacrés s’effacent des mémoires
et nos aïeuls nourris au blanc sein de la paix
s’endorment, consumés, sous les fleurs embaumées
fureurs de guerres
lutteurs de camps
tueurs de frères
buveurs de sang
Sous pieds Cythère
ouragan d’Ouranos ensemençant les ondes
sexe tranché des mains d’un Cronos à la ronde
l’écume amère et maculée s’offre à la mer
dans un glissement lent d’envolées éphémères
sidération des nues découvrant Cythérée
nue sur la pâle conque aux atours éthérés
souffle quelconque ouvrant la voix des plaisirs purs
depuis les bleus tréfonds griffonnés de guipures
sa peau de lait, son doux parfum, ses cheveux d’or
font tressaillir les dieux penchés sur les rebords
surdiadémeraudée d’accroche-coeurs légers
son corps de grâce émerge de la mer Égée
raz-de-marée d’amour accostant le rivage
pluie de zéphyrs sondant les animaux sauvages
perle de sexe ouverte aux membres déliés
Aphrodite applaudit : Cythère est à ses pieds
Exil
nous sommes les voix
qu’on n’entend plus
nous sommes les faces
de l’Inconnu
rois déchus
esclaves exclus
princes méprisés
nous sommes les capitales
de l’Innommable
les minuscules
incompressibles
nous titubons
sur les sentiers
de l’impossible
excommuniés
ostracisés
nous avons traversé
le massacre et l’horreur
nous avons survécu
aux râles de la terreur
nous semons nos destins
à tous les vents
à tout hasard
au gré des chemins
au fil des matins
les membres tendus
tordus
les lèvres fendues
spectres du passé
souvenirs effacés
nous sommes les témoins
oculaires
de l’ère
crépusculaire
nous sommes les victimes
résignées
de l’abîme désigné
les dépouilles opimes
du plus odieux des crimes
nous respirions l’air frais
des beaux jardins d’hiver
nous buvions la fournaise
du désert délétère
nous creusions les tréfonds
des glaciers des tourbières
nous avons gravi
les volcans ravis
arpenté les massifs
les syrtes
et les récifs
sondé les profondeurs
des océans trompeurs
nous avons partagé
les sommets enneigés
nos gosiers asséchés
ont bu à l’écuelle
le doux précipité
des flocons éternels
dans la jungle torride
sur les monts escarpés
de la grimée Tauride
au milieu des vallées
aux deux pôles renversés
nous avons répandu
nos haleines condensées
nos plus nobles transports
ont encerclé
les détroits et les ports
les deltas et les forts
où l’homme abonde
la bête seconde
où l’homme abonde
l’argent surabonde
ainsi va le monde
ainsi naît l’immonde
et surgissent
des cendres étouffées
de la primaire bonté
de l’antique probité
les terrains divisés
les parts subdivisées
la convoitise
attisée
la nature
pillée
défrichée
mortifiée
les frères brisés
les fers scellés
nous avons vu
nous avons su
nous sommes
la majorité
silencieuse
nous sommes
la minorité
sentencieuse
nos esprits animaux
nos paupières animées
considèrent l’insensée
sidération
de l’homme-loup-pour-l’homme
l’effondrement frondeur
du royaume des faucheurs
nous nous taisons
sages et brutaux
ecce homo
plus rien ne vit
plus rien ne bouge
quittons ce drame
quittons la scène
voici
l’homme rouge
voici
l’anthropobscène
Le bal des chats
sous la tenture des chapiteaux
s’éparpillent
subito
la valse des ronrons
le félin fandango
le mistigral tango
des chatons d’outre-peau
pattes-à-pattes rustres
à souhait
sous l’éclat ténu des lustres
matoutatoués
bâillant la lie des flots
luminoumineux
contenus
con moto
des gerbes de moustaches
rasotent et foulent des fils barbus-blés
bravaches
qu’elles emmaillotent
comme à cache-cache
comme à Mayotte
au loin des bâches
de sacrés numéros
ma non troppo
bubulles à quatre temps
bascules à contretemps
fibules jetées aux quatre vents
conciliabules entêtants
mousseux mouvements
des yeux bercés perçants
surpiquant les tapis soyeux persans
tout frisonne et ressent
tout s’étonne et redescend
la ritournelle des musiciens
roublards
s’en va puis revient
puis repart
les pas si forts tissutent les liens
les chats piteux potassent
et finalement
s’enlisent dans la mélasse
d’une pluie de poisse
nonchalamment
un pour les chiens
deux pour les cieux
trois pour les rats
quatre acariâtres
valets violâtres
narquois rabat-joie
vils abat-jours
billes de velours
sur leurs plastrons blasés
qui ne savent quoi tamiser
qui ne savent pas s’amuser
quittent leur bas bouge
et jouent
rusés roués
les matons mutins matois
la griffe plongée dans un bocal pyramidal
de boissons rouges
sans amygdales
des videurs siamois
sapés comme des sapeurs
dissipent les saouls buveurs
tout minoufés de bonnes liqueurs
les cabotins ne tiennent pas bien
les consacrés whiskies coquins
ça brûle et ça quadrille
ça cahote et ça brille
ça chatoie ça vacille
allegretto
les entrechats chahutent
les contredanses culbutent
sous les sifflets des sans-goût-chats
huant les vrilles de joie
mâles et femelles s’enlacent
le feu se mêle aux maracas
les frimousses tiquent écument
coincées dans leurs chapeaux de plumes
sur de larges litières
couronnées d’oriflammes
se pâment
d’émoi
de pâles Reines de sabbat
rescapées des sorcières
quelques matousalems
pépères tout blancs tout blêmes
chalands des oubliettes
lutinent des mistigrettes
que chipotent à tue-tête
les chats-trappeurs Davy-Croquettes
les coussinets dessinent
sur les pas vus pavés
de bon aloi
la ronronde chagrine
des esprits animaux
sans appui
sans aboi
les jeunes minois
de fin pelage
fricotent et s’asticotent
à l’ombre des papilles en fleurs
des gus tardifs ronfleurs
pardonnons-leur
c’est un peu l’âge
les murs de toiles s’étiolent
les Angoras maousses titubent
et miaulent
sur le chemin
des piaules
charpentées comme des cubes
le pointu plafond rigole
des chats-chats qui s’affolent
des fines babines
qui s’enfilent à la pelle
de grosses bibines
des brocs de gnôle
fortissimo
les tigres miniatures
hoquettent l’acide mixture
des vains spirituels
vérité pressentie
jamais démentie
ventre-saint-gris
après minuit
plus aucun bruit
les chagrins s’enfuient
mais tous les chats sont gris