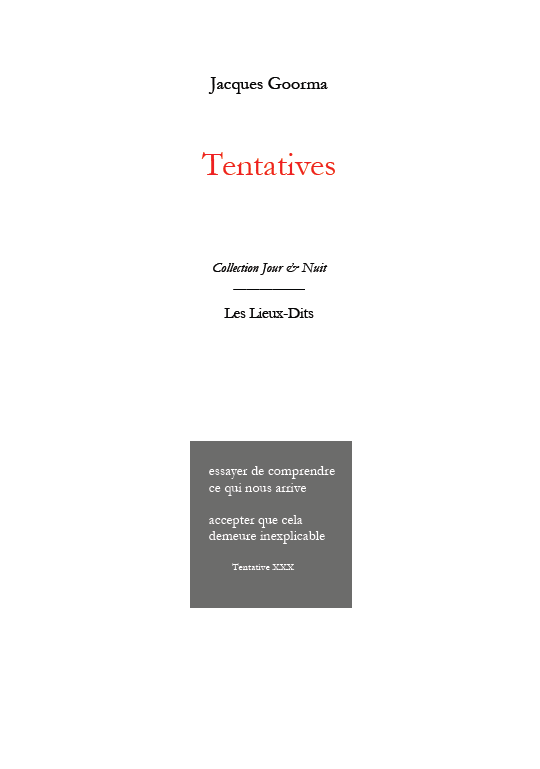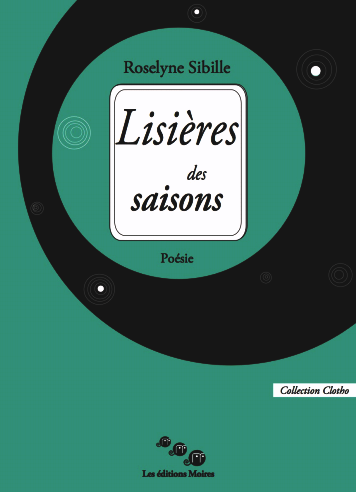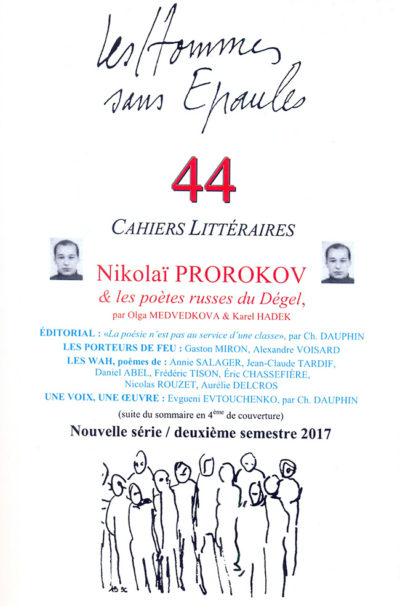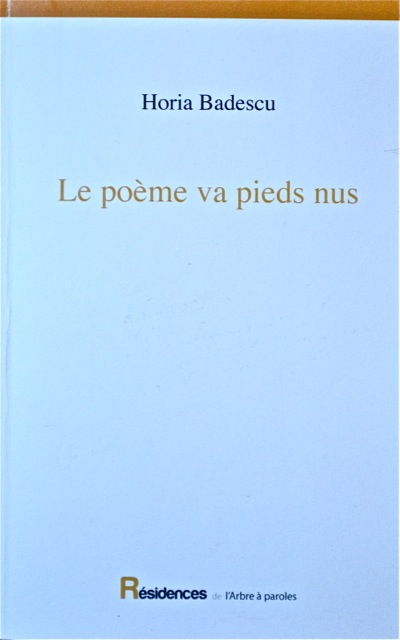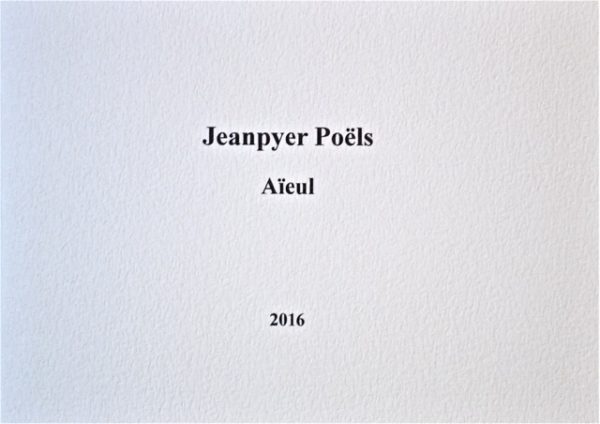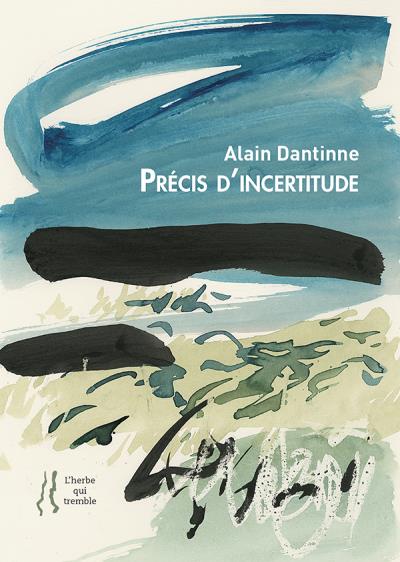Marie-Hélène Prouteau, Masque kanaga et autres poèmes
Trois poèmes de Marie-Hélène Prouteau, publiés en mars 2017.
Masque kanaga
à côté la petite fille d’une amie
ses yeux glissent sur le logo de l’éditeur Présence africaine
figure en double croix qui l’emmène crayon en main
sur un chemin visible d’elle seule
qu’est-ce que tu dessines ?
toi avec les béquilles.
Ce masque Kanaga d’un homme debout
je me souviens de l’étrange Renard pâle.
qui relie aux esprits de la parole claire des grands sages
sublimation des béquilles dans le monde analogique d’une petite fille.
sont les parents des animaux des rochers et des arbres
c’était au temps où le ciel était très proche de la terre
les femmes dogons décrochaient les étoiles pour les donner aux enfants
quand ils n’avaient plus envie de jouer les mères reprenaient les étoiles et les replaçaient dans le ciel.
Elle rit comme si son ancêtre était une antilope ou un guépard
au fond de lui chaque enfant est animiste l’âme à hauteur des légendes
et doucement elle va et vient rêveuse vers la glycine.
c’était la belle année 1971
dans la librairie Présence africaine
l’affiche de Picasso 1956 visage nègre
pour le congrès des écrivains africains
on lisait les poètes Senghor Césaire Depestre Glissant et les livres d’ethnologie
des heures à accueillir l’enchantement
au quartier latin il y avait quatre choses que l’on aimait
la librairie la Seine la statue de Montaigne la devanture du Vieux Campeur
entendue au Théâtre de la Ville.
Lectures nomades pour cœur empli de tout
« Mon pays c’est l’hiver » emmenait au Canada
avec The Immigrant l’ancêtre breton parti jadis
et le masque Kanaga vers d’autres lointains
les hautes falaises du pays dogon.
par la simple magie d’une parole enfantine comment dire ?
corps-kanaga
le défaut physique soudain nimbé de la grâce d’une légende.
Merveille cette force vitale le nyama
de la terre et celui de la jambe
qui circulent s’échangent dans l’empreinte au sol
merveille la transaction du « Grand Masque »
qui donne force au grand tout
la vie revient
plus forte encore
et je crois bien que je danse.
Poème inédit
Madame Keravec
C’est un peu après l’exposition « En guerres », au Château des Ducs de Bretagne.
Si violent, le choc qui s’impose à la lecture de cette légende : « Madame Keravec, quatre fils tués à la guerre de 1914-1918 ». Un couperet qui glace subitement toute pensée. Cette terrible histoire ne lâchait plus. Il fallait en savoir plus. Rechercher et rencontrer sa petite-fille. Il y a des destins qui ensorcellent par le feu noir qui brûle en eux.
Démence de l’Histoire qui a permis ça : le meurtre accompli d’une mère.
On se prend à imaginer l’année 1914, cet avis qu’elle reçoit par trois fois, qui fait entrer le malheur à la maison. Insupportablement. Le souffle coupé, le corps tout entier foudroyé devant le courrier bref, froid, porteur de catastrophe. Noire Annonciation. Ne plus jamais les tenir dans ses bras ? Le mari malade, atteint de tuberculose, se mure dans son silence.
Elle, il lui faut bien se remettre à vivre. Malgré la mort. Tellement là, la mort. Madame Keravec habite le quartier Chantenay et travaille aux bateaux-lavoirs. Alors on devine. L’attente. L’espoir pour le dernier fils. Peut-être y aura-t-il une lettre de lui ? Quatre ans que ça dure. Et voilà qu’un nouvel avis vient dire qu’il est mort des suites de ses blessures. La même année, le mari de Madame Keravec meurt.
Cette mère des douleurs, Marie-Anne Keravec, a perdu André, en 1914, à Fère-Champenoise. Jacques, en 1914, à Zonnebeke. Pierre, en 1914, à Erbéviller-sur-Amezule. Boniface blessé, meurt à Quimper en 1918.
Saisons à vie des douleurs.
Tués pour des raisons qui échappent à Madame Keravec ; les appétits féroces des empires, le mécanisme des alliances, l’implacable géopolitique, elle ne sait pas ce que c’est. C’est loin la Fère-Champenoise et Zonnebeke ? Ça fait une longue route vers Erbéviller ?
Tout ce qu’elle sait, c’est que ses quatre garçons, on les lui a arrachés. Et que sa vie, on l’a détricotée à l’envers. On lui a défait son ventre rond, on lui a défait ses accouchements. Comme si ces quatre corps de nouveau-nés n’étaient jamais passés entre ses jambes.
Là-bas, quelque part vers les frontières belges, allemandes, il n’y a plus ni buissons ni bois, ni forêts.
Et l’âme humaine, peut-on la reboiser ? Celle de Madame Keravec est dévastée.
Quatre obus pour une vie chavirée de peine et de silence.
Extrait de « La ville aux maisons qui penchent »
La Chambre d’échos, Paris, octobre 2017.
Le rire de la mer
Dans ma poche, le carnet où je prends des notes. Ces lignes de Matisse : « À force de voir les choses, nous ne les regardons plus. Nous ne leur apportons que des sens émoussés […] Turner vivait dans une cave. Tous les huit jours, il faisait ouvrir brusquement les volets et alors quelles incandescences ! Quels éblouissements ! Quelle joaillerie ! »
Nous avons tous un lieu familier dont il faut par moments ouvrir les volets. Juste un instant alors, le regard invente le monde. Juste un instant alors, le cheminement du désir irrigue nos vies.
Ce lieu familier, pour moi, c’est la petite plage. J’y ai vécu selon les déplacements des vacances, par intermittence. L’éclipse d’une présence. À la fois et indistinctement, toujours réelle, toujours rêvée. L’imagination jouait à cloche-pied dans cet entre-deux. Une chance pour voir les choses autrement qu’à travers le regard de la vie ordinaire. Ce qui attise le manque est un aiguillon.
La distance a du bon, elle préserve le sacré.
Mystérieuse tension où l’absence séduit la présence. L’empreinte de la petite plage en est cent fois plus tenace. Comment dire ce qu’elle a transmis ? Elle donne, généreusement, à sa manière rugueuse et tendre. Ses leçons d’énergie continuent d’opérer sans réserve, continûment. Une manière de code intérieur imprimé dans l’esprit, dans les sens. Une tournure de l’âme.
Au large, le surfeur encore. À chaque vague, tel une boule élastique, on le voit surgir, décollé des appuis et assises de ses membres, délivré de la pesanteur. Oublieux de l’Homo erectus, il se transforme en un ludion empli de virtualités. Corps solidaire de la vague dans un mouvement de lutte et de séduction à la fois.
Depuis la première adolescence quand la maison du bord de mer a été vendue, je suis sans résidence ici. Mais pas sans demeure.
Après toutes ces années, toujours le même appétit de vagues, d’iode et de rochers. Appétit plutôt que faim. C’est l’acte de se porter vers quelque chose de vital, d’essentiel et cela s’est tramé il y a longtemps. La petite plage est l’épicentre naturel indéfiniment revisité.
Ce sentiment de la demeure est ancré si profondément que j’ai l’impression que je pourrais habiter la petite maison du douanier dans les rochers et que rien, ni personne, ne pourrait venir m’en déloger.
Demeurer, c’est habiter un lieu et habiter un temps. Un temps qui n’est pas uniquement le présent. Un lieu qui n’est pas uniquement un espace.
François Cheng parle de « sentiment-paysage » pour dire la connivence entre l’esprit humain et l’esprit du monde. Oui, s’il y a une joie à communier ici dans la beauté des choses, elle a un goût de force sauvage et douce à la fois. C’est un champ d’attentes et de tensions que ce lieu a ouvert en moi. Des poussées de vie ininterrompue travaillent de même façon l’affolement des oyats, les gesticulations des tamaris, les passes d’armes du vent. L’énergie catapultée par les vagues gonflées d’écume, je la sens passer au plus profond.
Extrait de La Petite plage, Editions La Part Commune, 2015.
Le titre « Le rire de la mer » est emprunté à Mario Luizi