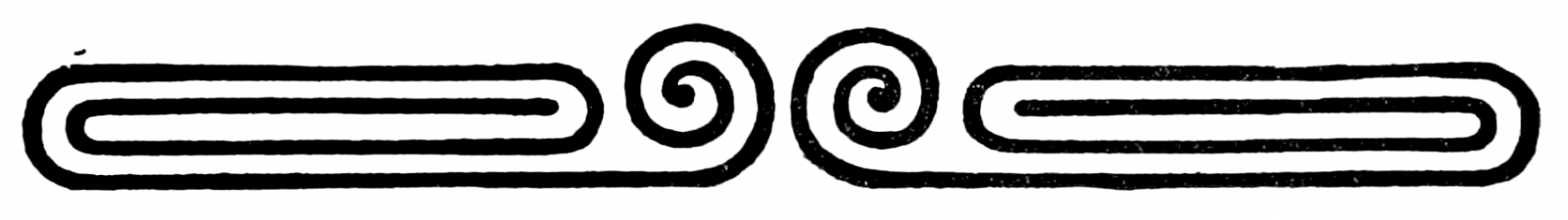Arnaud Le Vac présente Le Sac du semeur
C'est avec grand plaisir que nous donnons la parole à Arnaud Le Vac, fondateur et animateur de la toute jeune revue numérique gratuite "Le Sac du Semeur", projet aussi simple qu'ambitieux, auquel nous souhaitons de durer et de rencontrer de nombreux lecteurs, grâce à son riche programme de poètes et d'artistes. Nous vous invitons à télécharger sans délai le pdf en suivant le lien à la fin de l'article.
La revue le sac du semeur a été créée au printemps 2016. Son premier numéro a décidé pour moi ce que serait le Semeur : une revue où pourrait être mise en avant une pratique de la poésie et de l’art. J’ai contacté les poètes Marcelin Pleynet, Claude Minière, Pascal Boulanger, Serge Ritman, les peintres Pierre Nivollet et Mathias Pérez, et c’est de leur contribution qu’est née la revue le Semeur.
Mathias Pérez m’a proposé de publier dans la revue les textes de Bernard Noël, de Claude Minière et de Christian Prigent sur son travail ou plutôt son activité, avec au choix deux séries de photos de ses œuvres. La revue a ainsi intégré un cahier central pour et avec un artiste. C’est pour le lecteur la possibilité de faire une expérience avec la peinture et pour l’artiste la possibilité d’écarter d’un geste de la main ce qui fait illusion.
Deux autres cahiers occupent la revue. Le premier cahier est résolument tourné vers des écritures qui ont publié, le second cahier est tourné, avec la publication d’un photographe, vers des écritures qui ont peu ou pas encore publié, même si ces deux cahiers ne sont pas pour moi séparés.
Le sac du semeur numéro deux publie les poètes Margaret Tunstill, Jacqueline Risset, Alain Jouffroy, Hans Magnus Enzensberger, Laurent Mourey, Lou Coutet, Fabiana Bartuccelli, le peintre Pierre Nivollet, Marcelin Pleynet, la photographe Martine Barrat et l’artiste Jeanne Gatard. Mon activité de revuiste consiste à inviter les contributeurs ou à demander les autorisations de publications, à mettre en ligne les contributions sur le site de la revue dès le printemps jusqu’à l’été et à publier enfin le PDF de la revue.
Chaque écriture est une rencontre. Une porte ouverte vers l’inconnu. J’aime solliciter un artiste pour les dessins de la revue : Le Semeur, Pierre Nivollet, n°1, ou encore Semer, Prendre et donner, Victor Hugo sur le rocher des Proscrits, Jeanne Gatard, n°2. Le sac du semeur est une revue numérique annuelle et gratuite. J’imprime un livret uniquement pour les contributeurs et les critiques. Mon souhait serait que celui-ci puisse trouver place dans la bibliothèque des écrivains que je publie. Je suis heureux d’attirer l’attention sur des œuvres aussi importantes que celles de Cess Nooteboom (2016, n°1) et d’Hans Magnus Enzensberger (2017, n°2) pour ne citer que deux des poètes qui sont pour moi autant d’exemples de ce que peut être la poésie aujourd’hui.
Arnaud Le Vac