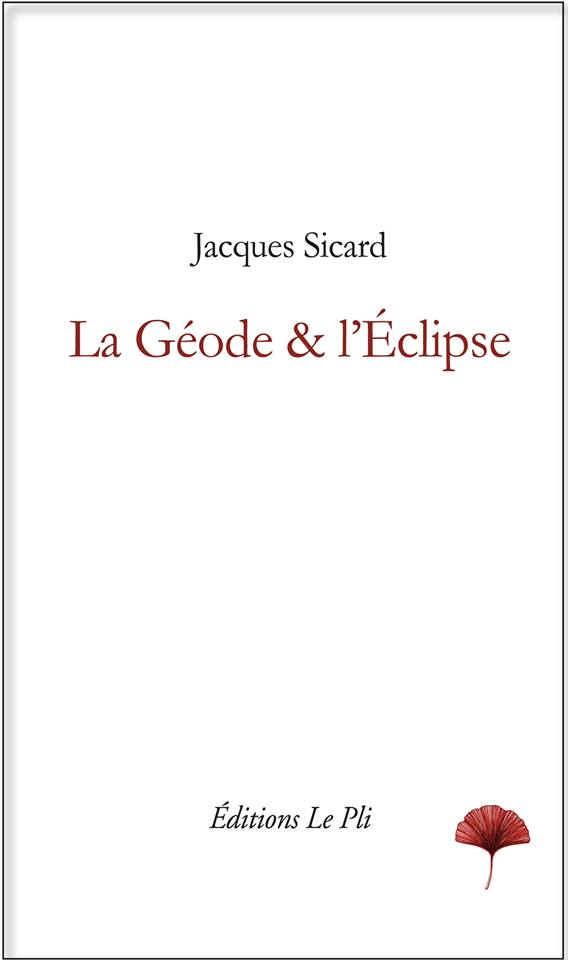Murièle Camac : Constantin Cavàfis
Xavier Bordes : Yannis Ritsos
Constantin CAVÀFIS, Tous les poèmes
par Murièle Camac
Cavafis, poète grec d’Alexandrie ayant vécu au tournant des XIXe et XXe siècles, a peu publié de son vivant – a d’ailleurs peu écrit. Il a pourtant marqué durablement la poésie de langue grecque, qu’il a fait entrer dans la modernité.
En France, de nombreuses traductions de ses poèmes ont paru, dont celle de Marguerite Yourcenar chez Gallimard en 1958. Récemment, Michel Volkovitch avait déjà traduit certains poèmes de l’auteur alexandrin[1]. Dans ce nouveau recueil, c’est l’ensemble des poèmes qu’il propose en traduction aux éditions Le Miel des anges, maison spécialisée dans la littérature grecque. La table des matières en début de volume donne les titres des poèmes dans l’ordre chronologique, et un index à la fin du volume les donne dans l’ordre alphabétique.
Le projet éditorial est expliqué très clairement en quatrième de couverture : « Les éditions françaises de Cavàfis, conformément à l’usage grec dominant, placent les Poèmes publiés en tête, éventuellement suivis d’une partie de l’œuvre non officielle. Nous avons choisi une présentation différente, chronologique – en précisant bien à chaque catégorie appartient chaque poème ». Ces différentes catégories sont les suivantes : les poèmes jamais publiés, « cachés » ; les poèmes publiés dans la jeunesse puis reniés ; les poèmes inclus dans l’édition de l’ensemble de l’œuvre, préparée par Cavafis lui-même mais sortie après sa mort. Une postface du traducteur (intitulée « Où Cavàfis devient lui-même ») développe et explique les choix de présentation et de traduction.
C’est donc plus qu’une nouvelle version de l’œuvre intégrale (officielle) que nous avons ici : une véritable rétrospective, comme on peut en avoir pour les peintres ou les photographes. Cela convient idéalement à l’artiste que fut en effet Cavafis. Une telle approche permet de suivre le cheminement poétique de toute une vie, depuis les essais de jeunesse pas toujours bien maîtrisés jusqu’aux remarquables poèmes de la maturité et de la vieillesse. On peut simplement regretter que les textes originaux ne soient pas donnés aussi afin que la vision d’ensemble soit réellement complète. On aurait aimé pouvoir se référer à la version originale. D’une manière générale, il me semble qu’il faudrait toujours donner, pour toute édition de poésie traduite, la version originale. Pour qui connaît un tant soit peu la langue d’origine, c’est indispensable ; et même si l’on ne connaît pas la langue, on reçoit au moins une image, une impression du texte tel qu’il a été écrit.
Il est très intéressant de lire les poèmes de Cavafis tels qu’ils sont présentés, dans l’ordre, chronologiquement. D’une part parce que cela permet de saisir la progression du poète dans l’écriture des textes et d’assister à l’émergence d’une émotion forte au fil de l’œuvre : si, parmi les premiers textes, certains peuvent sans doute être qualifiés de franchement mauvais, cela ne rend que plus remarquable, dans les deux tiers restants, l’enchaînement presque sans faute des réussites poétiques. Il est d’ailleurs toujours intéressant de lire des poèmes ratés : on apprécie mieux par comparaison ceux qui ne le sont pas.
Mais d’autre part, cette lecture des poèmes page après page permet d’entrer progressivement dans un univers poétique d’une étonnante cohérence. Le charme n’en opère que plus intensément. J’aurais sans doute du mal à isoler tel ou tel poème se distinguant particulièrement, à désigner des « perles » qui m’auraient marquée plus que d’autres. Ce qui marque, c’est l’indéniable puissance et le charme persistant de l’ensemble : le retour des thèmes et des motifs, finalement peu nombreux et inlassablement repris, réinterprétés, réenchantés. Les poèmes de Cavafis sont des variations musicales sur quelques thèmes choisis. Si la musicalité de sa langue, soulignée par le traducteur Michel Volkovitch, nous reste malheureusement étrangère, la musicalité de son univers, la qualité musicale de sa pensée poétique, cela en revanche est clairement saisissable par une lecture en continu de son œuvre.
C’est entre autre l’alternance très régulière, du début jusqu’à la fin du recueil, entre poèmes à sujets historiques et poèmes amoureux qui crée cet effet singulier. Enlever à l’œuvre cette alternance, comme le font certaines éditions qui choisissent de ne publier que les poèmes de l’intimité, ou que les poèmes historiques, est lui enlever ce qui fait sa force et son originalité. Il s’agit fondamentalement d’une poésie de fantasmes : fantasmes de la Grèce et fantasmes sexuels. Toujours associés à un passé irrévocablement révolu, les uns et les autres semblent ne pas pouvoir fonctionner séparément. C’est qu’ils n’appartiennent pas à la réalité ordinaire, à la pensée consensuelle, à l’attendu : la Grèce n’est pas celle que l’on imagine, le désir est homosexuel, interdit.
Les poèmes historiques, comme le note Michel Volkovitch, font « revivre des époques mal connues de nous, période hellénistique ou Byzance médiévale ». Heureusement, le traducteur propose en fin de volume des notes très utiles et éclairantes pour combler nos lacunes. Encore plus heureux, au fil de la lecture la plupart de ces notes deviennent inutiles : ce sont en effet les mêmes personnages ou références historiques qui reviennent d’un poème à l’autre (Julien l’Apostat, Antiochos Epiphane, Démétrios Sôter, Jean Cantacuzène, Apollonios de Tyane...), et l’on finit par se familiariser avec ces univers lointains, si profondément constitutifs de l’univers cavafien.
Pour qui aime la Grèce, c’est un enchantement : la recréation d’une Grèce ancienne à la fois proche de l’imaginaire occidental et totalement originale. Grec d’Alexandrie, Cavafis cherche la Grèce hors de Grèce — en parcourant ses diasporas et l’histoire d’après l’âge d’or classique. En parallèle, ou plutôt en une parfaite contemporanéité, les poèmes amoureux retranscrivent une Grèce moderne qui n’a rien non plus du pittoresque que les Occidentaux lui prêtent souvent. Alexandrie, la ville natale de Cavafis, est présente non comme un décor, non comme une ville, mais plutôt parce qu’elle connote la périphérie, la marginalité, le mélange. C’est une Grèce du plaisir et de la sensualité, mais homosexuelle donc illégitime. De même qu’il cherche la Grèce hors de Grèce, Cavafis cherche l’amour hors de l’amour (permis), en parcourant les corps défendus, la beauté masculine qui lui est interdite.
Incontestablement, ce sont les poèmes autobiographiques, ceux des amours masculines illicites, qui orientent l’ensemble de la lecture. Vivre des amours homosexuelles cachées, c’est à la fois, pour Cavafis, être honteux et jubilant, c’est être grec. C’est vivre exclu de la société et appartenir à sa plus grande noblesse, celle de l’art et de la poésie :
Je suis allé dans les chambres cachées qu’on juge honteux de seulement nommer. Mais il n’y a pas de honte pour moi – sinon quel poète, quel artiste serais-je[2] ?
Désir homosexuel, plaisir charnel, poésie et grécité participent d’un même principe – la recherche de la beauté :
Dans cette vie dissolue de ma jeunesse,
se formaient les principes de ma poésie, s’ébauchaient les contours de mon art[3].
Cette beauté apparaît comme l’héritière directe des fleurs du mal baudelairiennes[4], dont l’emblème originel consistait dans les figures des « Femmes damnées » et des amours saphiques. Un même lien unissait déjà, chez Baudelaire, l’amour interdit, la damnation et la poésie — et même la Grèce, avec la référence fondatrice à Sappho. Mais là où Baudelaire centrait son univers poétique sur des figures féminines, celles-ci sont presque absentes de l’univers de Cavafis, qui procède essentiellement par des variations autour de figures masculines (avec une préférence peu surprenante pour les éphèbes). Le Baudelaire poète est en quelque sorte une femme lesbienne, bien plus qu’un homme hétérosexuel : c’est par ce déplacement, subversif s’il en est, qu’il retranscrit son expérience de la damnation créatrice. Cavafis, poète de la marge sexuelle mais aussi bien géographique et historique, est d’emblée déplacé, d’emblée damné : en donnant corps et vie textuelle à ses désirs amoureux, on peut dire qu’il réinvente à sa manière, toute grecque, l’expérience baudelairienne de la damnation créatrice. D’infinies déclinaisons de cette expérience sont vécues par les nombreux doubles possibles du poète, antiques ou contemporains ; par exemple « Démétrios Sôter (162-150 av. JC) », roi séleucide tué au combat :
Et maintenant ?
Maintenant, désespoir et chagrin.
Ils avaient raison, les amis à Rome.
Elles ne peuvent pas se maintenir, les dynasties qu’instaura la Conquête des Macédoniens.
Peu importe : il s’est donné du mal, il s’est battu tant qu’il a pu.
Et dans sa noire désillusion,
il ne pense qu’à une chose,
qui le rend fier : dans son échec, il montre au monde sa bravoure indomptable, inchangée[5].
Poète non publié de son vivant, individu périphérique, Cavafis crée un univers décalé, insaisissable, secret, et pourtant étrangement proche. Sa langue, très simple en apparence, donne une impression de transparence. Ses textes constituent autant de petites histoires facilement abordables a priori. Mais paradoxalement, aucun message clair ne nous parvient ; une opacité demeure. Quelque chose se cache.
Dans sa recherche du temps perdu[6] que sont, fondamentalement, la recherche de la Grèce passée et celle des amours enfuies, il ne faut pas lire en effet une nostalgie simpliste, encore moins une volonté de retour à une origine réductrice. Aucun goût pour l’explicatif et l’univoque chez Cavafis. Au contraire, il ne cesse de saisir des moments de transition, des visions d’entre-deux.
Ainsi, les deux derniers tiers du recueil déploient pleinement un univers du mélange, des frontières poreuses, du va-et-vient entre des identités multiples et qui, cependant, sont toutes grecques : mélange des religions avec le va-et-vient entre paganisme et christianisme ; transformation des empires ou des dominations politiques avec le passage des Grecs aux Romains, d’Antoine à Octave, des Byzantins aux Turcs ; franchissements incessants des frontières géographiques et temporelles (d’un port méditerranéen à l’autre, de la ville à la campagne) ; passage d’un nom à un autre (« On n’a pas besoin d’écrire un nouveau texte. / On n’a qu’à changer le nom[7] »). Tout cela, bien sûr, sur fond de cette sexualité mélangée, périphérique, « impure » qu’est l’homosexualité. Caractérisée chez Cavafis par une fusion et un échange constant des corps, des chairs, des désirs, des jouissances, l’homosexualité est en effet l’autre nom du mélange, du franchissement des frontières, d’une fécondité non pas physique mais intellectuelle, artistique et spirituelle : L’accomplissement du plaisir interdit
a eu lieu. S’étant relevés,
ils se rhabillent en hâte sans dire un mot. Ils sortent furtivement, séparément (...).
Mais comme elle y a gagné, la vie de l’artiste ! Demain, ou des années plus tard, seront écrits les vers puissants dont c’est là l’origine[8].
« C’est là l’origine » : non pas dans une genèse biblique ou dans une épopée cosmogonique, non pas dans un récit unique de la séparation des éléments et des corps, mais au contraire dans le récit très bref et trivial d’une fusion furtive entre des corps non nommés. Ou, plus exactement, dans la répétition, poème après poème, de ces rencontres illicites des corps et des êtres, de ces mélanges « contre nature » d’où naît la plus haute forme de culture, l’art.
« L’origine » de notre civilisation, semble dire Cavafis, notre passé, il faut le chercher dans la répétition toujours recommencée des mélanges et des échanges. — En ce sens, la lecture de ces poèmes paraît particulièrement pertinente en ces temps de crise identitaire de l’Occident : on y trouve des échos politiques inattendus. Au fantasme nationaliste, qui se répand de plus en plus aujourd’hui en Occident, d’une identité unique et excluante que justifierait un passé mythifié, Cavafis permet d’opposer d’autres fantasmes, nourris par une lecture historique du passé plutôt que par le recours au mythe : fantasmes d’unions multiples, récits d’identités en circulation, poèmes des transitions fécondes et créatrices. S’il est un pays, pour Cavafis, c’est la langue. La langue grecque est ce qui perdure et unifie au-delà des époques et des territoires, ce qui donne la noblesse et la fierté, ce qui permet la création : la « langue grecque, porteuse de mémoire[9] ». Mais même la langue, pourtant, doit s’hybrider pour devenir créatrice. La langue grecque elle-même doit se faire lieu d’échanges et de mélanges si elle veut rester lieu de vie :
Ton grec est toujours beau et musical.
Mais nous avons besoin ici de tout ton art.
Notre amour, notre peine passent dans l’autre langue. Dans la langue étrangère, mets ton cœur égyptien.
Rafaïl, ces vers-là doivent, tu l’as compris, être un reflet de notre vie à nous,
et chaque phrase laisser voir qu’ils sont écrits sur un Alexandrin par un Alexandrin[10].
Cavafis l’Alexandrin « devient lui-même », pour reprendre le titre de la postface de Michel Volkovitch, en écrivant des vers grecs avec un « cœur égyptien ». Il devient le premier poète de la modernité grecque, et l’un des plus grands, en ouvrant son cœur, son corps et sa langue à tout ce qui, n’étant pas grec, permet à la Grèce d’exister.
[1] Constantin Cavafis, Choix de poèmes, traduits par Michel Volkovitch, Athènes, Aiora press, 2015.
[2] « M’allonger sur leurs lits », p. 193.
[3] « Jugement », p. 223.
[4] L’influence de Baudelaire sur Cavafis est inscrite dans le recueil même : l’un de ses poèmes de jeunesse, « Correspondances d’après Baudelaire », contient la traduction intégrale en grec, par Cavafis, du « Correspondances » de Baudelaire.
[5] « Démétrios Sôter (162-150 av. JC) », p. 239.
[6] Cavafis est le contemporain de Proust...
[7] « Dans une ville d’Asie Mineure », p. 286.
[8] « L’origine », p. 258.
[9] « Dans une ville d’Asie Mineure », p. 286.
[10] « Pour Ammon, mort en 610 à 29 ans », p. 211.
*
Yannis RITSOS, Balcon
par Xavier Bordes
Ce n’est pas s’avancer beaucoup, que de dire, d’emblée, qu’après les livres majeurs traduits brillamment par le poète Dominique Grandmont, il reste une quantité de recueils de Ritsos à éditer, et par suite éventuellement à traduire. En effet, ce poète grec aura été particulièrement prolifique, vivant et respirant par la poésie quotidiennement. Il s’ensuit naturellement une foule de suites de poèmes, avouons-le, certes de force inégale, qu’on aurait tort cependant de classer parmi les fonds de tiroirs posthumes. Si Ritsos est un poète renommé, fort apprécié de bien des Grecs, c’est pour des raisons où la politique, l’idéologie, la qualité littéraire, la spontanéité et la simplicité sont enchevêtrées de manière indissoluble. Il en résulte que rien de ce qu’il a pu consigner n’est indifférent. Balcon, le présent livre, illustre tout à fait cette situation : c’est comme si l’on accompagnait une période de la conscience poétique grecque, pour ainsi dire au jour le jour, avec le recensement matériel de son univers selon les instants que le poète a élus comme significatifs de telle ou telle heure de sa vie. Parfois, certains jours, trois ou quatre écrits sont apparus, d’autres fois un seul, tous compris dans le mois de mars 1985… et tous chargés intensément d’une vie partagée avec ceux qui sont là, amis proches, personnes de rencontre, dont la présence est toujours sourdement implicite dans chaque poème. En ce sens, Ritsos est un poète globalement « métonymique ». Chaque élément minuscule qu’il choisit d’évoquer, d’élire, dans son environnement et son époque, semble branché sur le cosmos entier, nous parler (avec des « riens ») du vaste monde en lequel l’homme-poète évolue, questionne et se questionne. Il en découle une mosaïque d’instants qui façonne la physionomie d’une période, à la fois de la Grèce, et du siècle, laquelle à quelques égards n’est pas tellement éloignée de celle de la Grèce de 2017. Cette édition a de plus la vertu d’être bilingue, ce qui est une qualité primordiale, et d’être élégamment traduite en français, avec simplicité et netteté, ce qui ne gâte rien. Un livre de poèmes brefs et justes, que les amis de Yannis Ritsos, mais aussi ceux qui ne le connaissaient pas, pourront lire et relire avec intérêt autant qu’avec plaisir…