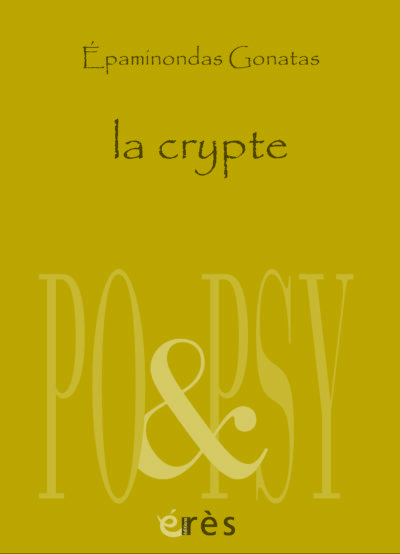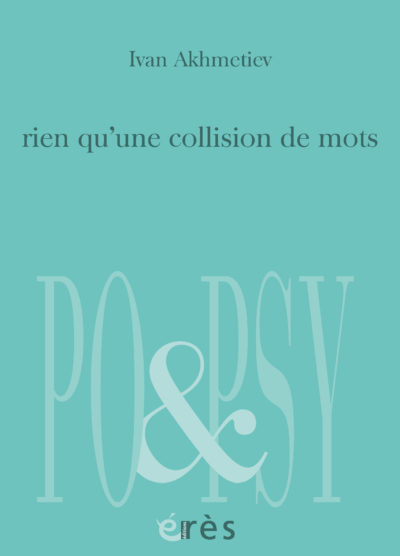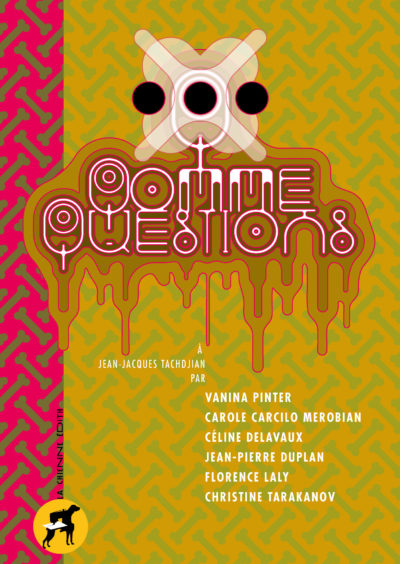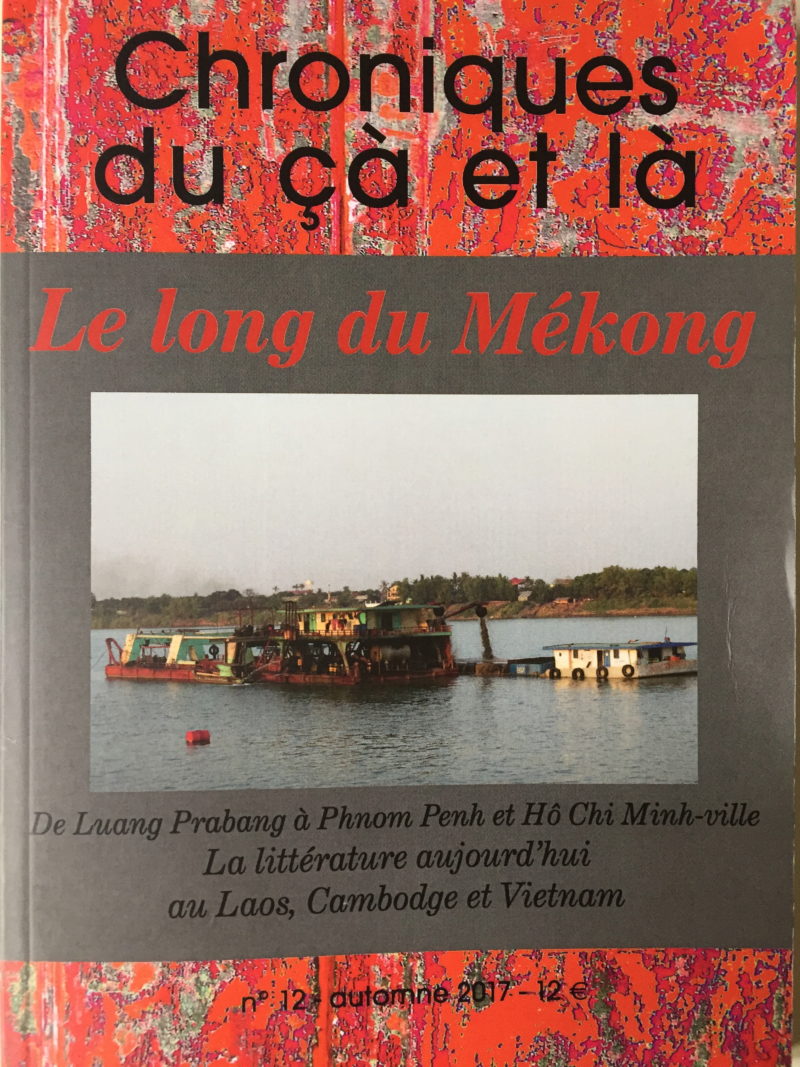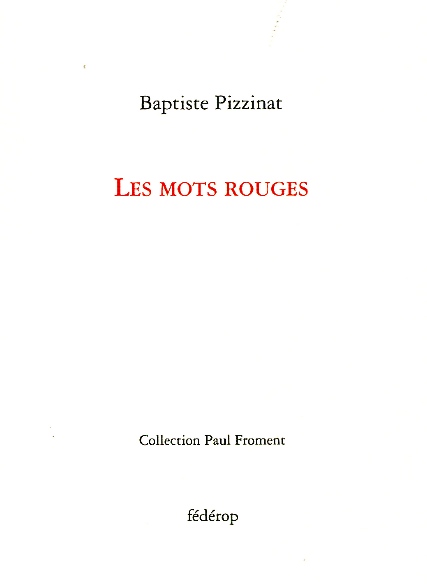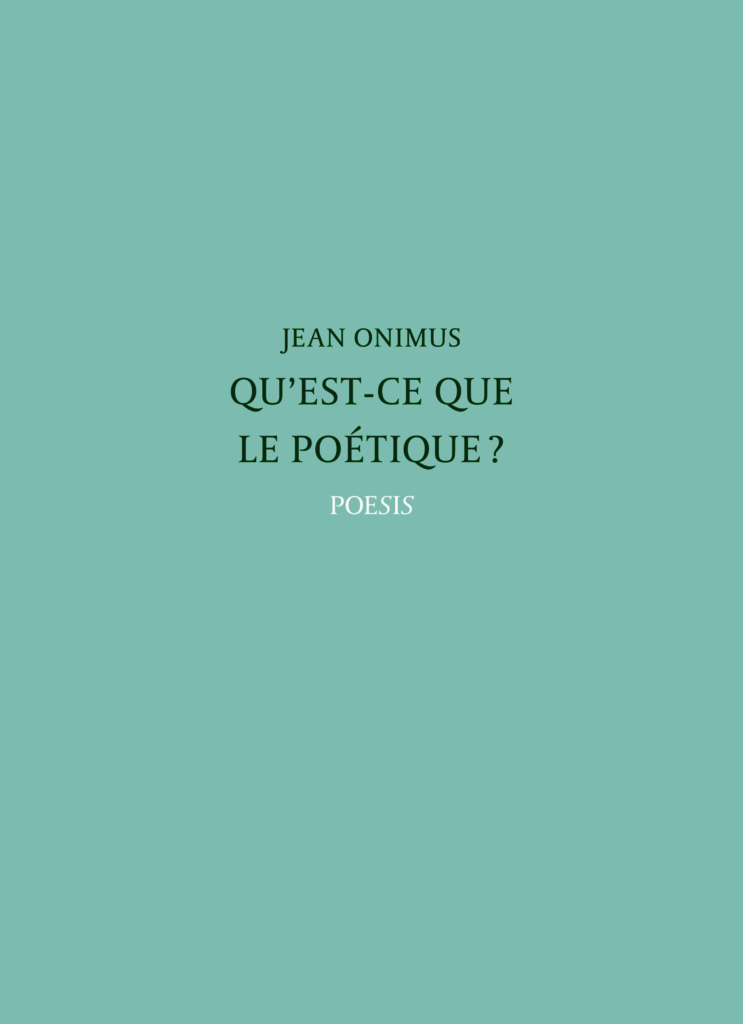Ceci étant dit, pour en revenir au petit bout de question que tu as négligemment semée au bout de ta phrase, je n'ai pas, à proprement parler, d'objectifs. Je pense que vivre au quotidien grâce à la petite merveille que sont l'étonnement et la curiosité qui l'engendrent est suffisant pour que, peut-être un jour, s'en dégagent quelques traces qui pourront être utiles aux autres. La recherche est dans le plaisir et le plaisir dans la recherche, c'est sans doute ainsi que l'on peut envisager faire du cabotage mental sur le chemin de la découverte car, comme l'a dit le prophète Jimi Hendrix, « l'important est le voyage pas la destinature », à moins que ce ne soit un autre prophète et que dans « destinature » il n'ait pas mis « nature ». Mais ceci est une autre histoire.
Je constate que dans vos productions vous consacrez une place prépondérante aux textes dont la mise en scène s’effectue dans un espace scriptural utilisé comme lieu d’un dialogisme avec l’image. Vous mêlez les arts graphiques et les arts visuels à un travail remarquable sur la typographie. Cet intérêt pour l’écrit motive-t-il le fait que vous affirmez que vous êtes un « poète par défaut » ?
Vous voulez certainement dire (je traduis pour les personnes qui ne pratiquent pas le vocabulaire universitaire, qui, même s'il semble être d'une puissante précision, est quand même un tantinet pompier) que je pratique un mix visuel de textes et d'images où la composition utilise beaucoup la typographie. Je sais c'est bien moins glamour mais la simplicité d'expression verbale peut avoir un charme aussi fort et bien moins « perruque poudrée » que le langage universitaire, qui a tendance à s'enfermer dans un petit fortin pour happy few et oublie qu'il n'est pas le Victor Hugo de la précision de l'expression écrite.
Eh bien oui, chère Carole, et si je me présente avec l'expression « poète par défaut » ce n'est pas en l'affirmant comme il semblerait que vous l'ayez perçu, mais par simple pirouette à double sens, même si le « par défaut » reste au singulier car je ne suis pas complètement schizophrène.
La poésie c'est l'état premier de la vie quotidienne, qui est hélas, aujourd'hui, reléguée au simple rôle de rayon malingre dans une bibliothèque. C'est assez agaçant car, comme le dit si bien Edgard Morin, « le but de la poésie est de nous mettre en état poétique », ceci en regard de l'état prosaïque qui est, hélas, notre quotidien « par défaut ».
C'est pourquoi, je me présente avec une intention narquoise, bien sûr, comme étant un « poète par défaut ». Mais ce n'est pas une devise ni une profession de foi, je pense que la vie est poésie, que le monde est poésie, une danse cosmique amusée et chaotique qui joue avec elle-même et dans une joie que peu perçoivent quotidiennement dans nos contrées riches et désabusées. Il n'y a plus de Chamans au cœur de nos pratiques sociales et les béquilles qui les remplacent (scientifiques, médecins, artistes...) offrent bien peu d'amour dans leurs actes.
Je ne sais pas si vous l'avez perçu comme prétentieux, car la poésie vous tient à cœur, je l'ai bien senti, et vous devez sans doute mettre un point d'honneur à la défendre contre le vulgaire et le falsificateur. C'est d'ailleurs tout à votre honneur, mais je la considère comme un outil pour le réel, comme un moteur pour la création. Elle en est son carburant principal.
Et pour en revenir à la typographie, je la pratique avec poésie, je lui fais dire des choses via le dessin de la lettre, qui permettent de s'affranchir de son usage prosaïque. C'est pourquoi je préfère me présenter comme « typonoclaste » plutôt que typographe. La lettre est aujourd'hui banalisée depuis l'avènement des computers mais je viens d'une époque où elle était l'apanage de quelques doctes personnes qui s'érigeaient en gardiens du temple, le pied de nez est né précisément à ce moment-là.
Votre travail sur la lettre ainsi que votre démarche ne sont pas sans rappeler celles du dispositif présent dans les manuscrits du Moyen Age, dans lesquels l’enluminure s’offre comme un résumé de ce qui figure sur la page, ou bien comme vecteur d’un message permettant de décrypter les symboles présents dans le texte. Peut-on faire un rapprochement entre votre pratique et cette mise en scène de l’image en lien avec un sens révélé ou dévoilé de l’écrit ?
Mais elle persiste et insiste la bougresse ! 🙂 Tu finiras immolée un soir de pleine lune avec une totale perte de sens, de sensations et de sens de l'histoire si tu continues !
Les enluminures des manuscrits du Moyen-Age européen n'étaient, certes, pas uniquement décoratives. Elles donnaient certaines clefs de compréhension du texte dans une époque où l'image était encore teintée de mystère, et de magie parfois. Image et magie sont d'ailleurs en anagramme, ce qui est éminemment remarquable (prononcer « caibeule »).
En ce qui me concerne je préfère jouer à une imbrication plus solidaire des composants textes et images, l'un n'étant pas l'appoint de l'autre ni son illustration ni son code de décryptage. J'essaie de parvenir à un équilibre (un des-équi-libre?) texte-image qui soit en quelque sorte un métalangage écrit et dessiné à la fois, un peu un retour aux sources hiéroglyphiques. Je ne sais pas si j'y parviens mais je cherche à jouer avec ça dans mes mises en pages, par exemple. C'est quelque chose qui est rendu possible beaucoup plus simplement qu'autrefois, à l'époque de la composition plomb et de la gravure, grâce à l'usage du computeur. Je trouve que les outils de pré-presse qui sont à notre disposition aujourd'hui sont un peu sous-employés. On peut désormais envisager des choses spécifiques au livre et au web écrit qui puissent aller bien plus loin et plus précisément que de simple émojis – culs de lampes ou de bribes d'images. Le web a remplacé la plupart des moyens de communication écrits et le livre peut désormais évoluer, quitter la simple duplication de textes ou d'images pour devenir quelque chose qui lui est propre. Ça reste encore à inventer, et ça le sera toujours car le plaisir de l'encre sur du papier est unique.
Idem pour ce qui est de la typographie, il existe des centaines de millier de polices de caractère et il s'en crée de nouvelles tous les jours. Mais hormis les fontes « fantaisies » de titrage, il n'existe pas de travaux de polices de lecture qui jouent avec ce que permet la programmation intégrée à la fonte elle-même, ou qui vont au-delà de simples variantes de classiques des siècles passés. Là aussi il y a matière et c'est jubilatoire de savoir que l'on a du pain sur la planche qui nous attend.
À la fin du siècle dernier, il y eut quelques levées de boucliers de puristes conservateurs qui s'insurgèrent, comme le font toujours les puristes, de la perte de la « culture Livre » (qui n'est ni la culture livresque ni la culture du livre) sacrifiée sur l'autel du multimédia et des réseaux. Vingt ans ont passé et le livre est toujours là…pourtant sont arrivés les Smartphones et les tablettes. Je considère que c'est une chance de plus sur notre chemin. La presse écrite se meurt et se clone elle-même, l'édition est devenue une vilaine industrie à l'exception de niches qui peuvent enfin respirer, le grand public et les institutionnels de la culture s'intéressent même désormais à l'édition indépendante, aux fanzinats et graphzines etc... Chose inimaginable il y a vingt ans où les acteurs de ces scènes culturelles étaient marginalisés et considérés comme des « amateurs » au sens figuré car le propre de l'amateur c'est avant tout d'aimer.
Après cette courte digression qui n'en est pas une, je reviens au fond de ta question et je pense que l'imbrication texte-image, qui existe depuis Dada et les avant-gardes du début du XXe siècle, va pouvoir sortir de son ghetto semi-élitiste cantonné à la chose artistique, pour devenir plus courante. Je pense que la poésie va couler sur des fleuves d'encre d'imprimerie et que des poètes graphiques vont éclore de ci de là, avec des styles qui leur seront propres : leurs vocabulaires, styles et tournures personnels. On verra, en tout cas je l'appelle de mes vœux car la poésie est aussi un outil pour réparer le monde, n'est-ce pas déjà le cas ? J'imagine un Apollinaire du desktop publishing, ça fait rêver non ?
Une des fonctions de la poésie est de permettre au langage de déployer un sens qui s’éloigne de la littéralité de son emploi usuel. Le dialogue entre le texte et l’image, éminemment poétique dans vos productions, ouvre à une dimension supplémentaire du signe, ne pensez-vous pas ?
Je pense que ta question m'amène d'abord à apporter une précision à ce que tu nommes « emploi usuel ». La langue parlée « prosaïque » est constituée de la même matière que ce qu'on pourrait considérer comme la langue poétique. Je pense aussi que la poésie apportée à la langue n'est qu'une manière de l'habiter, de la pratiquer, de l'intégrer à son être, à son vécu, à sa vie. Tout le monde aspire à être dans la béatitude, l'extase, le partage, la communion, la connaissance... Et pour moi, la poésie c'est quand cette aspiration guide le langage, le précède ou l'habille. C'est ce que Morin appelle « l'état poétique ». C'est un peu ce que j'essaie de faire avec mes compositions textes-images : j'essaie de les « habiller » de poésie pour que le sens des images, des textes et de leurs imbrications procède de cet « état poétique ». Évidemment, comme dans le langage oral, la réception par l'autre n'est toujours que parcellaire, mais si une grande partie du contenu émotionnel passe les mailles du filet et parvient le moins possible modifié chez le récepteur. C'est merveilleux lorsque le partage s'établit, et c'est vraiment jubilatoire. Je ne suis qu'aux prémices de ces possibilités que j'entrevois au loin et qui pourraient être, sans doute, en tout cas pour moi car nombreux sont ceux qui y sont déjà parvenu avec brio, le début d'un travail long et passionnant. Mais comme il n'y a pas assez de minutes entre les secondes je n'y parviendrais sans doute pas avant ma fin… mais bon, c'est le voyage qui est intéressant n'est-ce pas, pas la destination, comme le disait si justement, et avec à-propos, un grand homme qui devait sans doute mesurer 75cm de poésie au garrot, ce qui lui permettait sans doute de regarder sous les mini-jupes prétentieuses de ses contemporains toujours montés sur des tabourets de fierté mal placée.
Pour ce qui est du signe, là aussi, il est en perpétuelle évolution, mutation. Parfois il est un peu en régression, lorsque quelques frondeurs avant-gardistes sont peu ou mal compris et qu'ils provoquent une réaction inverse dans les pensées majoritaires, et parfois il fait un bond en avant, à la faveur d'une nouveauté technique, technologique ou d'un nouvel outil pour communiquer. Par exemple, depuis vingt ans que l'internet fait partie du quotidien d'une grande partie des gens sur notre planète, on en est encore aux balbutiements d'une expression poétique purement liée aux réseaux de communications. Qu'en sera-t-il dans dix ans ? J'ai le sentiment de percevoir une kyrielle de nouveaux usages, emplois et libertés prises avec l'expression poétique ces dernières années. Pour détourner une citation célèbre « le XXIe siècle sera poétique ou ne sera pas ! ».
Cet « état poétique de la langue » ne serait-il pas dans la démultiplication des potentialités du signe à « vouloir dire » hors de son emploi usuel ?
Comme je te le disais précédemment, je pense que ce qui est actuellement « l'emploi usuel » est un sous-emploi des potentialités de l'expression, qu’il s’agisse de l’expression écrite ou orale. Parler est un jeu, chaque époque en a fait un usage lié aux modes et usages du moment. Je pense que nous pourrions envisager de mettre un peu plus de poésie dans le sens de ce que nous exprimons. Ça ne signifie pas qu'il faille rendre la langue éthérée ou forcée mais simplement qu’il faut tenter de mettre plus de vie, d'humour, d'amour ou de dramatisation dans ce que l'on dit. Cette époque est terriblement prosaïque, c'est une traduction de la façon dont la grande majorité d'entre nous l'appréhende, la vit et la fabrique au quotidien. C'est terrible de le constater et la seule façon de résister, car il s'agit bien là d'une forme ouverte de résistance, c'est de teinter de poésie sa vie et la façon dont on communique.
Pour ce qui est de l'expression écrite, et plus précisément de la composition de textes (car on compose un texte comme une image ou une partition) je ne pense pas qu'il s’agisse comme tu le dis, de « démultiplication ». Je préfère penser qu'il y a un sous-emploi du potentiel, et qu'il faut s'attendre à ce que dans un futur proche, on puisse plus communément utiliser des façons plus personnelles de faire s'exprimer le contexte graphique de la mise en scène de l'écrit. Nous dirons que ce qu'il reste encore à traverser de XXIe siècle sera poétique ou ne sera pas one more time :-). Cet innocent petit émoji-smiley n'est que la préhistoire de ce parcours.
Est-il possible de maîtriser l’orientation de la réception d’une œuvre ? Le destinataire n’a-t-il pas une subjectivité, dont feraient partie son vécu et ses savoirs, qui motive les modalités de son décodage d’une œuvre d’art ?
Bien sûr, le créateur d'un travail artistique n'est que l'émetteur d'une quantité d'informations qui se recroisent avec le récepteur. L'intérêt n'est pas de faire une œuvre ouverte, ou soi-disant ouverte, qui serait universelle. Ce serait faire preuve d'une immense prétention doublée d'une inconscience qui frôlerait la correctionnelle… Non, il s'agit d'envoyer des signaux au-delà de la perception-préception commune. Le « destinataire », que je nomme récepteur car l'humanité est de plus en plus télépatate, a sa propre lecture de ce qu'il reçoit, liée, bien sûr, à sa culture et à son vécu, mais aussi au croisement immédiat, aux heurts qu'il découvre. Plus le heurt est important et plus l'impact souhaité par l'émetteur est abouti. Je trouve cette notion apparemment « froide » d'émetteur-récepteur assez juste. Je perçois cet échange comme une partie de ping-pong ou de bataille navale sur un cahier d'écolier. Ce n'est qu'un jeu et les soi-disant grands amateurs d'art qui se pâment devant des « Œuvres » ne font que masquer leur manque d'immersion dans les gros bouts de poésie que l'artiste leur envoie. Comme dans tout ce qui confère socialement un peu de pouvoir il y a toujours des spécialistes auto-proclamés qui s'accaparent le décodage, mais la plupart sont à côté de la plaque tournante du monde dont ils parlent.
Vous évoquez le fait que naissent de nouvelles habitudes de lecture de la poésie, liées à l’utilisation de l’internet. Effectivement, le poème, fragmentaire par essence, peut être lu sans avoir nécessairement besoin du contexte offert par le livre pour exprimer toute sa portée sémantique. Ne pensez-vous pas toutefois que le livre représente une globalité qui apporte un sens supplémentaire à la lecture d’un texte même fragmentaire ?
Je pense que chaque support a un apport en rapport au port d'attache qui a vu ses liens se briser au-delà des océans d'incompréhension qui le séparent des autres. Certains sont complémentaires, d'autres cantonnés à des rôles précis de transmission, mais comme c'est un jeu il est toujours agréable de brouiller les œufs de la gestation du sens.
Le livre est un support qui a déjà des centaines de façons d'être. Il n'y a pas que la production industrielle de livres, il y a des tas d'utilisations de l'objet, de son usage et des centaines restent à inventer, ce qui est intéressant c'est que rien n'est figé et que tout est en perpétuelle ré-invention. Le livre n'est qu'à un des tournants de son histoire et il en aura beaucoup d'autres. La production industrielle (imprimerie de masse) l'avait cantonné à un rôle de support. Aujourd'hui il est plus aisé de chercher des informations sur l’internet que de lire tout un livre technique. Donc le support retrouve une fonction principale de transmission de sens et d'émotion qu'il avait acquise, et avec les possibilités techniques actuelles on peut s'attendre à de belles surprises. D'ailleurs il y en a déjà beaucoup depuis vingt ans et elles ne sont plus uniquement expérimentales et confidentielles depuis de belles lunettes ! Tant qu'il y aura un livre à rêver de faire, le monde sera fascinant, there is no final frontier !
Selon vous, de quelles manières les nouvelles technologies pourraient-elles contribuer à une métamorphose de l’objet livre ?
Well, je ne pense pas que les TIC puissent faire « évoluer » l'objet livre. Il y a déjà eu des tas de tentatives et de magnifiques réussites dans ce que l'on a nommé au tournant du siècle dernier « le multimédia » : des CD Rom experimentalo-grenadine des années nonante aux sites web turbochiadés, en passant par les applis pour tablettes. Mais pour ce qui est du livre « imprimé » sur du papier, la mise en scène graphique est LA chose qui peut évoluer et approfondir l'usage de l'objet, du moins c'est principalement là que j'y trouve un intérêt, en tant qu'auteur. Il y a bien les entités « cross-media » qui associent divers media pour une lecture multiple et complémentaire du contenu. Mais c'est souvent assez poussif et les spécialistes auto-proclamés de la question n'ont en général qu'assez peu de poésie dans leurs façons de concevoir. Cela signifie d'une part qu'il y a beaucoup de chose à inventer. Sans doute le terrain n'est-il pas encore saturé de scories marchandes et utilitaristes, et aussi que la porte est ouverte à l'expérimentation. On peut hélas constater que bon nombre des travaux réalisés sont centrés autour de la seule performance technique et que le maître mot utilisé par les afficionados du genre est « bluffant »… ô tempora, ô vision limitée… Je pense que le livre papier, le simple objet qu'il représente, a énormément évolué au fil des siècles et des cultures, et qu'il y a encore énormément de chose à en faire pour ne pas avoir à chercher du côté de ce que le monde contemporain qualifie de « nouvelles technologies ». Mêler la forme au fond dans un objet imprimé qui n'a besoin que de doigts très légèrement humectés pour faciliter le tournage de ses pages laisse encore une infinité de possibles sans recourir à l'électrique et au numérique. L'odeur de l'encre mêlée à celle du papier a encore de très beaux jours devant elle.