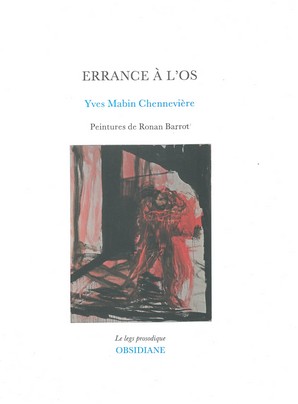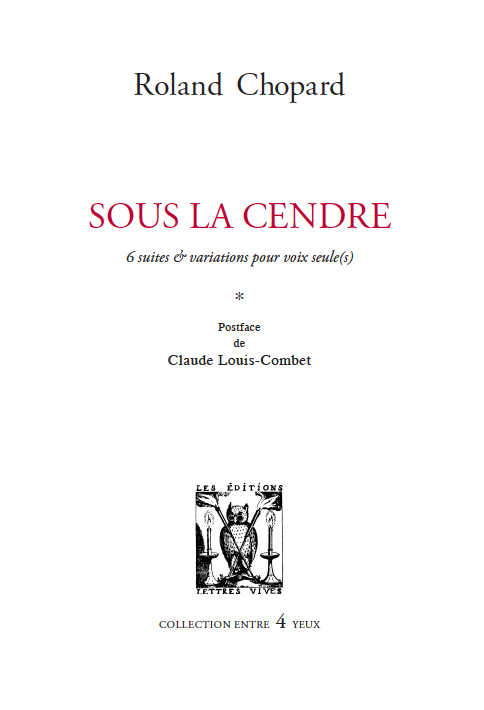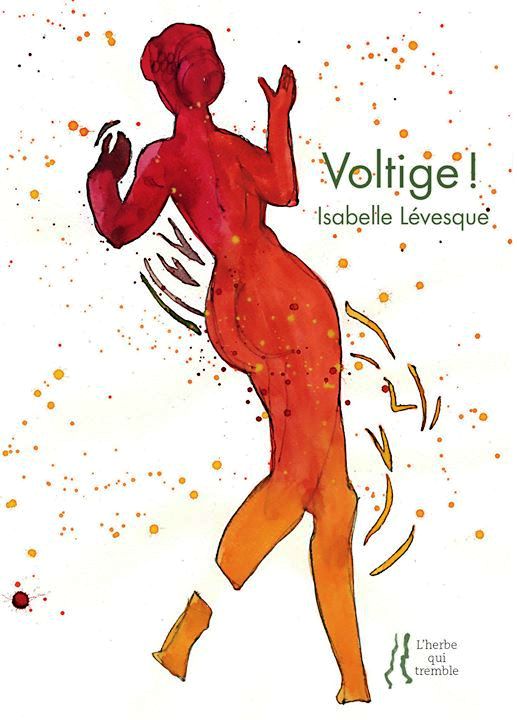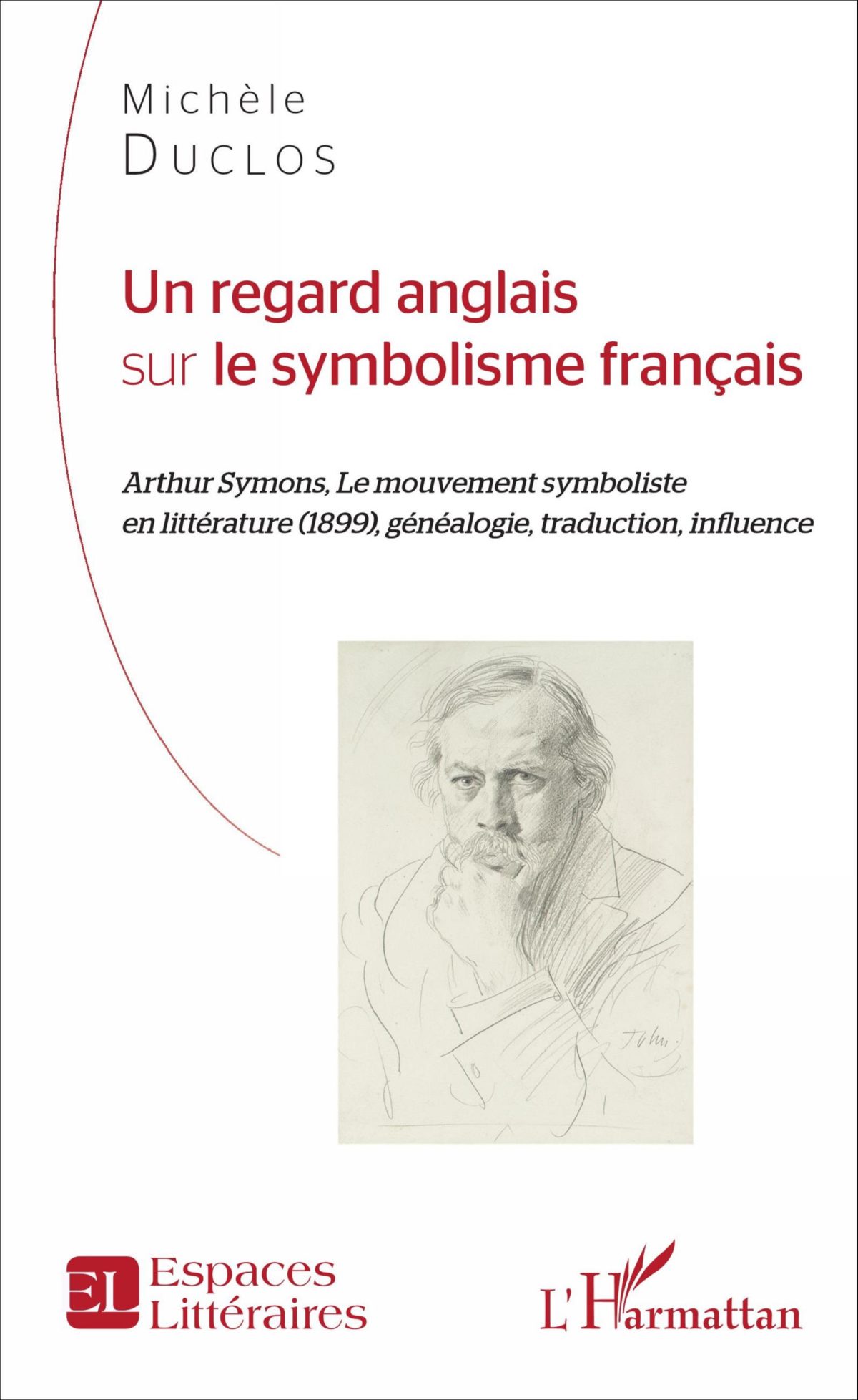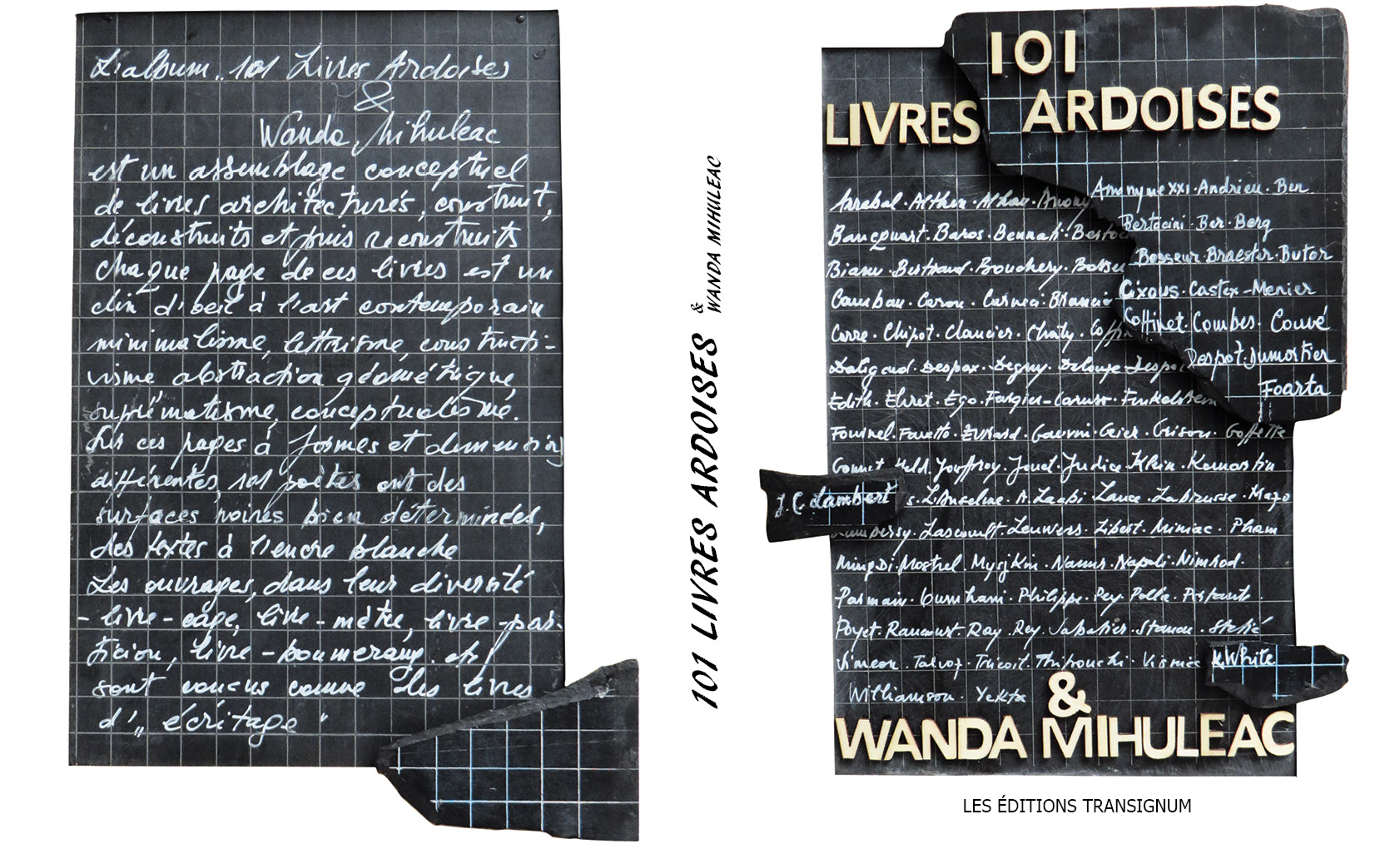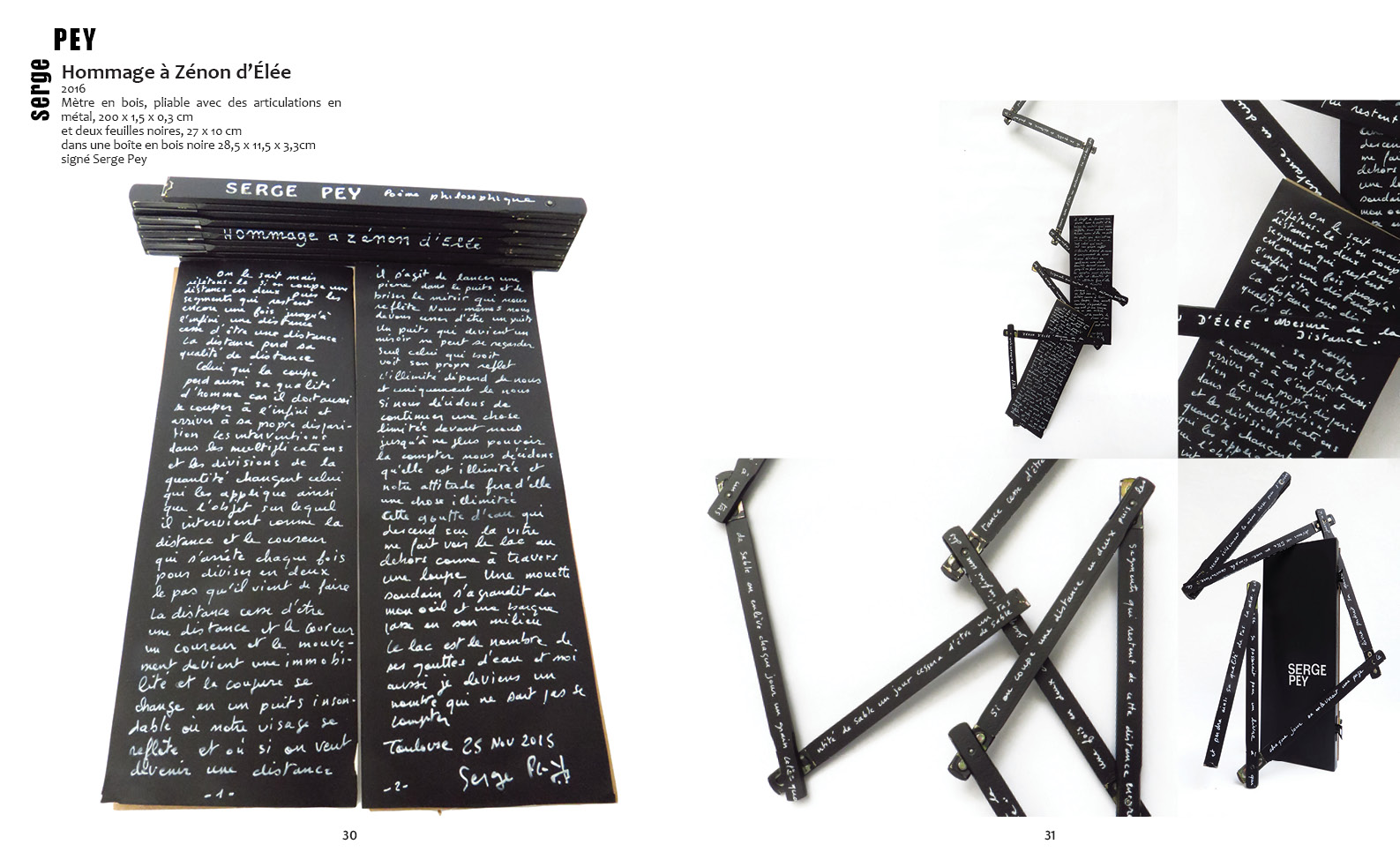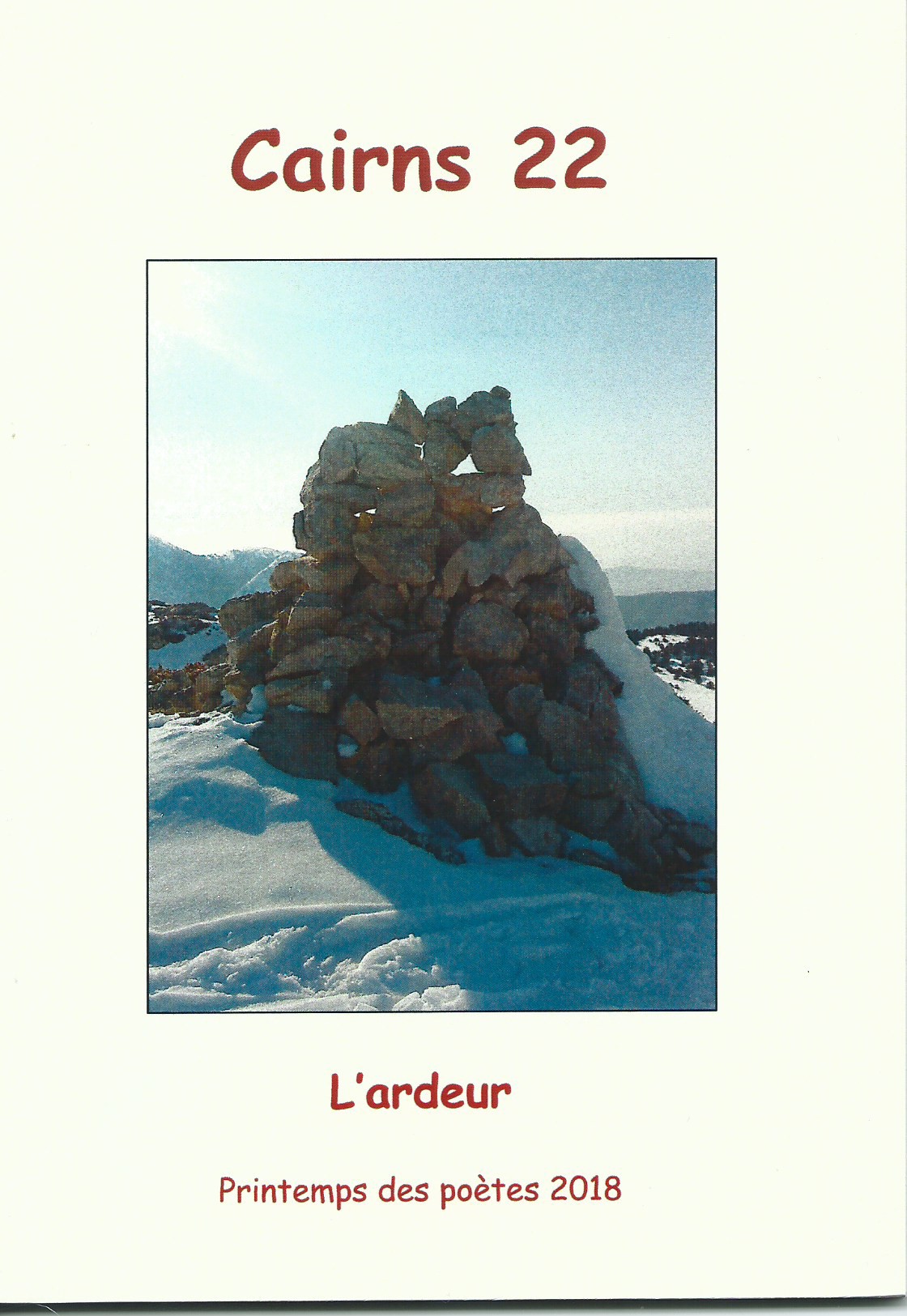André Velter, N’importe où
Etre ou devenir poète ? Telle a été la question – peut-être absurde - que je me suis d’abord posée en ouvrant ce recueil de poèmes d’André Velter, mais ensuite - et surtout - en consultant ce qui est hors du champ poétique (les humains avides, les propos d’une rationalité outrancière, etc.).
Comment ces non-poètes et leur non-poésie peuvent-ils cotoyer ou secréter des mots ou des esprits… poétiques. D’où émerge la fragile capacité d’élaborer un univers distinct ? Est-ce un « voyage » de l’esprit qui s’élabore peu à peu, tout en engendrant ou en s’enrichissant de « résonances » diverses avec le monde et les autres, comme le suggère l’auteur? Et ma vraie question, la poésie précède-t-elle ces mots pour la dire ? Se trouve-t-elle déjà dans la nature (l’élan de cimes d’Himalaya) ou la conjonction nature-culture (puissance des fresques de la grotte Cosquer)? Ces derniers jours de neige ont engendré tant de photos émues de ville ou de paysage magnifié par le blanc… Etait-ce une démarche poétique? pré-poétique ? Bref, serions-nous tous poètes, attendant seulement l’heure de le manifester, de le devenir ? Je poiêsis, tu poiêsis, il….

André Velter, N’importe où, Livre-récital + CD avec Jean-Luc Debattice et Philippe Leygnac, dessins Ernest Pignon-Ernest, Le castor astral, 118 pages, 18 euros, 2017
De certains êtres, il est dit qu’« ils sont poètes ». Certains l’affirment eux-mêmes : « Je suis poète ». Une telle assurance impressionne. Etre ou ne pas être poète ? Qu’est-ce à dire ? Comment avouer son âme poétique ? André Velter propose – une nouvelle fois - dans cette publication de croiser les mots et les sons (musique et lecture par des comédiens-musiciens, Jean-Luc Debattice et Philippe Leygnac), tout en y adjoignant les esquisses amies d’Ernest Pignon-Ernest((L’une propose une version sublime de L’origine du Monde de Courbet.)). Telle est sa façon de vivre la poésie, mêlant le sens (au sens de signification) de ses propres mots aux délices des sens (au sens de sensations) auditifs (diction, chant et musique) et visuels (dessins). Corps et esprit entremêlés donc, cherchant en toute amitié ici des correspondances, là un dialogue, partout des échos. Comme si son propre pouvoir de création - vraiment créatif - cessant d’être individuel, s’élaborait désormais à plusieurs, en une indistinction originelle. La poésie nait-elle de cet ensemble artistique ou devient-elle l’œuvre impulsée par le poète Velter? Une poésie chantée, rythmée, modulée, sculptée sur la musique et accompagnée de dessins (visages et corps). Une poésie autre, mobile, « à voix haute », une sorte de lente caravane – en devenir - sur la route d’une soie poétique. Peut-être. En recherche. Faut-il inscrire dans le choix métrique cette légère préférence du poète pour des quatrains, dont le refrain – on sent qu’il a été lu et relu mille fois à voix haute - cadence certains poèmes. Il est un leitmotiv qui sonne parfois comme un point d’orgue de son discours ou de sa sensibilité. De même, la rareté des ponctuations révèle sans doute la puissance primordiale d’un souffle inspirateur.
Le titre du présent opuscule N’importe où s’inscrit dans le vertige de Rimbaud : « Au revoir, ici, n’importe où (….) En avant, route. » (Démocratie, Illuminations). Un tel salut a-t-il été emprunté subrepticement à Baudelaire (« N’importe où ! pourvu que ce soit hors de ce monde », Le spleen de Paris) ? Qui sait ? Tant et si bien que la démarche de Velter s’inscrit cahin-caha dans une généalogie secrète de la pensée poétique Baudelaire-Rimbaud-Velter: une sorte de cheminement qui mène n’importe où (c'est-à-dire quelque part !) au risque de mener nulle part (un quelque part dissout en quelque sorte). Le poète, quant à lui, estime s’être « délivré d’Arthur » par la compagnie de Guillaume Apollinaire. Pourquoi pas ? C’est sans doute celle de l’Apollinaire du poème Mai (Alcools).
Comment se déploie le voyage en ses écrits ? A-t-il un commencement conduisant vers une fin ? Le départ du poète est autonome : « encore naître de son propre élan ». Il est emporté par un mouvement : « changer en griffes les marques du vent ». Le promeneur passe à l’acte en grande liberté : « j’ai appris en marche la mappemonde ». Pour découvrir cet « univers-là », il lui suffit de « tourner le coin de la rue » et de « partir soleil en tête ». Il se laisse conduire pour aller « où que ce soit ». Il circule sur la « main road » où tracteurs et bétonnières progressent « au pas des dromadaires », une vraie « coulisse de l’enfer ». Il parcourt les villes d’un « Cities blues » (Aden, Zanzibar, Samarkand, Tombouctou, etc.) qui « chantent dans nos mémoires ». Il approche l’Atlantique réel, là « où Tanger marque la fêlure du grand océan » en proie « au ressac incessant des vagues et des songes ». Il frôle des lieux mythiques et progresse en « galère pour Cythère », un galère qui « a pris l’eau/on ne va pas toucher la terre de si tôt ». Ainsi est vécu ce « galop tonique de mots et d’échos » (4e de couv.). Et pourtant « il ne suffit pas de reprendre la route », répète le poète ensorcelé. Qu’advient-il ?
Une telle excursion dans l’espace n’est pas celle d’un solitaire, mais celle d’un allié des arts (chant, musique, etc. ): « à l’oreille, il faut courir le monde ». Les chants de femmes entendus y sont frangés de tristesse : d’abord celui de Georgina Smolen, chantant Le saule((Georgina, dont Musset dit qu’elle est « un jeune rossignol pleurant au fond des bois »)). Puis celui de Billie Holiday, « Lady Day affligée » ou « Bad Billy perdue », qui avance seule lors de son « ténébreux » et « impossible voyage ». Le seul homme, Louis Amstrong, chante un hôpital, Saint James, en une « marche immobile ». Le son du «piano-bar » remplace ensuite les complaintes, pour dire que « la vie n’est plus que le frisson d’un doux désastre ». De l’instrument, le poète passe aux danses. Au swing d’abord, cette danse « aux chevilles folles » : « encore un swing/poussé au blues/au bas du ring » qui est l’équivalent musical du spleen. (Ce poème semble un écho de La mort des amants de Baudelaire avec ses miroirs/ange/tombeau ?). Au tango ensuite, ce tango d’amour qui se danse avec « une robe calcinée » sur des « cuisses de feu » (réminiscence de Lorca, La femme infidèle ?).
Au terme de cette errance, se trouve la mort : « l’amour à mort/en avalanche ». On entend le « cri du Minotaure » : « ici le cœur sonne/au corps à corps de nos défis ». Il y a ce cri ultime de celui qui a entendu l’écho de la voix aimée et a touché ses songes : « Tournons, veux-tu/au coin de cet univers-là : qui avec du sol, des mélodies, et des cendres/a fait de l’infini le dernier rendez-vous ». On découvre Nada cette « femme du néant », car nada est le rien en espagnol (mais nahda est aussi la renaissance en arabe, pourquoi le lecteur ne ferait-il pas aussi voyager le son?). On écoute alors cette prière pour le repos des morts « requiem express », lors d’une cinquième saison « hors calendrier » « pour finir en beauté ». Nous, on ne peut plus que se taire à voix haute aussi, oublier même la présence attentive à d’autres morts du 61 rue de Richelieu((où Stendhal écrivit ses Promenades dans Rome)) ou de toute autre rue parisienne.
n.b. Une question : qu’est le « fuel incomburé » (p. 66) tributaire « du pas des dromadaires » ?