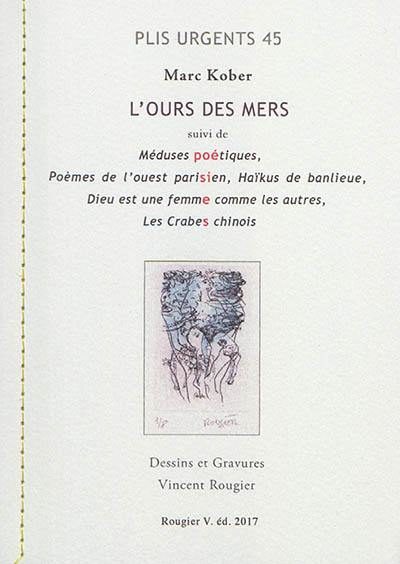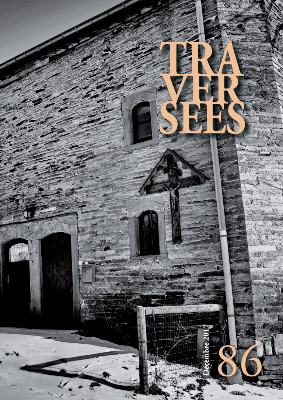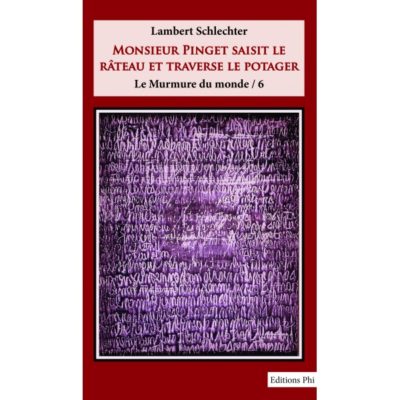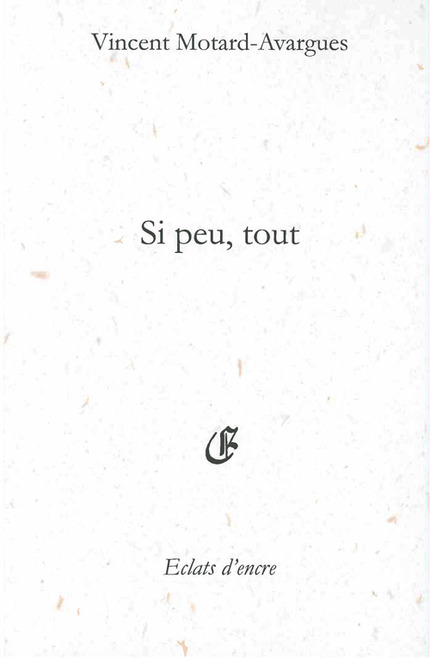Thomas Chapelon, Ce vivant parmi les cendres
Dans la collection Dialogue, aux Editions L'Arachnoïde, Ce vivant parmi les cendres, un très beau livre d'art de Thomas Chapelon magnifiquement illustré par Thomas Pesle.
Vivant oui vivant mais parmi les cendres, celles d'un monde et d'un « temps détruit ».
Les mots flottent parmi les cendres, ceux du poète lancés à la verticale à travers la page, celles du peintre en regard des textes, traces improbables distillées en éclats de lumière.
Traces effacées, souffle vaincu, structures fragiles, des cieux noircis, des sols embourbés, pollution et matières, cendre pure masse difforme éclatée « de l'outre monde ».
Des cendres seulement des cendres, « pas de fumée », « pas de lumières », une apocalypse de mots tombés dans le vent, soufflés, éperdus, entre le geste et le dire où seul l'instinct de vivre,
ce qui n'est advenu et adviendra

Thomas Chapelon, Ce vivant parmi les cendres, encres de encres, Editions L'Arachnoïde, juin 2016
Quand ce qui advient avec l'écriture, en équilibre sur ce monde défait, est fait d'ombres, cinétique de l'absence, archéologie des tréfonds, des cavernes, un « chef-d'oeuvre d'abstraction » où la folie collabore avec la douleur, où les gémissements imprègnent tout à la recherche de l'Homme nouveau.
Dans le mouvement incessant du non-être se débat l'être, une danse archaïque frappée du sceau de la finitude. L'artiste avance à la recherche d'un sens authentique, dans les aspérités du temps, dans les cendres noires, dans les mines à charbon, dans les guerres, dans l'ombre des charniers, dans les traces du troupeau...
Le récit poème est un chant de détresse. On reste à la surface entre ciel et terre comme suspendu, comme à chaque fois dans la poésie de Thomas Chapelon, entre violence et fragilité.
On est parmi les cendres conjurant le sort fait aux mots qui démultiplient l'appel, de la couleur, celle même des cendres, en condensation d'un vouloir infini, terres rouges, ocres, rouges encore...Mais il n'y a pas que les cendres qui sont rouges, rouge le sang, rouge l'émeute,
les mots se réservent
la sentence d'exécution
Les variations dans les encres épousent les textes. On passe des cendres noires sur fond or, dispersées, à des plages blanches tapissées de taches bleutées, l'or de la terre, le noir du ciel, tumultes au milieu, destruction de matière, retombées imaginaires, visions spectrales d'un reste d'humanité, lumières évanescentes dans le brouillard, éclatements et flammes mordorées jusqu'au rouge incandescent des trois dernières toiles, aveuglantes.