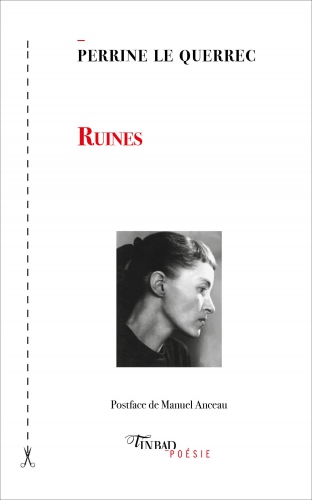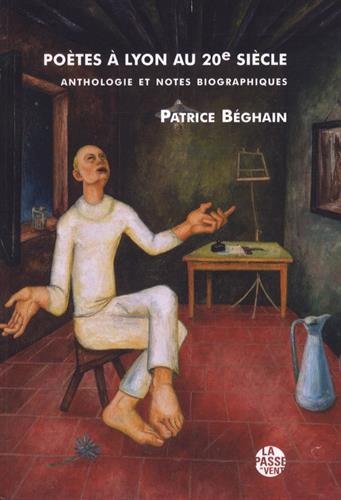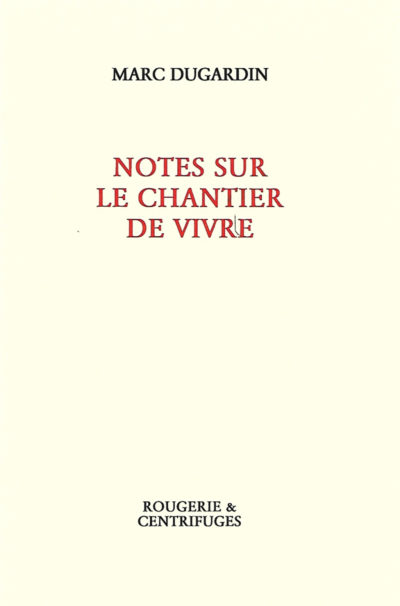À la pêche
« Il en va de la pêche comme des fraises, comme le disait le Docteur Boteler : Pour sûr, Dieu aurait pu créer une meilleure fraise mais, pour sûr, Dieu ne l’a jamais fait. Et donc, pour autant que je puisse en juger, Dieu n’a jamais créé de divertissement plus calme, plus tranquille, plus innocent que la pêche à la ligne. »
Izaac Walton (The Compleat Angler, I, v, 1577).
Quand je suis né, mon père avait soixante ans. Ma mère avait vingt ans de moins que lui. Il est mort quand j’avais douze ans, et elle il n’y a pas longtemps. Elle disait souvent que c’était le plus bel homme qu’elle avait rencontré. Pendant ses longues années de veuvage, je doute fort qu’elle ait jamais regardé un autre homme.
Je crois que j’ai été plus proche d’elle que je ne le fus de mon père, Jack. Mais c’est à propos de lui que j’écris, pas de Maureen, ma mère. Je l’ai à peine connu. Sucrait-il son thé ? Préférait-il la tarte aux pommes à celle à la rhubarbe ? La couleur de ses yeux ? Je n’en sais rien. Le temps que je grandisse assez pour comprendre que tout n’est pas rose en tout jardin, il avait disparu.
Il avait deux frères, Steven et Bill, de vrais jumeaux qui habitaient la ferme d’à côté, petite, elle aussi. La route du village passait entre nous et eux. Lorsque je les ai interrogés, des années après, quand la roue avait commencé à tourner, ils m’ont dit qu’il n’était pas fait pour les enfants. Je dis « ils » parce qu’ils avaient tendance à partager la même phrase. Le fait est qu’ils se ressemblaient tellement que c’est seulement lorsque Steven est mort que j’ai pu dire « Comment ça va, Bill » en étant sûr de ne pas me tromper. Un photographe de l’Evening Press avait entendu parler de leur ressemblance et les avait pris en photo. Un an après Steve, Bill s’en est doucement allé. Ils avaient couché dans le même lit toute leur vie. Jimmy, c’est comme ça qu’ils m’appelaient toujours, Jimmy. En vérité, mon nom de baptême c’est James John, d’après mon grand-père maternel, mais tout le monde m’appelait Seamus.
Nous vivions dans une petite ferme, culture et élevage, en bordure du comté d’Offaly. Ma mère disait que la terre était si bonne qu’elle valait plus que la plupart des exploitations deux fois plus grandes. Mon père aimait le progrès. Nous sommes l’une des premières familles du pays à avoir produit notre propre électricité. Avec les jumeaux et quelques voisins, ils avaient détourné la rivière vers un canal qu’ils avaient creusé pour amener l’eau à un bief. Une roue à aubes donnait l’électricité. On la conservait dans des accus en verre et il en arrivait assez chez nous pour une ou deux ampoules et un poste de radio.
Gamin, tout cela me dépassait. Ce que j’aimais faire avec lui, c’était aller à la pêche dans cette rivière qui apportait chez nous la lumière et le son. Les cannes en bambou refendu étaient accrochées dans la cuisine, là où on pendait jadis le bacon. Peut-être bien que c’est ma mère qui avait mis les crochets pour donner à la maison un air plus vieux que son âge. Elle avait accepté de se marier à condition de s’installer dans une ferme neuve. Le mariage avait été arrangé. Je crois bien qu’en ce temps-là c’était toujours comme ça chez les paysans.
Les deux cannes avaient cette élégante et légère voussure typique de celles qui ont servi ; les moulinets ronronnaient plus qu’ils ne cliquetaient quand on prenait du fil pour le lancer. Je ne sais pas si je suis demeuré ou non, mais je suis capable de vous poser une paire de mouches à trente mètres, exactement où je veux. J’ai ça dans le poignet. Mon père avait ça aussi mais, en plus, il lui suffisait de jeter un coup d’œil au ciel pour dire : ce soir ça ne mordra pas. Une ou deux fois j’ai pris ma canne et je suis descendu à la rivière après l’avoir entendu dire ça : ça n’a pas mordu, ce n’était que du « trempage de mouche », comme on dit. Les poissons passaient au-dessus de la mouche sans y toucher.
Avec nous, les gosses, il n’avait jamais été du genre bavard et le filet de ses mots avait fini par se tarir. Quand on partait pêcher et alors qu’on se rapprochait de l’eau, il disait « Chut ! ils vont t’entendre. » Je ne comprenais pas comment des truites, dans une rivière, pouvaient entendre deux êtres humains ; un seul, en fait : moi. Je n’arrêtais pas de jacasser ou de me faire des messes basses quand j’étais gosse. Arrivé sur la berge, il choisissait son emplacement et me soufflait : « Va jusqu’au fossé de Dwan », à environ cent mètres plus haut. « C’est aussi un bon coin. » Je remontais silencieusement jusqu’à la limite et me mettais à pêcher. Un martin-pêcheur passait dans un bruissement d’ailes et, plus tard, des chauves-souris faisaient de la voltige. J’ai toujours eu peur d’accrocher une chauve-souris au lancer. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n’est jamais arrivé.
Quand je dis « pas bavard », je veux dire qu’il avait quasiment cessé de parler aux gens pour de bon, pour autant qu’il m’en souvienne. Il « avait ses nerfs », comme disait ma mère. Ses nerfs. Ses nerfs allaient mal. Je ne voyais pas comment des nerfs pouvaient aller mal ou comment on pouvait les avoir, mais je voyais bien le résultat.
Nous pêchions le soir. Les petits exploitants ne pêchent pas le jour, pendant les heures de travail. Les Chenevix Trench, eux, pêchaient dans la journée. Mon père, du temps où il parlait, m’avait raconté comment le sien avait racheté nos terres aux Chenevix Trench en 1875. Des années plus tard, je suis allé à la pêche avec le vieux Chenevix Trench. Lorsque mon premier recueil de poèmes a paru, il en a commandé six exemplaires et m’a demandé de les lui signer. Là, je me suis senti dans la peau d’un auteur.
Les soirs où mon père et moi on allait à la pêche m’emplissaient d’une béatitude si douce et si intense que je nous revois toujours traverser les herbages de devant pour aller à la rivière en évitant les bouses de vache un peu comme à la marelle, dans toute cette herbe nouvelle. Ça sentait un mélange de tout ce que pouvait offrir un soir d’été. À part son « Chut ! ils vont t’entendre » mes oreilles ne captaient que les borborygmes des bovins qui ruminaient. Nos vaches avaient toutes un nom.
On prenait toujours quelque chose. Avant de partir, Jack avait choisi les mouches qui intéresseraient les poissons : des Greenwell’s Glory, une Red Spinner ou, peut être une Black Midge. En juillet, il choisissait plutôt une paire de Green Drakes. Il n’a jamais eu besoin d’ouvrir un poisson pour voir ce qu’il avait dans le ventre. Dans le noir, les truites ont tendance à gober la mouche et ça ne fait guère de pli. Même pas une éclaboussure. Rien que la ligne qui se tend.
Quand on rentrait, il ne devait pas être très tard parce que ma mère en mettait toujours quelques-unes à la poêle, sur le gaz, à revenir dans du beurre de sa fabrication. Une pincée de sel et une tranche de pain blanc au bicarbonate. Et encore du beurre.
Et puis, on n’est plus allés à la pêche. Pas à cause de la saison ; ça s’est arrêté d’un coup. Enfant, je ne m’étonnais pas que maintenant, le dimanche, on aille à Clonmel (ou Borrissoleigh, ou Thurles, ou Cashel), avec notre mère, dans un hôpital qui soignait les gens pour « les nerfs ». Je ne trouvais pas bizarre qu’on nous laisse dans la voiture tandis qu’elle allait le voir. Nous étions les trois plus jeunes de cinq. Les deux aînés, qui faisaient des études, avaient des boulots d’été et n’étaient pas si souvent que cela à la maison. Une fois, j’ai vu mes parents se promener dans le parc de l’hôpital et je me suis dit qu’il allait me reconnaître, à l’arrière, et qu’il allait venir me dire quelles étaient les meilleures mouches pour la saison. Il n’a jamais tourné la tête de notre côté.
Quand Jack est revenu chez lui, la saison touchait à sa fin. On nous avait dit de ne pas « l’embêter » car il n’était pas encore remis. Comme je maudissais ces « nerfs » ! Mais j’avais douze ans et je savais très bien que, pour « les nerfs », il n’y avait rien de mieux que d’aller à la pêche. C’était le remède infaillible. Un soir, après souper, je suis monté en douce jusqu’à la porte de la chambre de mes parents. Il ne quittait déjà plus son lit. Je lui ai dit à l’oreille que je ne voulais pas que maman sache que je l’embêtais à lui demander si c’était un bon soir pour décrocher les cannes. Décrocher les cannes, c’était notre façon de dire qu’on allait à la pêche. Comme il me tournait le dos, je n’ai jamais su s’il avait les yeux ouverts ou fermés. Il a dit « Non ». C’est le dernier mot qu’il m’ait jamais adressé.
inédit
***
Seamus resta très proche de sa mère (qui devint vite aveugle). Vous remarquerez que le poème de Rilke lu à Paris (Shakespeare and Company, 2016) est étroitement lié à celui qui suit, extrait de Choix de poèmes.
Damas
À Maureen Hogan
Mince consolation peut-être de savoir que les villageois
déroulent un tapis de voix basses quand on te mène à l’église le
dimanche. Que, risquant un regard de biais vers ton banc, c’est un
aperçu de leur vie qu’ils gagnent
dans ce vide qui fait l’effet d’un miroir.
Quand tu entends ces prières pour les malades
sous l’ogive des mains du prêtre, que vois-tu ?
Qu’entends-tu ? La glace sur le chemin de l’étable
l’hiver dernier ou la chute de quelque pomme
d’octobre. Qui jamais plus ne craquera, jamais plus
ne traversera ton regard.
Un jour, te croyant seule, tu as eu le frisson.
Puis, tels des fruits transparents, deux larmes
se sont détachées de ta branche de souffrance.
Un sanglot –déjà trop lourd pour tes mains– a brisé le silence qui s’est
vite fendu jusqu’aux rivages de ma vue,
y a dévoilé un torrent d’impuissance.
Parfois, aux prises avec un pois rebelle dans mon assiette vide, où à dire :
« cette fille est vraiment jolie »,
j’ai le sentiment d’ouvrir une lettre
qui ne m’est pas destinée.
Choix de poèmes, 1996.
***
Advice
When you are drunk
Write away-
As much as you want!
You’ll sober up.
But remember,
What you’ve written will not.
Conseil
Quand tu en tiens une bonne,
Noie-la dans l'encre
Jusqu'à plus soif !
Tu dessoûleras.
Pourtant sache bien
Que tes mots seront toujours pleins.
(variante, pour qui verrait double)
Quand t'as trop bu,
Mets-toi à écrire
Jusqu'à plus soif !
Ça rince eul’ cochon.
Mais rappelle-toi,
Les mots, ça n’dessoûle jamais.
***
Heron, West Cork
Near a pool
Surrounded by crashed clouds of rock,
Stands a heron.
In its beak
The X of a frog
About to make his final ‘plop!’
The heron collects itself,
Tip of the beak first,
Then all the way down
To the tips of its claws
And draws itself up, up into air.
Héron, Cork ouest
Au bord d’un étang
Au creux de nuages de rocs écrasés,
Un héron est planté.
Dans son bec,
Une grenouille en croix
Va faire son dernier ‘gloup !’
Le héron se concentre :
Ça lui part du bout du bec,
Ça lui descend
Jusqu’au bout des griffes,
Et, d’un coup, il décolle.
***
Untitled (Mai 2006)
In the orchard
Our dog Mr. Lynch
Rolls in his own happiness.
Framed by Marybrook pond,
A heron.
Still life
On the easel of himself.
Across the river
Sunshine butters Knocknanuss
With furze blossom.
Sans Titre
Sous les pommiers
Mr. Lynch, notre chien,
Se vautre en plein bonheur.
L’étang de Marybrook entoile
Un héron.
Nature morte
Et chevalet d’échasses
Sur l’autre rive
Le soleil roussit Knockanuss
Au beurre d’ajoncs.
***
Mizen Sky
From the upside down saucer
Of an evening in this July sky
A nearly full moon laps cloud.
An invisible boat
With propellers of starlings
Heads west.
As silent as smoke
Bats waft from the barn
Into Sunday evening.
Sur le Cap Mizen
À la soucoupe retournée
D’un soir dans ce ciel de juillet,
Une lune boit, presque pleine, son nuage.
Une nef invisible
À pales d’étourneaux
Met cap à l’ouest.
La grange en silence exhale
Des bouffées de chauves-souris
Dans la fin du dimanche.
***
Territory
For Hannah
Before settling for the evening
A cock pheasant
Hammers in stakes of sound.
Then applauds himself.
After a pause
Smaller birds
Trellis the in-between spaces.
Terrain
Pour Hannah
Comme des pieux que l'on bat
Un faisan clappe
Sa fin de journée.
Puis il s'applaudit.
Un ange passe
Et de moindres volatiles
La palissent de trilles.
***
Starlings
From their control tower
The nest of chicks
Guide in their parents
On a runway of cries.
Following the briefest turnaround
Take off across the backyard
Is over a broken white line
Of birdshite.
Étourneaux
De sa tour de contrôle
La nichée d'étourneaux
Piaille pour les parents
Les balises d'une piste.
Virage au plus court et
L’envol derrière la maison
Suit le pointillé blanc
d'une ligne de fientes.
***
En arrêt
Our train has stopped
But the platform seems to move.
Your book is closed
And that poem moves me still!
Gare
Notre train est à l’arrêt
Pourtant le quai semble bouger.
Ton livre est fermé
Mais, là, ce poème me remue !
***
Whoosh
A murmuration
Billowing black.
For whose sake?
A whiteness of swans
Wedge into flight
Above the lake.
Tilted by the wind,
Billowed white.
Fchouff…
Une nuée noire joue
Les houles de nuit
Pour qui, je vous prie ?
Une candeur de cygnes
Pointe sa flèche
Au-dessus du lac.
La rafale en lève
La houle blanche.
***
Cloghroe
For Trish
We pass each other
Between the walled and pleasure garden.
Flick a glance, flick it back.
Incline a smile
Incline it back.
Beguile those who may be watching
As we wander, pondering
Cloghroe
À Trish
On se croiseAu jardin entre murs et massifs.
Étincelle d’œil à œil.
Un sourire va
Un sourire vient.
On se promène, les curieux éventuels
En sont pour leurs frais
inédits