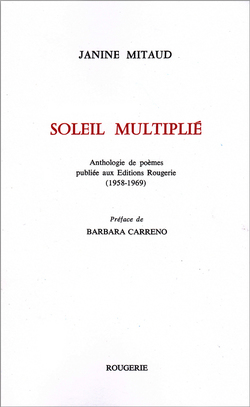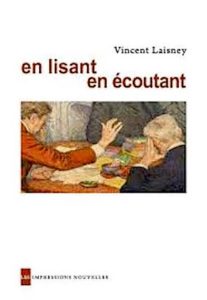Les cahiers de PAUL VALÉRY
« ...Et je jouis sans fin de mon propre cerveau » faisait dire Paul Valéry au locuteur de son sonnet intitulé Solitude. C’est ce qui amène Michel Deguy, dès la page 26 de sa préface, à souligner que « La grande affaire, la «grande chose» valéryenne, fut celle de l’intellect. », et ce constat implicite, qui constitue à la fois comme la nappe phréatique où aura puisé toute la réflexion de l’auteur du Cimetière Marin et de la Jeune Parque, et ce qui aura inspiré ici son préfacier, ce constat de l’essentiel souci de « l’esprit » chez un Paul Valéry qui cependant ne se voulait pas « philosophant », c’est ce qui permet à Michel Deguy d’ajuster sa focale concernant le contenu des cahiers.
En effet, Valéry, grâce à cette préface, est à la fois relié à nous, lecteurs d’aujourd’hui, mais aussi distancié de nous par diverses analyses qui démontrent de quelle manière le monde tel que se le figurait Valéry réfléchissant (éventuellement avec spéculations anticipatives), et le monde « homonyme » tel que nous le vivons, appréhendons, recevons actuellement, sous les apparences de la quasi-ressemblance, en profondeur diffèrent au point que même la signification-ressemblance de ces apparences est un mirage. Par exemple, relever à la lumière de notre pensée actuelle ce qui semblerait des traits « annonciateurs », « prophétiques », en ce que Valéry a développé comme idées diverses dans ses textes, les officiels, ou les, jusqu’à notre époque, non-officiellement édités des Cahiers (qu’il avait cependant toujours projeté d’éditer comme une œuvre majeure), serait une erreur de perspective du même genre que celle qui nous fait interpréter un texte de Platon avec les outils de la philosophie contemporaine.
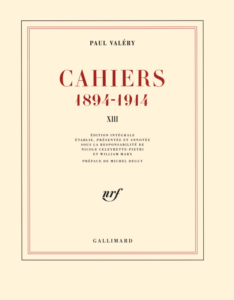
PAUL VALÉRY – Cahier 1894-1914 Volume XIII – Préface de Michel Deguy (NRF – Gallimard).
Entre les formules de Valéry, et les nôtres actuelles identiques, un glissement de réalité, une « substitution de substrat », se sont produits avec le siècle qui a passé : de 1871 (naissance de P.V.) à 1945 (sa mort), passablement de métamorphoses historiques se sont produites en 74 ans, la technique notamment a commencé à prendre de l’importance (à cause des guerres et de l’industrie). Mais de 1945 à 2018, c’est-à-dire une période à peu près équivalente, « l’imperium technologicum » si j’ose dire, a remplacé à grande allure le règne de l’Homme, entendons « de ce qu’il y avait d’humain » dans l’Humanité. Je n’entends pas évoquer les cyborgs, les robots, les transhumains, non plus qu’entrer dans les détails sur cette affaire du « déshumanisme », de « l’antigrandeur », points que la préface éclaire subtilement et nettement. Ce que je voudrais mettre en lumière, en revanche, c’est ce qu’il y a de profitable à retirer des écrits quotidiens de ce philosophe qui refusait de l’être, de ce mathématicien amateur épris de précision, de netteté, de ce poète pour qui poétiser n’était qu’un « exercice », comme il l’écrit à André Gide en dédicace. En effet, à le lire, j’ai ressenti une certaine fascination. Non que la pensée de Paul Valéry soit impressionnante à chaque page, certes ; non qu’elle n’apparaisse pas en divers endroits comme périmée ; mais parce qu’il y a entre elle et nous, en relativisant certes la comparaison, la même différence/proximité qu’on éprouve lorsqu’on travaille sur – mettons – un texte latin, par rapport à la traduction « moderne » qu’on voudrait en faire : quelque chose qui est à la fois de l’ordre d’une proximité qui efface l’abîme temporel, mais aussi de l’ordre du radicalement distant, d’historicisé, de vaguement démodé. Et cela oblige le lecteur curieux de Valéry et de sa pensée - sans cesse en train de s’aventurer, telle qu’elle apparaît dans les Cahiers -, à s’aventurer lui-aussi, en s’obligeant à une gymnastique assouplissante qui a pour effet la prise de conscience de ce que devient notre temps : car rien de tel qu’une similitude en apparence, hérissée de différences en réalité, pour retirer de la confrontation entre le monde de Valéry et les nôtres (du « monde fini » valéryen l’on est retourné à une multiplicité plus ou moins indéfinie de mondes contemporains), une lucidité nouvelle, un panorama en relief, une « vision stéréoscopique » propre à nous faire évaluer ce que j’appellerais le « site » d’où se parle et s’écrit la littérature, spécialement la poésie, de notre XXI ème siècle…