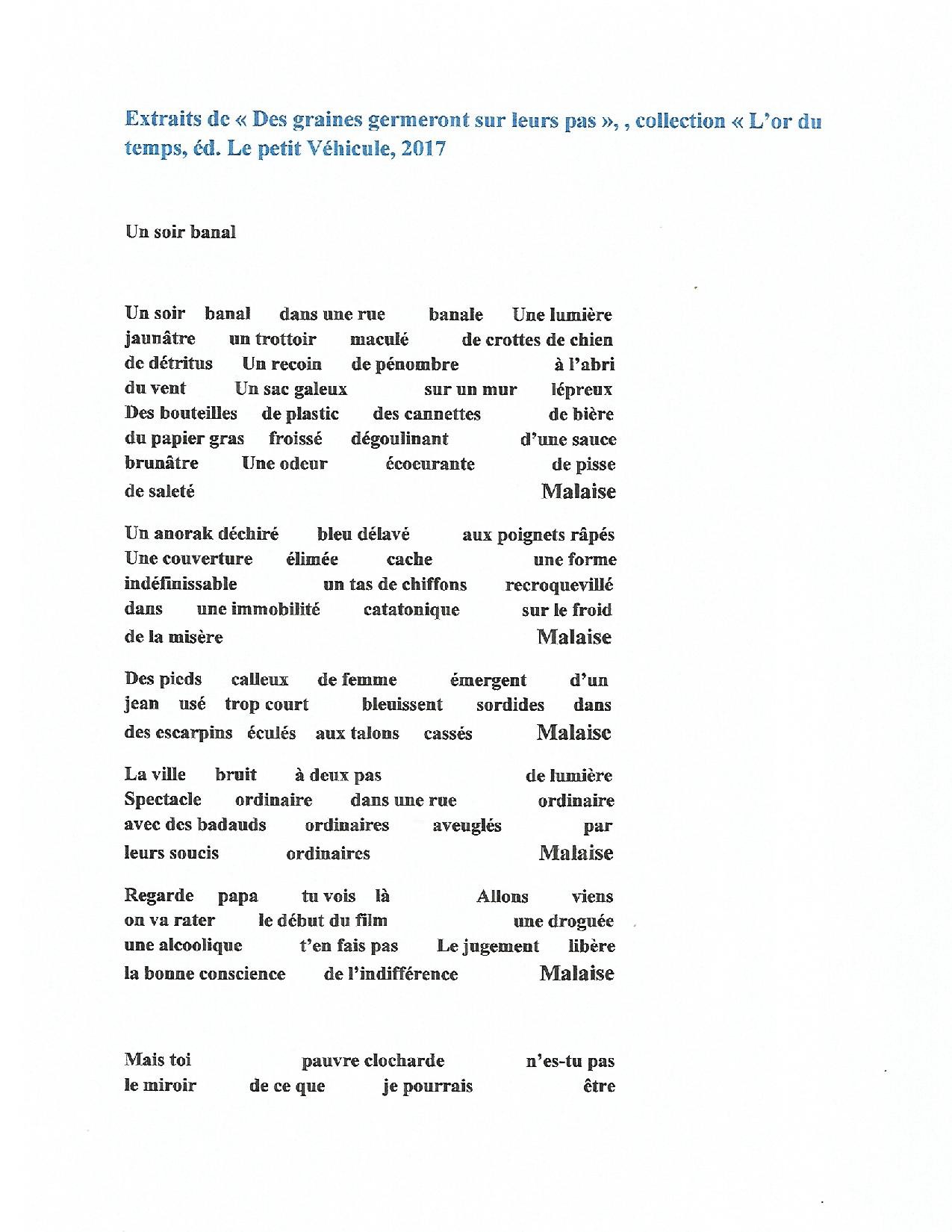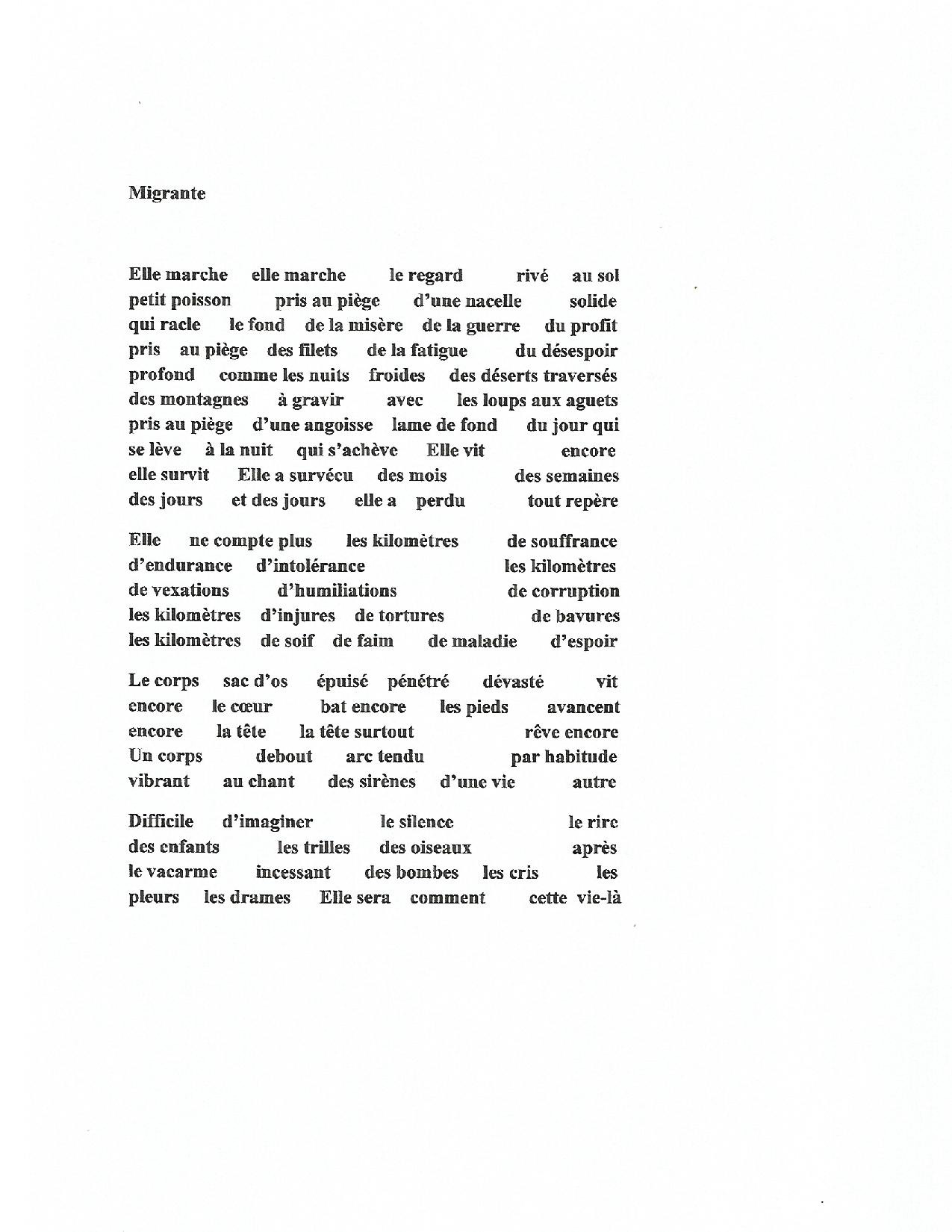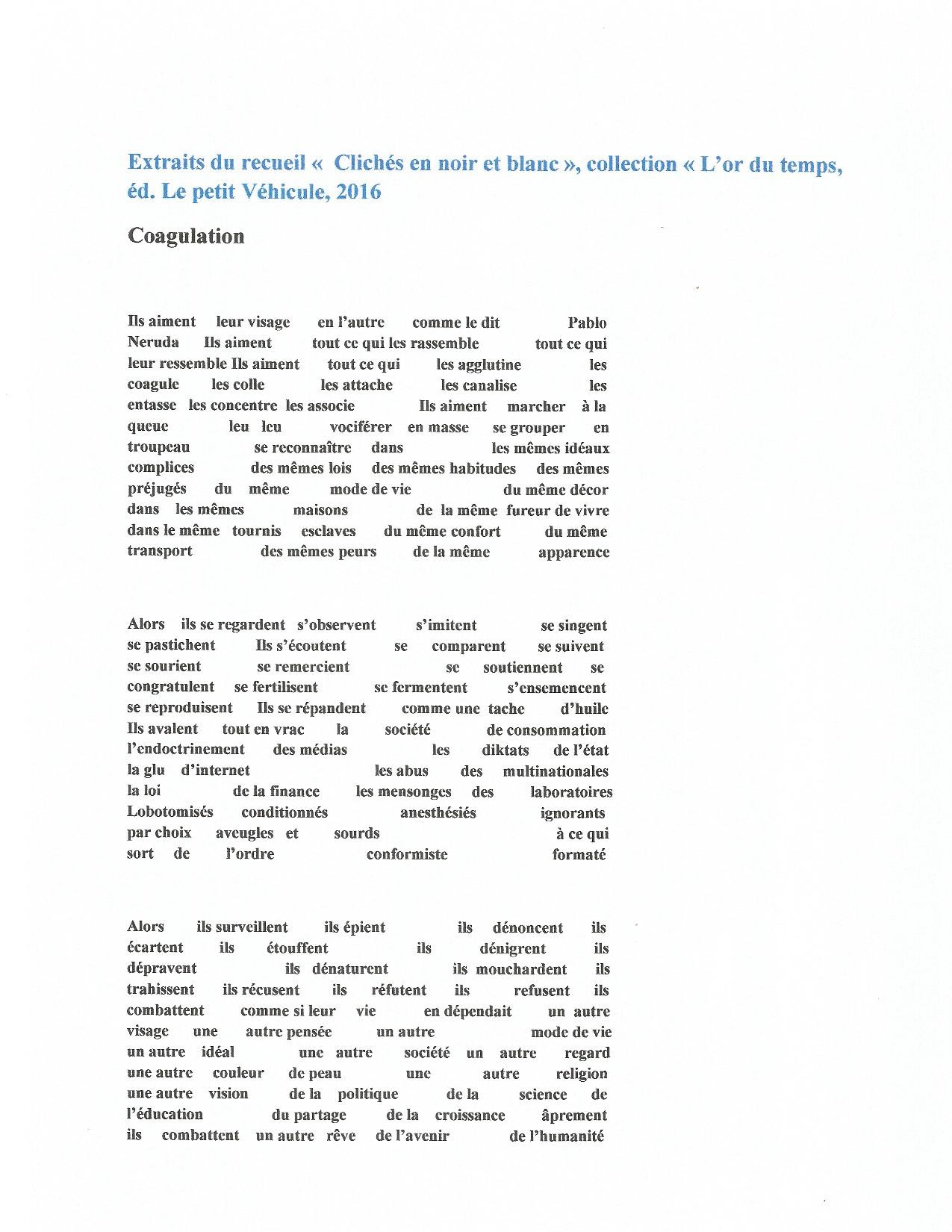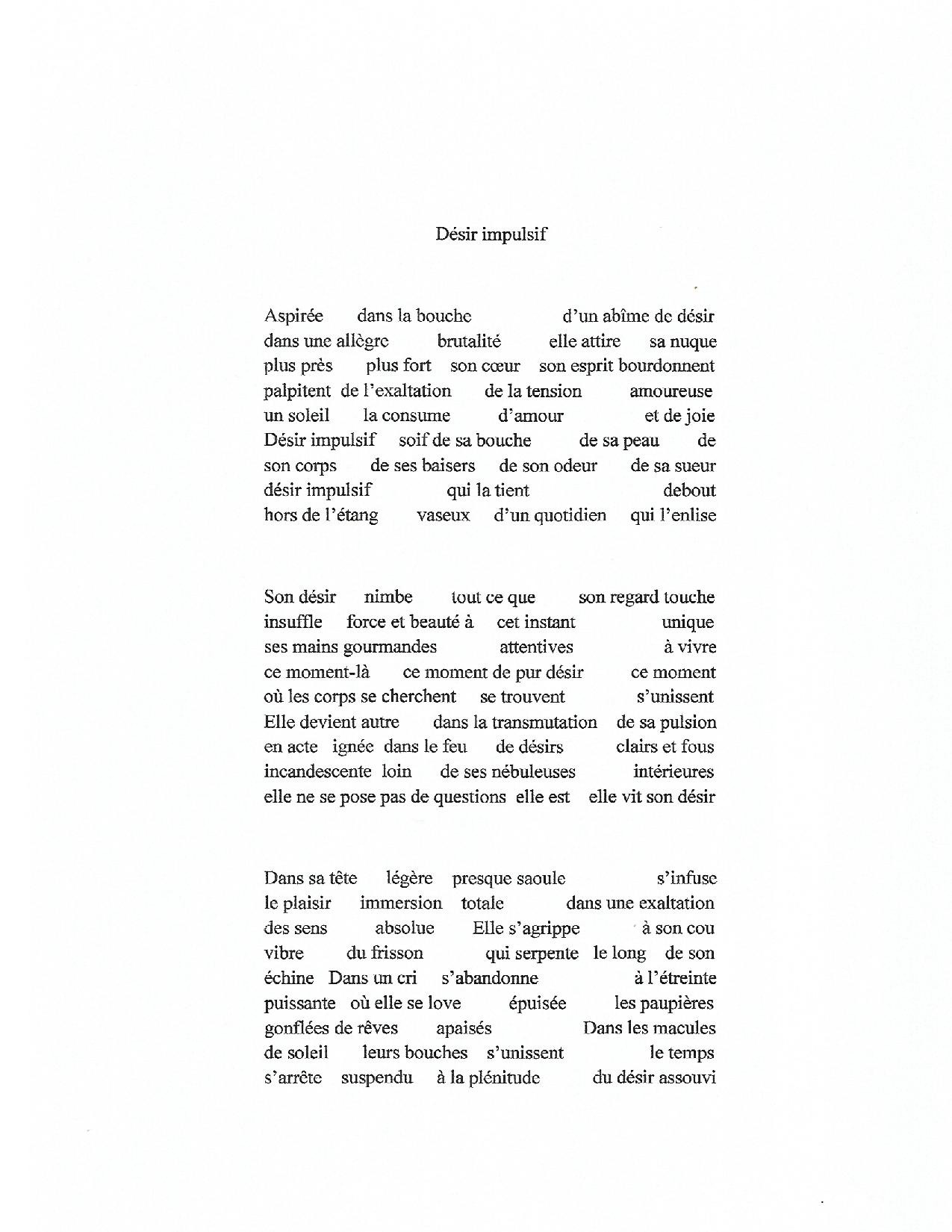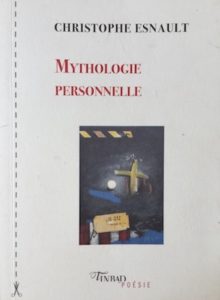J’attendais de l’absurde, me léchant les babines à l’avance. Je l’attends encore ! Zut. L’absurde y est absurdément absent. De la fumée d’absurde. Enfumée par l’absurde. « Hop, hop, hop ». Fonce plutôt, me dis-je, trouve quelque intérêt à l’inattendu. En couverture, la photo de ce Duduche-au-billard entre deux zozios empaillés (au choix, ils sont pareils) sonne comme une invitation. Allons-y, « taping, tapong », illico presto.
Il est vrai que cette « boîte à outils » imprévue (publiée dès 1985) titillait en une France qui apprécie si mal ses artisans et travailleurs manuels. Elle me provoquait, malgré d’ordinaires consignes de lecture. Quels « outils » ? un tournevis ? un décapsuleur ? Une perceuse visseuse délicieuse…Non, les « outils » dubillardesques sont finalement assez convenus : prolongement du corps (main, cheval) ou substitut (marteau, tuyau, clef anglaise, clou, ciseau, montre, scie, etc.) ou autre (eau). Certains le sont moins (convenus) : punaise, parapluie, ventouse débouche évier, soucoupe et tasse…Hors de cet ensemble boîte à outils, émerge un « trombone » trompeur : non, il n’est pas le lieur-relieur de paperasses, mais bien l’instrument de musique à coulisses !
Fouillons dans cette panoplie des humbles, des oubliés, bref des… outils. Saisissons-nous – au hasard - de la clef anglaise. Dubillard épluche d’abord son fonctionnement : comparée à un escalier, elle fragmente l’effort au fil de la mollette. Il s’évade ensuite de sa description par la poésie, constatant qu’elle ressemble à un « F », puis à une « clé de fa » (avec quand même un certain effort !). Passons ensuite à la hache qui « a l’air de sourire », tout en pensant à son utilisateur : celui-ci est invité à y répondre en retour, tout en « rêvant » à cette « hache infidèle à son homme ». Puis emparons-nous de la passoire qui, tel un « agent de la circulation », sépare l’eau des spaghettis ! Le tire-bouchon, quant à lui, est « défiguré (…) à la torsade tordue dans une grimace éternelle», bref c’est un « infirme à vie ». Testons enfin le lasso, lequel pourrait capturer « le troupeau » des pensées s’éloignant de leur auteur. L’auteur réhabilite - sans en avoir l’air -ces objets négligés. Cherchant à les décrire, à les comprendre de l’intérieur ou à les imaginer, il leur attribue une existence et peut-être même une âme. Pourquoi ? Penser les outils, n’est-ce pas un nouvel outil pour dire autre chose ?
Le clou possède un statut privilégié. Plusieurs poèmes lui sont réservés. Certes il n’y a pas de « cloueur » dans « l’annuaire des professions ». Ils sont bons à rien. Cependant ils sont « dans le clou, le trou du clou» et même le « dedans mystérieux du clou ». Ils se clouent même entre eux, (sans clou ni marteau), « chacun s’essoufflant dans un bouche à bouche à lui-même » (pas évident à imaginer). Il est vrai que ce sont des « cloueurs absolus » ! Le clou en soi est néanmoins « fier d’une sotte étincelle ». Solitaire, il est embarqué en une « aventure » dans les fibres de bois et s’endormant dans la planche « apaisée ». Qui la racontera ? La pointe de métal est implicitement liée au marteau, lequel pendant la nuit, « rêve » dans la boîte à outils, « queue en l’air ». Les dérives du poète le conduisent parfois à un constat imprévu (clou et porte ont chacun leur marteau), parfois à un jeu de mots narquois (« clouons nos clous »).
Enfonçons notre clou conceptuel à sa suite. Faisons un bond de lecture vers l’évocation de la mort, toujours significative. Cette notion essaime ça et là. Elle s’évoque d’abord avec la mort des fleurs « dont on fait des couronnes ». Ailleurs, elle s’accompagne d’une envie de vomir « funèbre ». Ici, un car insolite transporte « des enfants majeurs morts », les siens (s’agit-il d’un vrai souvenir ?). Lui-même est le morceau qui « manque à la bouchée des morts ». Il a déjà vu mourir « un homme qui n’était pas grand-chose ». « Un seul homme qui meurt », dit-il, « tombe de vous comme tombent les larmes ». Il voit aussi un homme « mourir pour la dernière fois » (est-ce de l’humour noir ?). Des pleurs coulent, tel un signe de « plus haut » accompagné par un violoniste et un joueur de trombone (un instrument qu’il affectionne visiblement). Que reste-t-il des défunts ? Pharaon et personnes ayant participé aux pyramides sont mémorisés « non pas à titre de morts, mais en qualité de pierre taillée » ! Il ne lui reste plus qu’à faire « mourir les morts ». Pour le poète, la mort enfin est « le chapeau haut de forme de toute vie ». Sorte de point presque final, somme toute. Au demeurant, Dubillard a même envie de casser par fatigue cette foutue boîte à drôles d’outils ouverte dans ses poèmes : c’est « une boîte pleine d’outils morts (…) pleine des gestes morts ».
Au fil élastique d’un labyrinthe intime aux nombreux recoupements/renvois/échos, transparaît un Dubillard tous azimuts – en quelque sorte débridé - présent sur tous les fronts. Il aime ainsi fusionner avec le monde : « dans la nuit j’ai construit ma nuit, j’ai couché mon ombre avec l’ombre », « la nuit qui s’use (…) et qui m’use contre elle en une seule usure », « des fleurs qui poussent à travers les fleurs », « je sentais son prénom se prénommer en moi », « tout ce qui tourne finit toujours par tourner mal ». Il sait s’abandonner à la délicatesse poétique (« Ce qu’un homme et une fleur ont à voir ensemble », il perçoit deux soleils). Il ose exceptionnellement caricaturer le cadavre du misanthrope, dont un enfant « ouvrira » ni plus ni moins la « braguette » et « croquera » les « couilles ». Il accorde une présence diversifiée à des dames qui n’ont pas l’air du temps jadis (Françoise, Hortense ou une certaine Myriam perdue dans un poème). Symboliques ou réelles ? Certaines sont « trop larges pour habiter Paris », d’autres donnent aux pêcheurs l’ordre de rapporter les harengs où ils ont été pêchés. Il voit parfois le monde comme une femme (« J’étais très claire » dans le poème Rencontre). Enfin l’une de ces défuntes « a le cadavre aimable ». Il sait aussi faire preuve d’une originalité descriptive (un « chat à l’imparfait » est celui qui disparaît). Il goûte les jeux mots sonores (l’eau ne pèle pas, ne bêle pas, mais gèle, « les harengs sont hargneux » ).
Derrière ces diverses approches, s’esquisse une philosophie du monde. Il propose une « robe de la sagesse », invitant à la modération. Hommes et charrettes disposent de pieds et roues droite et gauche : les utiliser par « alternance » permettra au piéton d’aller plus loin. Quant à celui qui fait l’âne pour avoir du son pour son âne ou la pipe pour avoir du tabac, il « perdra bientôt l’envie dont il brûlait ».
En bref, pour résumer le non résumable, les outils mentaux de l’auteur lui permettent de clouer ses idées, de clefanglaiser ses illusions, de punaiser ses rêves, de vriller ses phantasmes, etc. Cher grand Duduche, alias Roland, j’ai sans doute mal infiltré les tréfonds et replis de votre esprit. En tant que lectrice, j’oserai dire que je suis aussi « tombée » sur un os : entreprendre de le ronger ne me déplaît pas car il y a des « os à moelle*((cf Pierre Dac)) » !