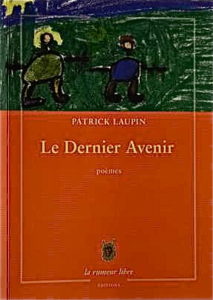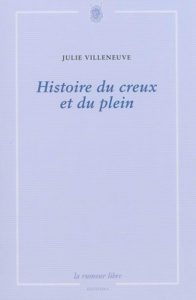Ping Pong : 3 poèmes bilingues de Max Ponte
1
Ho provato a star senza di te
ma poi mi appassivo
Ho provato a star senza di te
ma poi mi appassivo
il cielo diventava
plumbeo plumcake plastico
i giorni non sterzavano più in curva
anche il mio rapporto con i gatti
diventava difficile
mi pareva che tutto
mancasse di sostegno
che gli alberi si afflosciassero
e anche le auto le auto
se ne andassero in giro stancamente
Ho provato a star senza di te
ma poi mi appassivo
non capivo la funzione della ghiaia
e continuavo sì continuavo
a pensarci senza motivo
* * *
2
La tua voce, le frequenze
E poi ora ho
soprattutto la tua voce
che è il sottile filo
la serica emittente
dove intercetto
del tuo petto
le frequenze
1
J’ai tenté de faire sans toi
mais je me flétrissais
J’ai tenté de faire sans toi
mais je me flétrissais
le ciel se plombait
plum-cake plastique
les jours n’assuraient plus les virages
même mon rapport avec les chats
devenait difficile
il me semblait que tout
manquait de soutien
que les arbres s’affaissaient
et que les voitures les voitures
traînaient d’un air lassé
j’ai tenté de faire sans toi
mais je me flétrissais
je ne comprenais pas la fonction du gravier
et je continuais oui je continuais
sans raisons à y penser
(Trad. de l’Italien par Camilla Gastaldi)
* * *
2
Ta voix, les fréquences
Et puis maintenant j’ai
surtout ta voix
qui est le mince fil
le soyeux émetteur
où j’intercepte
de ton avant-coeur
les fréquences
(Trad. de l’Italien par Suzanne Dracius)
* * *
3
L’età minoica
Ora che ho scoperto
l’estetica minoica e la scimmia azzurra
sono fermamente risolto
a far reagire i miei liquidi con i tuoi
Tale cromostoria
consisterà nel fatto che
nella piena applicazione dei principi
della stechiometria, della termodinamica
e dell’art. 43 del contratto collettivo nazionale
precipiterò inevitabilmente dentro di te
Questo tuttavia
superato lo shock gravitazionale
mi permetterà di esperire
la tua civiltà palaziale
e le tue composizioni
esotiche e fluviali
Ora che ho scoperto
l’estetica minoica e la scimmia azzurra
sono fermamente risolto
ad inoltrarmi nell’ombra sinuosa dei tuoi arti
articolando articoli e monosillabi ruffiani
collaudando ascensori in lattice
In assenza di pressione atmosferica
ci rotoleremo su pareti ornate
di gigli e nature da sballo
ci inietteremo profumi
con dominanti ambrate
* * *
3
Civilisation minoenne
Maintenant que j’ai découvert
l’esthétique minoenne et le singe bleu
je suis fermement résolu
à faire réagir mes liquides avec les tiens
Une telle chromo-histoire
va consister dans le fait que
dans la complète application des principes
de la stoechiométrie, de la thermodynamique
et de l’article 43 du contrat collectif national
je vais inévitablement précipiter à l’intérieur de toi
Cela, toutefois
dépassé le choc gravitationnel
va me permettre d’expérimenter
ta civilisation palatiale
et tes compositions
exotiques et fluviales
Maintenant que j’ai découvert
l’esthétique minoenne et le singe bleu
je suis fermement résolu
à m’introduire dans l’ombre sinueuse de tes membres
en articulant articles et monosyllabes proxénètes
testant ascenseurs en latex
En absence de pression atmosphérique
on se roulera sur parois ornées
de lys et natures géniales
on s’injectera parfums
aux dominantes ambrées
(Trad. de l’Italien par Camilla Gastaldi)