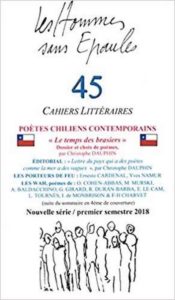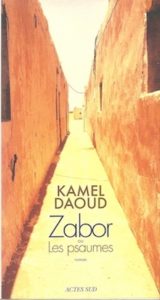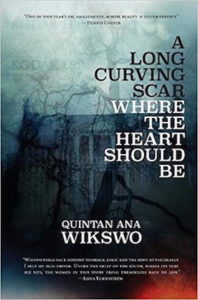Chair et os, dans votre livre, sont soumis à la tectonique des plaques. Cela pousse et se soulève dans la violence d’un mouvement fondamentalement frictionnel, abrasif et en éruption, le tout dans un sillage lyrique, une atmosphère de poésie nubile. C’est un vautour qui plane sa petite mort quand l’aube se lève sur des ciels inondés de sang. C’est un rythme de séduction mené de main d’artiste à la perfection.
Vous m’avez dit qu’il vous a été difficile d’aller loin dans mon livre sans exhumer Keats. Le vôtre m’a menée à Hélène Cixous, Audre Lorde, Aimé Césaire et Clarice Lispector, pour la ténacité et la persévérance dont ces poètes de proie ont fait preuve dans leur éviscération du langage au point d’extirper leur propre cœur utérin pour le faire battre entre leurs mains et celles du lecteur. Ensuite, je suis passée à Maurice Blanchot et à son L'Écriture du désastre, injustement négligé, dans lequel il écrit, à propos de la lecture : « Il faut franchir un gouffre et si on ne fait pas le saut, on ne comprend rien.((etraduit d’après l’anglais du texte original.)) C’est ce qui m’a conduit à ce vers de Whose Sky, Between ((À qui le ciel, entre.)): une lassitude de pleurer si bien. Votre œuvre partage, avec Cixous, Lorde, Césaire, Lispector et Blanchot cette notion de capacité inlassable à faire le grand saut dans une jouissance qui nargue la présence du désespoir et de l’épuisement. Certaines âmes plongent si férocement au cœur de l’énigme de l’émotion, de l’érotique, de la violence, de la peine, du désir, des souvenirs et de la rébellion.
J’aurais grande satisfaction à dire de votre livre que c’est un recueil de poésie de champ de bataille issue d’une Ligne Maginot fendue, car il contient des poèmes d’amour et chante le meurtre, dans lesquels, ennemis et alliés partagent souvent le même corps. Vous liez et déchirez les instants où l’émotion s’incarne dans la fièvre. Des animaux, papillons, oies des neiges, étoiles de mer, albatros, panthères, criquets, corbeaux, laissent leur trace qui vous sert à évoquer le sang menstruel des filles en parallèle avec une couleur dont on ne parle pas en temps de guerre. La guerre y est présente d’un bout à l’autre et insiste lourdement pour qu’on la prenne en compte. Je me demande : l’incarnation en soi est-elle une sorte de violence ? Quel antidote vaincrait cette violence ? Est-il besoin d’antidote ?
Margo Berdeshevsky. C’est un champ de bataille que, de naissance, nous sommes faites pour habiter. Oui, cela fait bien longtemps que je m’intéresse à la question. Cela vient-il de mes premiers enthousiasmes d’enfant-fleur ? Certes, mais pas seulement. Vous demandez si l’incarnation est une sorte de violence. Lorsque nous disons quelque chose à voix haute, nous y mettons de l’énergie. Nous lui donnons vie. C’est l’un des plus subtils fondamentaux de la magie. Sauf que, de nos jours, je sens que me manque l’audace de ne pas NE PAS en parler pace que, bien évidemment, si ce n’est pas maintenant, ce sera pour quand ? Et si je n’en dis rien, qui d’autre le fera ? Je me sens tenue au moins d’apporter une voix, la mienne, à mon époque. C’est la raison pour laquelle j’ose m’en servir. La guerre reste, de façon monstrueuse, notre réalité globale. Rien n’a changé, des mythes antiques à la course aux frontières et au pouvoir d’aujourd’hui.
Dans le poème Yes, the Lights,((Oui, les lumières.)) je rappelle nos guerres d’hier : Oui, je sais, C’est la guerre. ––On disait ça dans le temps. Et on le dit encore.
Et puis il y a cette strophe publiée naguère dans But a Passage to Wilderness,((Simple échappée dans la nuit.)) dans un poème intitulé Best Love and Goodbye((Très affectueusement et au revoir.)) :
Contraire du silence, le frêne.
Contraire de la haine, la paix, calmement, en temps de guerre.
Combien de guerres dans la mémoire collective ? Je ne m’en souviens plus.
Quand pourrai-je écrire le poème sans y inclure « putain ». J’ai dit guerre mais
on m’a corrigée parce que j’ai recommencé à me plaindre’.
J’en suis venue à croire que la bataille se livre autant au dehors que, oui, à l’intérieur. Parce qu’avant de pouvoir identifier, affronter et défier l’opposition ennemi et allié à l’intérieur de soi, je me rends bien compte que nous continuerons notre guerre contre les autres moi qui nous cernent de l’extérieur. On se tue à essayer d’apprendre à se comporter en êtres humains capables de paix, mais pour combien de temps encore ? Combien de millénaires ? Et il nous en reste tant à apprendre. Demain peut-être. Peut-être.
Quintan Ana Wikswo. Vous m’avez interrogée sur le réseau américanien qui irrigue mon livre, mais votre ouvrage adresse à l’ensemble qu’est la littérature française de nombreux clins d’œil qui semblent pousser, de propos délibéré, l’attraction vers l’érotisme et l’existentialisme jusqu’à un sommet plus féroce, plus rapace même. Une littérature nationale est-elle un ensemble ? Ce livre est-il l’avatar du rapport sexuel ?
Margo Berdeshevsky. J’estime qu’on peut aller jusqu’à dire que la littérature en tant qu’art ainsi que ses produits et sous-produits tendent largement à la tenue d’une conversation avide, à usage interne ou externe. Je crois que mes propres œuvres participent du flux d’un dialogue en leur sein. (Cela ressemble beaucoup à ce qui se passe dans une salle de musée où les œuvres exposées tiennent de longs conciliabules.) J’irai jusqu’à parler de rapport dans le meilleur des cas, si la conversation débouche sur une communication concrète et pas simplement sur un frotti-frotta de corps et d’âmes.
J’ai souvent faim (à en crever, à l’occasion) de contact. Un contact spirituel peut signifier survie. Je suis souvent profondément pessimiste quant il s’agit d’être rassasiée. Notre faim à tous nous pousse à sortir des nuits de notre époque. C’est, chez moi, ce que vous pouvez éventuellement qualifier d’existentialisme féroce. Si votre question est de savoir si la France en tant que nation possède un corps littéraire, je répondrais que oui. Les auteurs auxquels vous avez l’amabilité de m’associer (plus haut), sont certainement des cellules de ce corps. Mais le romantisme qui s’incarne dans la Renaissance française ne partage pas la chair du corps tourmenté et explosé du Sisyphe de Camus ou que celui de l’intellectualisme du français actuel, plutôt desséché, ou encore de sa poésie qui ne fait guère qu’imiter et réinventer les Language Poets et l’École de New York.
Quant à l’érotisme littéraire à la française, je dirais que me plaît particulièrement celui de Duras dans L'Amant de la Chine du Nord, réécriture remarquablement meilleure du point de vue érotique, après bien des années, de L’Amant. Mais si mon Avant que ne tarisse autorise une forme de rapport, comme vous le suggérez, je me satisferai du « aujourd’hui ». Je n’aurai pas l’audace d’en demander plus.
Quintan Ana Wikskwo. Vous écrivez : et merci à ton œil d’homme qui n’est rien/d’autre que celui de Dieu, me semble-t-il, ou le mien... et moi : parle-moi de la perte. Et ceci aussi : dans le chœur d’adieu aux victimes/Et ce n’est pas suffisant. Qu’est-ce qui, perdu, est récupérable ?
Margo Berdeshevsky. De nos jours, la rédemption me paraît fort compromise. Mais l’humain en nous, en sa quête de connaissance du suffisant et du trop, reste ce qui m’obsède. Dans les poèmes d’où vous extrayez ces vers, je m’intéresse au vieillissement, à la perte et à l’amour qui nous (me) font face. J’essaye aussi de voir comment nous pleurons les victimes. J’ignore si ma (notre) peine est suffisante ou non. Mais c’est un début dans l’honnêteté dont l’humain a besoin pour entamer, pour la centième, la millionième fois peut-être, pour commencer son ascension.
Quintan Ann Wiskwo. Vous avez écrit, à propos de mon livre : « chaque épisode que vous dépeignez ressemble à un orgasme qui monte très, très lentement, en quête (si j’ose risquer une interprétation), d’une sorte de niche consacrée. » Je m’étonne, compte tenu de nos sensibilités concourantes, que vous vous soyez focalisée sur une interprétation qui assimile mon récit en prose à un orgasme féminin à multiple paliers (en spirale) plutôt qu’à la courbe narrative traditionnelle du roman (l’éjaculation masculine). Votre recueil ressemble à une prolongation de permission en temps de guerre, au cours de laquelle orgasme après orgasme se succèdent sur la piste de quelque issue. Comme quelque chose dans notre existence que l’on essaye de quitter alors qu’au contraire on ne cesse d’arriver, d’arriver, d’y arriver. Existe-t-il une issue ?
Margo Berdeshevsky. Ah bon. Oui, nous sommes souvent dans un piège, celui de la durée de notre vie et celui de notre propre corps. L’orgasme, espérons-nous, nous en libère, y compris des instants qu’il dure. Les femmes savent qu’une telle issue et une telle libération peuvent se prolonger, faire spirale, comme vous le dites, bien davantage qu’une catharsis purement physique. Nous allons même jusqu’à imaginer que cela peut mener très profond, et à aimer. Du moins, nous en nourrissons l’espoir. Mais nous avons besoin de bien plus qu’une explosion libératrice pour nous libérer de ce à quoi nos vies semblent nous enchaîner.
Pour en parler, permettez-moi de citer ces vers tirés d’un autre poème, Whisper,((tout bas.)) inclus dans Avant que ne tarisse.
Pourquoi ma peau me veut-elle en elle
Sait-elle qu’elle contient une femme ?
Le mal n’est pas brûlure lorsque hurlent les feux de brousse
Sait-elle combien de septembres il lui reste
Suis-je clouée en elle, cellule après cellule,
Pâle voile matrice cousue sur ciel
––est-elle mienne ou bien suis-je son
Cobra domestique qui bruit comme les pierres
au fond du ruisseau en manque de plus de chaleur
de plus de tendresse, de friction, de mises à mort––
Ce poème n’est pas une conclusion, mais il me permet de garder ouverte une question. Et peut-être de poser la suivante, ou une autre encore.
Quintan Ana Wiskwo. Nos livres partagent une sensibilité à fleur de bordel. Une sexualité réaliste traditionnellement interdite aux femmes écrivains dans la littérature industrielle américaine autant que française. Alors que nos objectifs diffèrent, il me faut citer la célèbre provocation qu’est Histoire d’O, ouvrage publié par une femme sous pseudonyme et dont on pensa longtemps que l’auteur était un homme parce que ses collègues masculins estimaient qu’une intellectuelle lettrée était incapable d’exprimer toute la force érotique du rapport sexuel. En tant qu’auteur qui entre profondément et explore tous les recoins de cette zone interdite, y a-t-il des prés carrés trop larges, des barbelés trop hauts, qui vous ont empêchée de sauter par-dessus ?
Margo Berdeshevsky. Pas à ce jour, mes propres inhibitions mises à part. Ça, c’est le défi que me je dois de relever. Sans avoir écrit une Histoire d’O d’aujourd’hui, signée de mon nom ou d’un quelconque pseudonyme, je m’aperçois que ceux qui me lisent sont parfois tout feu tout flamme devant mes avancées dans ce domaine. Un jeune Japonais, bien sous tout rapport, m’a entendu réciter Pour mes sœurs de partout, même à la Saint-Valentin. Ce poème explore l’univers de quatre très jeunes filles qui se déflorent pour rester maitresses de leur propre virginité. Il est venu me voir à la fin pour me dire qu’il n’avait jamais rien entendu d’aussi choquant, mais qu’il avait beaucoup apprécié. J’en ai éprouvé un plaisir bien comme il faut.
Le critique Sven Birkirts a écrit, à propos de mon recueil de nouvelles Beautiful Soon Enough,((La beauté a son heure.)) que je comprenais « que l’éros est à la fois force motrice et source de connaissance » et aussi « elle pose le huitième péché capital, qui est le refus de pousser les choses à fond. »
Quintan, permettez-moi cette prière : que nous ayons, l’une comme l’autre, de tels lecteurs et un tel auditoire ! Nous venons tout dernièrement d’entamer un nouveau dialogue à l’échelle mondiale. Certains le penseront dangereux. Nous allons, j’en ai l’impression et pour les temps qui viennent, nous trouver tiraillées entre un puritanisme nouveau, effrayant, malgré tout exigeant, et notre comportement sexuel collectif. Entre ce que nous préconisons car courageux et sain, d’une part, et, de l’autre, ce qu’il nous faut rejeter parce que cela nous a volé notre dignité d’êtres humains. D’un pôle à l’autre, puissions-nous toujours sauter ou voler, ou bien écrire au gré des appels du beau et du réaliste ! Je l’espère, pour notre plus grand bien à toutes.
Quintan Ana Wiskwo. Vous écrivez : Je ne sais/quelles gazes plier/ sur quelles blessures les poser. Et pourtant le recueil tout entier est en quelque sorte fait d’emplâtres, de compresses et, quand on change les pansements, ce qu’il y a en dessous est mis à jour. Je me demande si vous en avez bien conscience. Quelles blessures faudrait-il panser, si nous disposions du pansement adéquat ?
Margo Berdeshevsky. Tout ce que je puis dire, c’est que je crois que la plus grave blessure que je connaisse (même si j’ignore totalement comment mettre fin à l’infection où éliminer les poisons qui sont notre lot), c’est, à mon avis, le fait d’être entre humains. Notre défi (et souvent notre échec) en tant qu’humains, que voix de notre temps, c’est de faire face à ce qui fait de nous ce que nous sommes, et qui reste aujourd’hui aussi vicieux qu’hier.
Et notre (ma) quête restera comment être humain, homme ou femme, en tant que formes de vie capables d’éprouver du sentiment à notre propre égard et à l’égard de l’autre, réciproquement.
Je ne citerai plus qu’une strophe du dernier poème d’Avant que ne tarisse, réceptacle de tout l’espoir de guérison auquel je me raccroche. Et je veux croire qu’il en est ainsi, que la création sait se guérir, nous guérir. J’ai passé une bonne partie de ma vie à apprendre à soigner. Je ne sais pas. Mais je désire de tout cœur qu’il en soit ainsi :
Chaque poison dans une forêt
pousse à côté de son antidote, disions-nous.
J’aspire encore, ai-je dit.
version originale ici : http://www.full-stop.net/2018/01/26/interviews/devin-kelly/quintan-ana-wikswo-and-margo-berdeshevsky/