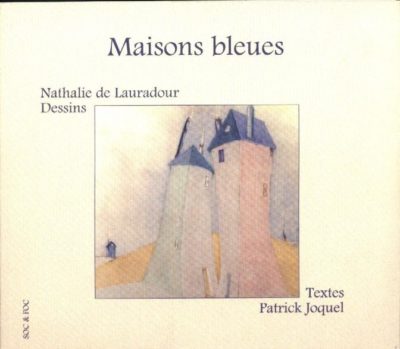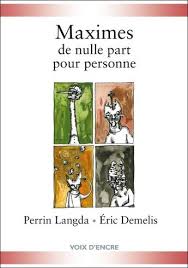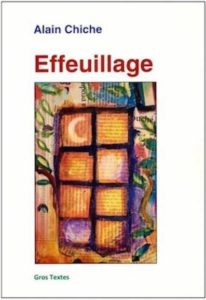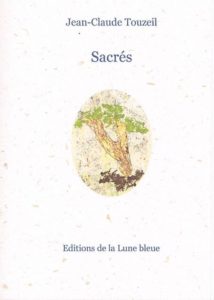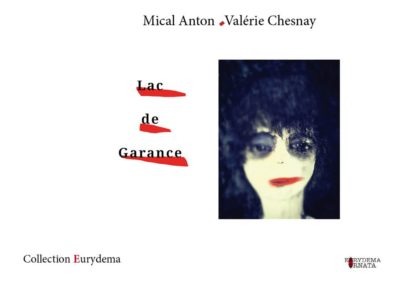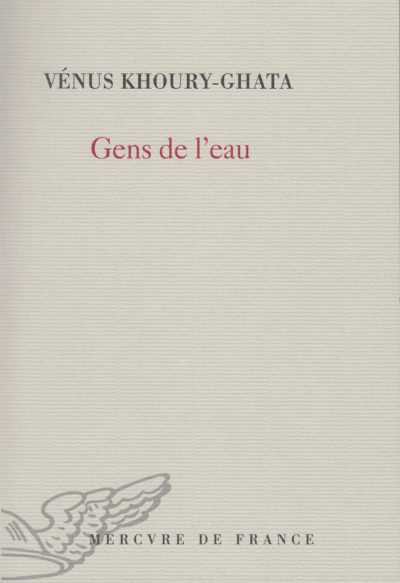Valère Kaletka, Hypermnésie et autres poèmes
Hypermnésie
Il roule encore entre mon
Pouce et mon index
L'oeil-de-chat ébréché
A reflet roux ou doré
Selon l’heure et les ombres
De nos vastes journées
Récréation
[dans le clos fermé quelques petits coqs aux mèches en ex-voto
rivalisent d’adresse et de piqûre d’ergots]
Je sens encore l’odeur immonde
De mon vainqueur
Le reflet roux
M’a griffé la joue avant de s’abîmer
Au fond d’une poche de velours
Qui n’est pas la mienne
Re-création
[Dans le clos fermé un autre petit coq
a remporté ma bille
et fustigé mon innocence]
Les ailes
Mon corps, dedans
Cristallise s’enlalique
Au creux des muscles
Et des tendons un dieu
Pique des étoiles
De vieux pare-brise
Caillassé
Caillassé
Je vois tout ce beau monde
Nidifier dans l’audace
Buriner jour et nuit
Avec un brin de chance
Du magma jaillira
Une putain de paire d’ailes
Tueuse de pesanteur
C’est Fête ici
J’ai regardé longtemps
La cordée riante des lumignons
Constellation de bébés-phares
A couleurs simples
Primo-populaires
Je poursuis La guirlande
Du regard, de la prise à la queue
Et mes yeux s’encahotent sur
Le halo souffreteux des lumignons
Les clartés pâlottes
Leur épopée cachectique
Je mange ses couleurs
Comme des bonbons mous
Encordés à une liane
Un lien de riens flétris
Porte un réconfort inquiet
Au mitan de mon cœur
C’est Fête ici
Fête mourra dans quelques heures nul ne l’ignore
Et nous connaîtrons le désarroi de la lumière froide
Nous vivrons
Son Trépas comme une injustice et pourtant rien n’est meilleur
Que cette fête
Ruisseau
L’eau me dit l’émoi
Du limon culbuté
Boue par-dessus tête
Les mobylettes nues
Les charges de vieux clous
L’eau me dit l’émoi
Des pieds à couleur
De linceuls qui s’y baignent
S’étonnent et fanfaronnent
De ne pas y trouver
Des carcasses et des clous
L’eau me dit l’émoi
Que la nature nous porte
En dépit du bon goût
Je pas croire
Je pas croire en l’amour
Croire croâre crôar crrroâ
Crues carmines de crapaud
Crente fois cautérisées
– foi de batracien
Sur ces entrefaites
J’avoir laissé filer
Les âmes les plus belles
Et les peaux les plus tendres
Laissé filer les chances
Qui d’usage ne s’aguichent
Que par l’audace
– c'est l'usage disais-je
Chances introuvables même sous le sabot du bœuf fut-il cavale d’un crapaud-buffle à
poumons exponents - sic et que du coup le bœuf chancèle.
Oui j’avoir laissé filé
Mille choses bonnes
Au fil du temps flétri
Pas croire en l’amour
C’est désaper ses vies
Et courir à poils mornes
Vers une issue hâtée
Les petites lunes
Une râpe à virgules
Essaime ses copeaux
Sur les mots en colonnes
Lancés au kilomètre
Devant ces petites lunes
Les mots creusent le dos
Accueillent l’escarbille
Comme un nid fait de l’œuf
Et le vent s’y engouffre
Rompt le monocorde
Défripe les poumons
Une râpe à virgules
Essaime ses copeaux
Un parmesan soigné
Fait de petites lunes
La balle bleue
C’est un petit ballon
en cuir bleu de bonne facture
les continents qu'il porte
ont de jolies couleurs
Le môme – deux ans au plus
est allé chercher son ballon
et l’a jeté sans force
aux pieds de ses parents
occupés à des gestes véhéments
affairés à crier la colère
de ceux qui se détestent
Papa a jeté une chaise en fer
dans un coin de la pièce
le môme a jeté le ballon
entre ses deux parents
des fois que ça détournerait leur attention
sur lui. Le Petit, tout petit, perdu
Le ballon a rebondi deux fois
Tap
Tap
et ça n’a rien changé.
Le ballon a rebondi
deux fois
et son écho a déchiré le monde.
Corridor
Camisolez-moi
Ce soir
Ne me laissez pas seul
Avec le glas qui tonne
En quadriphonie
Emmaillotez-moi
Dans vos draps sans tain
Et ce pyjama bleu
En drapé carcéral
Fermez-moi les yeux
Sans trop les abîmer
Avec un presqu’amour
Et posez en viatique
Sur leur bombe de peau
Le filet symbolique
De mon ticket retour
Prémunissez-moi
Au Je qui soudain
Veut couper court au dol
Que le destin griffonne
A grands traits sur mon col
Ouvrez le corridor.
(poèmes extraits de Quinquagenèse, Vibrations éditions, août 2018)