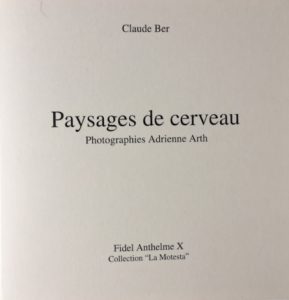Entre apparence et réel, fallait-il que je me cherche ?
Le monde, l'univers, l'infini…
… les ai-je créés ?
Cela commence avec la vie
le premier souffle
avec cette conscience qui donne forme, apparence
à ce qui est nous
à ce qui est hors de nous
à ce qui n'est pas.
Pourtant, tant de choses sont là
qui ne sont pas nous
qui font mal
comme l'absence
celle de l'amour
de la réponse attendue
"M'as-tu aimé ? Pourquoi m'as-tu trahi ?"
Je n'ai pas peur
je n'ai pas peur de mon absence
du point zéro, du retour à nulle part
du compte à rebours.
Pourtant
j'aime les oiseaux, mon chat
mes amours, mes enfants, le ciel, la joie.
De l'absence
je ne crains que de les perdre
sans leurs yeux
sans leurs regards
je ne suis plus
je ne suis rien.
Parfois, il m'arrive de penser loin.
Si loin que je perçois encore l'odeur de ma maison lointaine
le bouquet d'anémones posé sur la table du dimanche.
Je me demande si toi
qui maintenant habites l'absence
tu peux encore le voir.
Le doute est un frisson
l'absence est une froideur
un gant de givre sur un vague à l'âme
mais Toi, où es-tu ?
Ici, les minutes suintent du réveil, mais c'est moi qui pars.
Le réveil restera sur le buffet, avec ses yeux fermés
à attendre encore que quelqu'un tourne son ressort
que quelqu'un le regarde.
Se pose-t-il la question de savoir s'il est encore temps ?
Je ne sais pas ce que pensent les horloges.
Dans le crissement des jours
quand mon chat s'étire autour de sa solitude
seuls ses yeux parlent :"J'ai confiance", disent-ils
pourtant la vie lui a arraché une patte
et moi j'en ai pleuré.
J'ai voulu le monde si grand
que parfois je me suis perdu
dans l'étroitesse.
Pour aller au plus haut
fallait-il que je me cherche ?
L'amour et le rêve agrandissent l'univers.
Parfois, quand l'aube ouvre mes volets
il me faut briser la chaîne des regards, celle des regrets
heurter le mal rire, le mal vivre
trouver le souffle d'un enfant, d'un chat, d'un oiseau
pour retrouver l'envie aller plus loin
j'ai encore tant d'arcs-en-ciel à offrir.
Entendez-vous ?
Et le silence qui se repaît du frisson des morts
Et toi qui glisses dans le passé
Et ton histoire sans histoire
Qui se résume à cette poussière de mots
Sur ce marbre que l'oubli rongera
Et moi qui voudrais te réveiller
Et tout savoir de ce que furent tes rires
Tes larmes, tes espérances
Est-on toujours allé où l'on voulait aller ?
Se verra-t-on dans des bruissements de joies retrouvées ?
Se noiera-t-on dans les brumes froides de l'oubli ?
Je me souviens des mots d'une chanson
"Le chemin si beau du berceau au tombeau"
Je crisse dans des attentes de pierre, de sable et de terre
Je vais à toi tu sais,
Je scrute le passé
En recherche de milliards d'humains effacés
Je cherche les routes de la bonté
Je chevauche, j'expie les crimes commis
Je vais à vous mes amis
En vous rencontrant
C'est l'humanité que je regarde
Si apte au bien au mal
De si longtemps que je viens
Au cyprès où je vais
Je n'ai voulu forger
Qu'un cri d'amour
Entendez-vous mon cri ?
Entendez-vous mon cri ?
Entendez-vous ?
La taille des hommes
Grand-Père me l'avait dit : La mesure de l'homme n'est pas le fait de l'image, belle ou triste qu'il traîne dans son sillage, cherchant à lire dans le regard des autres comme un écho de la brillance des princes. Les miroirs ne sont que les journaux fugaces d'egos d'alouette.
Il y a longtemps que Grand-Père est parti, depuis je marche à la recherche de l'humain si bien dissimulé sous des carapaces d'apparences. À la foire aux séductions, sa démesure dépasse de ses emballages verbeux et de ses profils de héros autoproclamés.
Dans une nuit aux rêves et aux douleurs inaltérés, les petites gens avancent à la sueur de leur labeur, habitent l'univers des enfants de l’ombre qui savent la solidarité plus forte que la compassion, qui tendent la main comme on devrait tendre la joue, non pour l'exemple mais mus par un instinct imposant la primauté de l'amour sur toute violence. Ce sont les Justes de l'invisible, les Robin-des-Bois sans flèches et sans épées, mes pacifiques au grand cœur qui rendent le monde encore acceptable et l'espoir encore ouvert.
Je me souviens, Grand-Père me disait : Les hommes n'ont pour taille que leur conscience. Pour grandir, il te faudra différencier ceux qui s'inscrivent dans l'authentique nécessité du Bien, de ceux agissant par besoin de plaire ou d'être récompensés par une instance invisible. L'instinct du cœur n'est pas un calcul. Méfie-toi des prophètes de l’apparence, de ceux qui font montre d'empathie et de générosité seulement lorsqu'ils sont au grand jour.
Grand-Père est parti un jour de larmes et de fête, certains l'avait critiqué parce qu'il avait voulu protéger un ennemi. Il savait rire, ne jamais paraître sérieux, il savait côtoyer des hommes de bien et de peu comme les oiseaux naviguent entre ciel et nuages. Il était frère de la Conscience comme l'oiseau sait la pluie et le soleil.
Aux larmes citoyens-Rendez-moi Mai 68 !
"Aux larmes citoyens", ont-ils dit,
savaient-ils que l'heure de courber le dos
doit un jour enfin finir ?
"Rangez, pliez, fermez vos utopies", disaient-ils,
Ne savaient-il pas que le temps d'armer nos rêves
était encore là ?
Moi, vieille pierre posée sur la mort des rêves
je me dresse, et déclare :
Ouvrez les tombeaux de l'abstinence
La résignation est l'ennemie des peuples.
J'en appelle à l'espoir citoyen
J'en appelle au droit, au travail et au pain
Je déclare que la spoliation, la confiscation,
l'accaparation du bien commun
sont un même crime économique
majeur et condamnable.
J'en appelle à la révolte des moineaux
pour ne plus oblitérer les cris et les graffitis sur les murs
J'en appelle aux poings levés, aux frondes de l'amour
et revendique le droit à un monde humain.
Je suis porteur d'un deuil du bonheur
je suis en berne de ces travailleurs spoliés,
je suis las d'une politique funéraire : "Le rêve est mort, circulez !"
de cet empire de la dérision qui défenestre le mot justice,
je suis las de ce pouvoir qui, sous faux couvert de raison,
prône la résignation pour les uns,
la richesse, la santé et le reste pour eux
Je veux ressusciter le cri et l'espérance
au prix même de la révolte.
Je parle d'une mémoire en deuil
où chaque jour on enterre la joie,
j'en appelle à la jeunesse insoumise
loin des mornes projets,
J'exige l'équité et une même justice pour tous,
J'exige la fin d'un monde à deux vitesses.
Je veux l'égalité et le droit au bonheur.
Rendez-moi mon Mai 68 !
Tu écris triste
Tu écris triste, me dit-on,
trop sérieux, ou parfois trop fou !
Devrais-je seulement écrire des poèmes d'amour
quand des fous de dieu assassinent des vieilles dames,
des êtres humains, parce qu'ils sont fils de la République ?
Devrais-je chanter,
aller au profond de mes rêves et fermer les yeux,
oblitérer mon cœur des seules tendresses que me réclame mon chat,
m'enfermer dans les mots d'un livre et sauter d'une ligne à l'autre ?
Non, je n'oublie rien des moments de joie,
des chagrins ordinaires, des petites larmes et des éclats de rire,
j'habite encore au pays de vivants
parmi mes misères, mes bonheurs,
avec mes coups de cœur, mes coups de gueule,
j'habite non loin de vous.
Aussi amis,
pardonnez que parfois la tristesse me gagne
mais sachez que, du haut de mes vieux printemps,
je n'oublierai jamais ni l'heure des Mistrals Gagnants
ni la puissance du cri, de l'amour et de l'espoir,
je n'oublierai jamais de vouloir du pain
et du soleil à jeter sur les matins qui se lèvent.
Je n'oublierai jamais le temps des mots d'enfant,
ni mon chat
trois pattes posées sur mon bonheur.