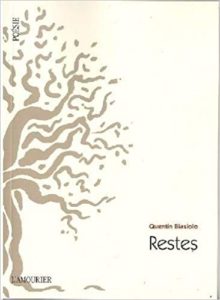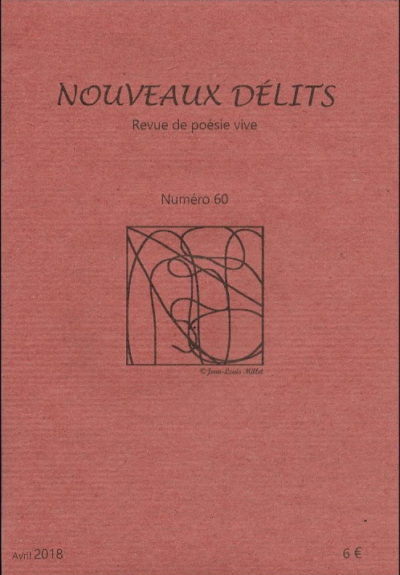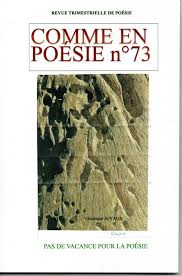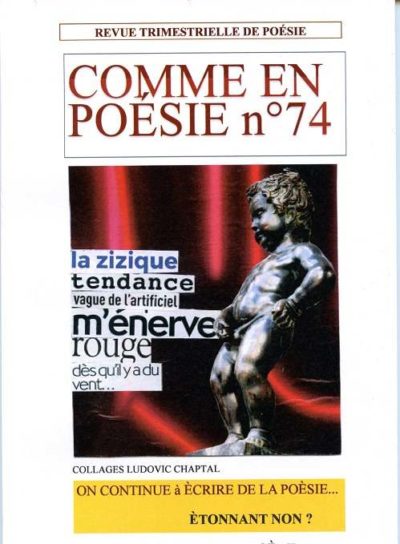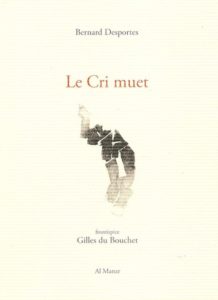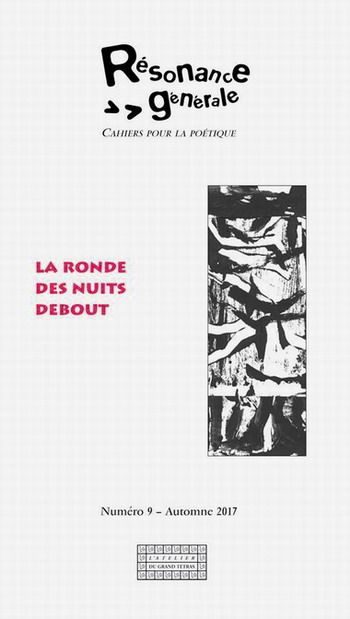Chantal Bizzini, TRANSFERTS
TRANSFERTS
(en écho à l’œuvre Different Trains de Steve Reich)
1.America—Before the War
The sun’s moved to Jersey, the sun’s behind Ho-
boken.
Covers are clinking on typewriters, rolltop desks
are closing ; elevators go up empty, come down
jammed. It’s ebbtide in the downtown district,
flood in Flatbush, Woodlawn, Dyckman Street,
Sheepshead Bay, New Lots Avenue, Canarsie.
Pink sheets, green sheets, gray sheets, FULL
MARKET REPORTS, FINALS ON HAVRE
DE GRACE. Print squirms among the shop-
worn officeworn sagging faces, sore fingertips,
aching insteps, strongarm men cram into subway
expresses. SENATORS 8, GIANTS 2, DIVA
RECOVERS PEARLS, $800,000 ROBBERY.
It’s ebbtide on Wall Street, floodtide in the
Bronx.
The sun’s gone down in Jersey.
—JOHN DOS PASSOS, Manhattan Transfer.
Le soleil s’en est allé vers Jersey. Le soleil est
derrière Hoboken.
Les couvercles des machines à écrire décliquent,
les rideaux des bureaux se rabattent. Les ascenseurs
montent vides, redescendent bondés. La marée
descend dans le quartier des affaires et monte à Flatbush,
Woodlaw, Dyckman Street , Sheepshead
Bay, New Lots Avenue, Canarsie.
Feuilles roses, feuilles vertes, feuilles grises.
« CÔTÉ DU MARCHÉ, RÉSULTAT FINAL DES
COURSES AU HAVRE DE GRÂCE. » Les journaux palpitent sous les visages penchés, fatigués
par la vie de magasin et de bureau. Bouts de doigts
douloureux, pieds endoloris, homes aux bras
robustes entassés dans les métros express.
« SENATORS 8, GIANTS 2, DIVA RETROUVE
SES PERLES. VOL DE $$ 800x000. »
Marée basse à Wall Street. Pleine mer au Bronx.
Le soleil s’est couché derrière Jersey
— JOHN DOS PASSOS, Manhattan Transfer.
[I]((Traduction Maurice-Edgar Coindreau, Paris, Gallimard,1928.)
Toujours cet homme, à travailler, en face de moi ;
il ne regarde pas la pluie, ces hachures
sur la vitre, qui brouillent le paysage,
la campagne, ce soir…
est-ce un visage, ce reflet qui s’y superpose sur la vitre noire ?
est-ce un paysage réel, pour filer ainsi,
comme une pellicule
qui se consume et part en nuages d’encre ?
Dans la salle de projection, suite
en noir et blanc d’images mouchetées, sombres, rayées,
décalées maintenant,
L’homme qui rit,
l’enfant,
la neige, ses pieds nus,
son rire fixe,
dans la douleur même, et la peine,
la machine s’emballe,
la bande crisse, fond, se crispe, se tord,
l’écran est mangé par la lumière
le film a pris feu…
Vers le Sud, vers l’Ouest ; il refait la route de son enfance,
autrefois de New York à Chicago,
un destin confié aux roues ;
en sens contraire à ceux qui fuyaient vers le sud,
ou qui progressaient vers l’ouest ;
et les hobos, quel manque décidait leur fuite,
comment s’accrochaient-ils
au train-destin
et à son battement régulier ?
En route, les pistes qu’on abandonne se dispersent,
et les cris ne sont plus ceux d’animaux,
traqués dans le désert ou les montagnes,
mais ceux du vent dont la vitesse multiplie la puissance.
Les animaux se sont cachés, loin
des pistes, loin des rails qui mènent
aux concentrations humaines
— certains capturés, tués, mangés,
ou bien élevés en captivité, torturés, mutilés —
où les êtres se rencontrent, travaillent, se multiplient,
dans la misère et la répétition.
Cependant, sur la tapisserie, pré pacifié semé de fleurs,
les animaux sourient :
licorne et lapins, oiseaux…
Il y a une direction : que signifient
ces noms de villes
pour celui qui les dit :
— Chicago, New York
quand la voix
et la mémoire résonnent-elles ?
Quel est leur écho maintenant ?
… mesurer ces ondes
…
Sur tes genoux, ce livre, le tracé des lignes,
tissage des vies, cartes raturées, pliées, usées par
ces allers-retours
traversant le paysage
– mais de part et d’autre des voies
vit tout ce qui échappe au tracé rectiligne
du côté des bois, du côté des montagnes
et des sources ;
quelle vie s’y réfugie encore ?
Le courant de ce fleuve ne fait plus battre cette nouvelle terre
industrielle, il ne donne plus vie ni ivresse,
ni ne permet l'abandon au voyage
vers le delta, puis le golfe,
…
Sur ton chemin de chaque jour (que signifie chaque jour ?),
quelle variation dans la répétition ?
Des trains différents mènent à travers les orages,
voir passer ne permet pas de comprendre…
sur place, sifflets du progrès,
les rails, et ce battement syncopé…
Directions : d’un point à un autre,
emportés par l’expansion,
pouvait-on envisager alors… ?
aller vers plus de bonheur, peut-être…
comment le soleil luit-il
aujourd’hui, ou
pleut-il ?
… demain…
mais toi,
es-tu deux fois le même ?
La voie,
est déjà tracée, coupée dans les forêts, dans la pierre,
dans la terre et dans les vies d’hommes ;
et nous y avançons vers cette dissolution,
cette fin,
dans les larges rues, entre les bâtiments
plus ou moins denses selon les reflets
sur le verre ou le métal,
ou le passage des nuages ;
… à l’assaut des hauteurs, mais toujours dans la lumière variable
et le vent,
venu de la mer,
en cette île pacifiée
qui reçoit et qui donne, où la moindre contradiction
n’est pas, à Bryant Square,
la torsion de ses branches d’arbres sur les raies verticales noires et blanches
des buildings,
ou ces grues, au loin, qui montent plus haut encore
et, de leur mouvement, déploient le ciel, les parcs, leurs ombrages,
et les églises ouvertes sur la rue passante s’illuminent
dans le soir.
et la foule va à pied,
parmi les vitrines éclairées…
Voici de minuscules cadeaux japonais,
ces fruits nouveaux, plus sucrés, artificiels
qui fondent sur les lèvres comme le baiser
des fleurs
et ces brassées, en sous-sol, dans la pénombre
du restaurant,
et l’élancement des branches
disposées,
mais tout cela n’est que souvenirs d’avant,
(souviens-toi, ce masque de papier)
— d’avant l’accélération, le danger —
qui voyagent et s’échangent : paroles, lettres, cartes postales, photographies,
voici une nouvelle année où
le progrès nous a menés…
Crystal Palace et Chrysler Building…
nous sommes bien après l’insouciance…
et nous montons,
-Empire State Building
tout en haut, pour voir
la foule naufragée, en bas,
ou bien visitons le musée
où clignote la maquette, un grand jouet :
on peut tourner autour de cette ville miniature,
le temps passe et la nuit et la journée alternent, elle s’éclaire,
puis s'assombrit, tremblante de vie électrique ;
Réfugiés sur ces bords
du monde
ou sans abri,
aveugles,
nous nous heurtons contre les parois,
– ô rivage amer,
qui avait dans la bouche le goût d’une promesse, dans
l’autre langue.
Où faut-il être pour voir encore
se succéder les soleils et les nuits ?
Naufragés,
naufragés à la Nouvelle-Orléans, naufragés
à New York,
naufragés au cœur de la foule
et non plus seulement sur l’île écartée des voies maritimes,
naufrage advenu en chacun de nous ;
porosité des parois, des tissus,
girouettes sensibles aux cris, aux éclats des
phares,
hommes,
animaux
maintenant rendus fous…
un kangourou se dresse, l’œil
agrandi et la mâchoire ouverte, figé
par le faisceau dans la nuit
qui l’a arrêté…