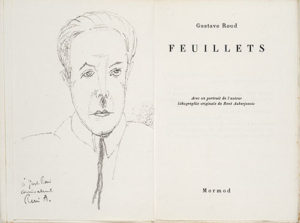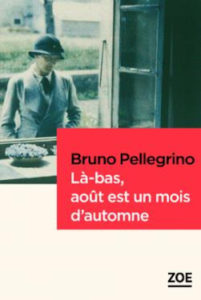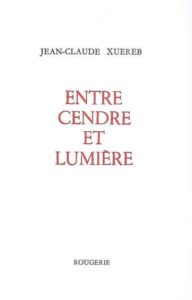Daniel Biga, Poèmes
VAGUES D’ÉTOURNEAUX
vagues contre vagues flux avec reflux
des cents d’étourneaux battent la mesure
de l’air
la terre
n’en voit pas un seul posé
les vols se désunissent au soir
chacun à ses affaires va
sur quelques mâts ou antennes
la nuit réunit
avenue de la gare
boulevard de l’océan
chaque tilleul est une ruche d’oiseaux noirs :
étornnants tornitruants étornissants tourbillonnants
étourtereaux étourterelles étourdissants détonnants étourneaux
***
POURQUOI
…les sources roucoulent -elles
quand le monde est en danger ?
pourquoi élaguer un orme énorme ?
pourquoi Tahar a-t-il peur en enfonçant sa main
toute entière dans le trou sur la berge du fleuve ?
pourquoi sur de longues tiges d’herbe
les fourmis font-elles leurs Tarzanes ?
pourquoi aimons-nous l’eau claire
dans un verre transparent ?
pourquoi faut-il méditer ? ou au moins écrire ?
pourquoi faut-il lire Arno Schmidt et Tarjei Vesaas
et André Dhôtel et Aaron Shabtaï… et…
( pourquoi les noms s’effacent-ils de ma mémoire ?
quand ? tant qu’il est temps
ces questions essentielles superficielles
et tant d’autres
ALIMENTATION GENERALE tente de poser sinon dr
répondre
in Alimentation Générale, Unes, 2014
***
CAPITAINE DES MYRTILLES
( disait Emerson de Thoreau)
et moi aussi
j'ai été huissier des chants
appariteur des couleurs
berger d'enfants
et instituteur des caprins et ovins
j'ai été ingénieur des bétons et bitumes
manœuvre des dossiers et paperasses
j'ai eu une chaire associée de gynécologue du cœur
et de pharmacien des âmes
mais c'est toujours jardinier de fourmis et scarabées
brocanteur des mûres et chanterelles
troisième classe des eaux et forêts
que j'ai été parfaitement à l'aise
comme le gardon dans son élément
car il n'y a pas un paysage pas une vie végétale
pas une plante au monde
dont je ne me sois jamais senti l'étranger
mais que dirai-je de l'homme?
Stations du chemin 1983-1987 In Babel Bigarrures, Tarabuste, 2018
***
LES RÊVES SE RACONTENT ÀL’OREILLE
miel de père lait de mère œuf du poème
(belle rencontre de miel avec l’ours d’or au festival de Berlin)
l’enfant qui n’aime plus guerre le lait
l’adolescent qui le vend
le poète de quarante ans son œuf de poévie:
dans les rayons le miel se goutte avec le doigt
dans les rayons d’abeilles de propolis de cire les rêves
les rêves se racontent à l’oreille
dans la trilogie de Yussu les films de Semih Kaplanogu
miel –lait-œuf honney-milk-egg hourra ! le réalisme spirituel
hourra ! l’enfant se voit de l’autre côté du miroir
de l’autre bord du torrent il de voit lent faon :
« je bois la lune je bois l’eau de la lune pleine
j’avale la pleine lune tombée dans le seau
je plonge la tête dans l’eau du seau et
j’avale le reflet d’un reflet tombé… »
les rêves se murmurent à l’oreille
***
OMBRES INSPIRÉES
…présences heureuses veilleuses paisibles bruits raffinés
sirop de cannes à sugar rousseurs panachées
quiétude au soir armistice noctambule
corps d’esprit une telle nuit d’été sel de mi-nuit
vis à visages Vide Roules d’étoiles serein des c/d/ieux
cent mille fruits cuits bruits de nuit
hémoglobine animale chasse ni fin ni commencement
espèces souffles caresses morsures
soupirs dans l’air – souffrances/voluptés –
autant y-a-t-il d’étoiles au Ciel qu’y a de grains de sable sur Terre
senteurs saveurs sons sueurs chaque inspir
innombrable unique
toutes choses que Rien que Tout n’éprouve ni ne prouve
signale sans révéler
énergies rondes fréquences modulées (recherches de vocabulaire)
empire des foultitudes
finitif des débordements des formes déformes
transformes
les lucioles éteintes l’année prochaine juillet les rallumera
lucioles d’aujourd’hui reviendront plus vieilles et rajeunies
l’an que ven e reven in QUOLIBETS, L’Amourier, 2018