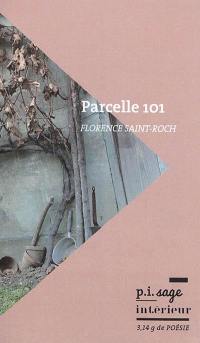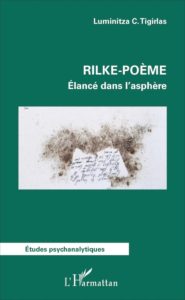Bernard Desportes, Le Cri muet
Alain Gorius et sa maison d'édition Al Manar ont l'habitude de nous gratifier de livres d'artistes de grande qualité mais Le Cri muetde Bernard Desportes vient ajouter de l'émotion à l'esthétisme.
Bernard Desportes est mort le 20 mars 2018, le cri muet est son dernier ouvrage publié quelques semaines avant sa disparition. Ce dernier cri est une sorte d'autobiographie, bilan d'une vie d'écrivain "serai-je allé plus loin / qu'au seuil / de moi-même? " , traversant vingt cinq ans de poèmes, proses, essais, lettres de 1991 à 2016. Livre hommage, organisé par l'auteur lui-même, qui restera donc comme un témoin "ma vie / plus loin que moi ", de ce que fut son talent.
Quand, pour un poème, Desportes choisit comme exergue cette citation d'Henry Vaughan : "et respire, toi, dans l'âcre monde / pour dire ce que je fus." c'est pour décrire cet âcre monde qu'il dépeint au travers de ce choix de textes en bleu, blanc et noir.
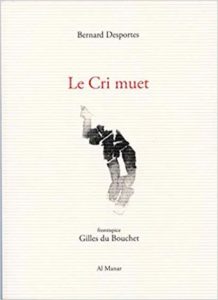
Bernard Desportes, Le Cri muet,
Al Manar, 2018, 88p,, 18€
Le noir tout d'abord, avec le frontispice de Gilles du Bouchet qui vient bien résumer ce livre toujours sous-tendu de noir et de gris. Mais un noir noble, le noir universel qui touche chacun de nous en nos propres tourments. Il y a quelques années, Anish Kapoor s'est approprié la couleur noire la plus intense, au point d'en devenir propriétaire. Il s'agit ici pour Bernard Desportes, au contraire, de partager ses zones d'ombres pour que son cri, bien que muet, fasse écho en nous.
Le noir d'une vie de solitude et de nuit : " espoir et désespoir sont même cendres / même absence / dans l'immobilité des heures / même errance dans le néant du jour ". Une vie dans l'urgence d'écrire : " j'écris / comme on se sauve / mes jambes à mon cou", écrire en particulier son lien avec la terre "est-ce ton pays / ce pays / qui t'écartèle? " et le monde à découvrir " je ne suis pas en deçà de la route que je suis ", " un écho bruissant du monde déposé dans la matière brute, la pierre, le caillou, le grain de sable, la poussière."
Se sachant malade, Desportes se confronte aussi à la mort " j'ai laissé la route / se défaire / de mes pas " avec au bilan " tout ne fut pas vain dans ce désastre / il nous reste des mots des rêves ". Ouvrage-leg que ce cri, " une déchirure qui est la matière des mots ".
Mais le noir n'est pas la seule couleur de cet ouvrage. Le blanc neige des " jours évidés " y occupe aussi une bonne place. Le blanc de la page, dans l'amitié d'André du Bouchet " en amont du mot / sur la page vierge ". En filigrane aussi René Char en son Isle. Mais la couleur Desportes la côtoie aussi dans son compagnonnage avec des artistes comme Katuchevski. Et son recueil fait aussi bonne place au bleu lumineux de quelques détours au soleil de Provence, des Cévennes ou de Tanger, pays de ciels, de vents et de pierre.
Bien entendu, ce Cri muet, d'un noir multicolore, n'est qu'un fragment de la vie de Desportes mais "ce dont on ne peut parler / reste seul à dire " mais aussi "ce qui n'est pas dit / demeure en mémoire dans le ciel ".
Que Bernard Desportes trouve sa demeure en nos mémoires.