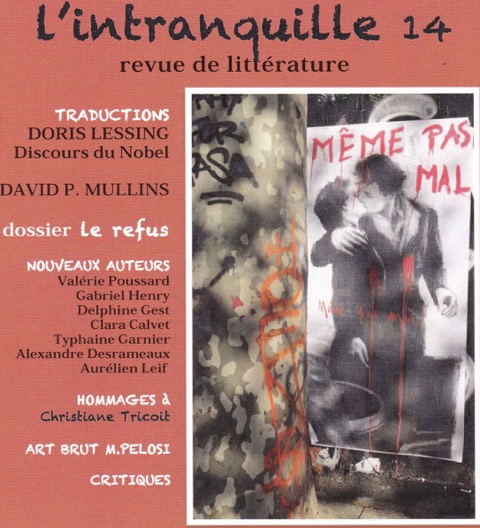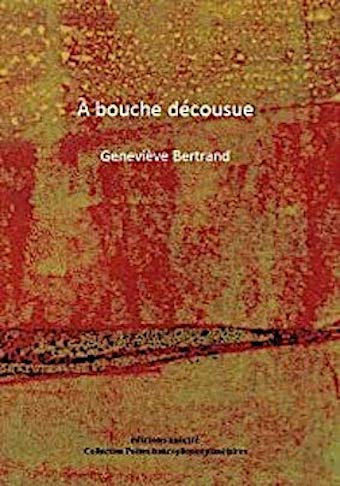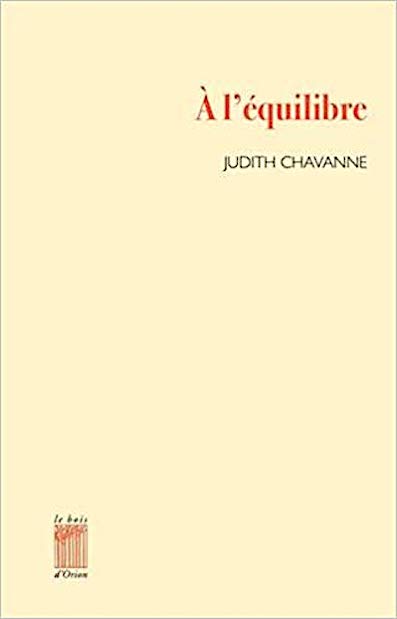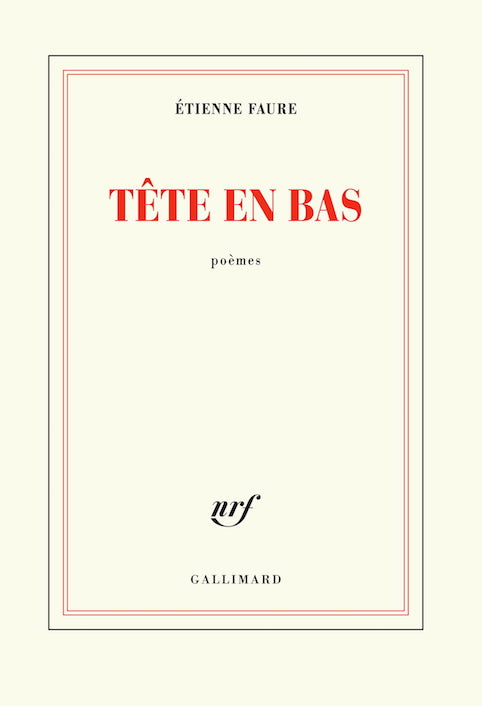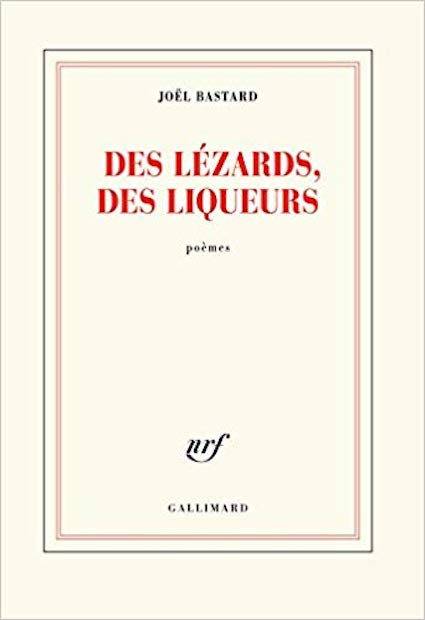Jean-Charles Vegliante, Recommencements
Frères Humans qui après nous lirez,
n'ayez les cœurs trop durs mais Let it be !
Et si de nous pauvres vous recordez
nous serons là en vers vivants così :
On s’éveillerait d’un limon maternel
(quelqu’un se souvient peut-être en quelque lieu
de : l’ amour, atome épars, fera frémir)
on aurait dormi au fleuve irréversible...
on serait sans épaisseur inconciliable,
comme la note unique lancée au ciel :
plume peut-être
lune
Genesis
Quand l’ aucunelangue suffisait à faire
la paix entre les membres du clan unique,
peureux dans la ride-vallée de leur terre
dont personne ne sortait – ou pour la fuite
définitive parmi les monts-de-mort,
il n’y avait nul besoin de se parler :
les yeux et quelques gestes nous apaisaient.
Le souffle était pour la braise, et vivre encore,
le grondement danger tonnerre combat,
les lèvres scellées gardaient leur secret rouge.
Les premiers à partir ne surent pourquoi.
Notre petit pays fut comme une bauge
où l’on se retournait sur les mêmes pas.
Hors du vallon, les premiers mots interrogent :
– est-ce babel, ce chas ?
– toute langue s’arroge ?
– ne reconnaît-on pas ?
Bab’el, la porte du ciel
Assez traduit, assez trahi, laissez-moi
le silence entre les mots, ce qui redit
ce qu’évoquaient les mots, leur insuffisance,
la matrice obscure, basse sous la tour,
d’où ils proviennent sans savoir, sans le dire
le détruire en leur profération. J’aspire
au murmure dispersé (bis) par le vent
qui murmure (bis-bis) pour ne pas mourir !
Dans la terre qui lange les mots (bis-dis)
s’effaceront les blessures de Palmyre,
germineront les gravats comme des vers.
Les assassinés parleront dans le bruire
du soir quand même les volants sont sans voix.
Les mots (bis) humiliés, sans bouche vivront !
Toujours
L’homme jeune demande qui il est.
Nul ne peut répondre. Il cherche le plus loin
possible, chez l’autre, au bout du sexe, là
où il n’y a pas d’issue, il veut rejoindre,
désir originel, sa conception,
la mère première où il s’abîmera.
Il sait qu’il est un humain, la sphinge un monstre,
la Reine ce pouvoir, relais à étreindre,
quitte à tout perdre et soi-même enfin trouvé.
Enfant trouvé, enfin perdu, libre enfin :
voir à l’intérieur, que les mots démontent.
Au bout est la Reine, la rien, la réponse...
Un jour il est vieux, plus aveugle qu’avant,
et ne sait comment le temps l’a berné.
La nuit longue
La nuit a été longue. Au jour nous voilà,
essayant de ne pas pleurer sur nous-mêmes.
Une fleur, une flamme éclatante, un simple
cri jaune feu, vacillante vie surprise
par l’aube : hibiscus du 14 novembre.
La nature nous console indifférente ?
Les humains se serrent autour comme avant.
L’eau coule lustrale maternelle (ma’ !)
sur le corps vieilli, couturé çà (et las),
mais vivant – vivant – et si reconnaissant
par son simple cri, la peau, son goût de cendre.
Tout est un ‘bis’ pour ce jour de plus, commun.
(Ne te retourne pas, n’essaie pas d’entendre
le souffle profond d’Hadès, le noir suspens.)
(14 novembre 2015)
Une voix s’entend à Rama
Passe à présent par les nues le cri de beaucoup
d’enfants. Des vautours invisibles les emportent
peut-être dans le vent d’Est qui vient de Palmyre,
dans le vent du Sud tunisien où tant s’effondrent,
où le désert semble annoncer les flots amers
des prochaines traversées vouées au naufrage.
Quand les mères même doivent choisir lequel
laisser glisser sans un cri de leurs mains de cire,
les pères se résigner à la honte d’être
survivants prêts à obéir où l’on voudra.
Mais on entend de plus loin aussi ceux qui n’ont
vécu que sous l’épouvante des massacreurs :
ils leur apprenaient en riant comment détruire
pour ne pas succomber, pas être pris, pas croire.
– Pas choisi d’être là !
– Pas voulu votre nom,
ni notre faible cœur.
Schibboleth
“Ne parlez pas comme ceux que vous tuez !"
Ne parlez pas la même langue que nous
au moins, ne salissez pas dans votre bouche
de bouchers les mots qui ont servi à dire
la rose et la peau cachée, les dents de lait,
notre légère ivresse de liberté
et le fuyant réconfort d’autres sourires.
Reprenez votre idiome de miel glissant.
Ne nous acculez pas à cette défiance
entre proches, qui faisait juger d’un mot,
au passage du Jourdain – vie sauve ou mort –
sur l’infime différence entre sh- et
sch- (drap consolant ou couteau à la gorge).
Ne proclamez pas la haine qui dévore.
Fragment du lac asséché
Ils ne seront ensevelis ni pleurés...
... dans quel entrelacs tu te débats,
quand les murs s’écartent tu es exposée
aux injures de la foule...
Leur charogne sera nourriture
pour les prédateurs du ciel, les bêtes de la terre
...
“C’est la première fois que nos entretiens
se terminent dans les larmes.”
Cette voix nous écrase contre terre
radicale
...
... aux crachats...
... sans l’haleine du Vivant
sans lit de chaux
Ils ont tué l’archéologue
Ô cités de l’Euphrate !
Ô rues de Palmyre !
F. Hölderlin
Il a ses yeux de dormant, parle au vent de la nuit :
J’ai aimé la petite fille que tu étais
et la très jeune femme que je n’ai pas connue.
Les rêves ne présentent plus que d’infimes restes
– Mais pourquoi ces photographies jaunes nous éprouvent ?
Pourquoi ne croyons-nous plus à nos corps triomphants ?
la beauté de pierre et de bronze résiste moins...
Nous habitons des lieux étranges, que l’air déleste,
chacun s’efforce d’oublier l’horreur qu’il a faite.
Lui est un vieil homme à présent, il classe les nues :
– Quand tu me retrouveras, “caro nova fiet”
quand in die irae serons là réunis. –
Le monde atroce chasse, dévore ses enfants.
(D’un recueil en cours d’écriture)