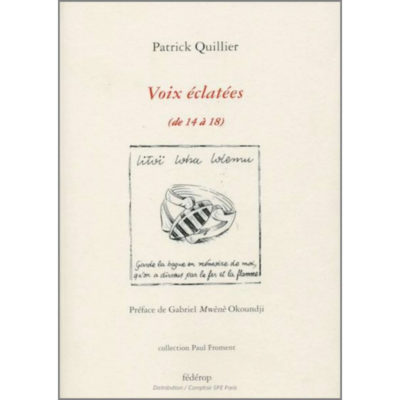Gilles Baudry et Philippe Kohn, Roland Halbert, Xavier Grall
Gilles Baudry et Philippe Kohn : « Haute lumière »
Etre moine bénédictin en Bretagne. Et le dire en poèmes à l’occasion des 1200 ans de l’adoption de la règle de saint Benoît par les moines de l’abbaye de Landévennec. Gilles Baudry, moine-poète, décline en une trentaine de textes cette « vie humble à fleur de terre », accompagné par les photographies en noir et blanc de Philippe Kohn.
« Communier sous les espèces de la vie simple ». Etre moine bénédictin, nous dit Gilles Baudry, c’est conjuguer louange, pauvreté, silence, sobriété. C’est accepter le « terne quotidien » et savoir entendre « l’appel des lisières ». C’est vivre à l’écart mais dans une « solitude ouverte » en trouvant la « juste distance ».C’est « oser la confiance/malgré nos indicibles contre-jours ».
Gilles Baudry nous avait déjà fait saisir du doigt les « grandeurs et servitudes » de la vie monastique dans son Demeure le veilleur (éd.Ad Solem, 2016). Il nous en parle plus directement ici, nous disant comment il faut savoir « faire vœu d’effacement » et demeurer ce « veilleur de l’invisible » qui se tient « à l’ombre lumineuse du silence ». Mais sans jamais renier le concret, la routine, le quotidien. Pour les moines de Landévennec, il y a le verger de pommiers dont la récolte donnera une production de pâtes de fruit. Mais il y encore plus le « Jardin des Ecritures » arpenté quotidiennement dans le chant et la prière « à ciel ouvert ». Frère Jean-Michel, abbé de Landévennec, le dit à sa manière dans la préface du livre quand il parle de « l’intuition de Benoît invitant le moine à trouver Dieu en toute chose : à l’oratoire comme aux champs, dans la lectio divina aussi bien que dans le travail des mains ».

Haute lumière,Gilles Baudry et Philippe
Hohn, Locus Solus, 80 pages, 18 euros.
Landévennec (à la pointe du Finistère), où saint Guénolé, un jour, jeta l’ancre, est cette terre d’élection où la louange monte « dans le miroir/sans tain des brumes basses »comme « derrière la silhouette profilée du vent ». Gilles Baudry entend le « bruissement de l’Ecriture », s’adresse à son « Seigneur »,ce « premier-né d’entre les morts ». Pour accompagner ces mots sur cette vie humble, il fallait les photos épurées de Philippe Kohn. Pas de moine derrière le viseur de l’artiste, mais tout ce qui témoigne de leur vie simple : les épingles d’un séchoir à linge, un alignement de chaises en paille, une salle de réfectoire vide, un bouquet de fleurs sur une table en bois, un cloître gagné par la lumière… Tout en noir et blanc, comme ces compagnons du quotidien appelés arbres, racines, râteaux, feuilles… Oui, une prière en images « à ciel ouvert ».
Gilles Baudry accompagne par ailleurs 11 pastels de Nathalie Fréour dans un petit livre d’art intitule L’orée (18 euros + 3,50 euros de frais de port à l’ordre de Jean Lavoué, éditions L’enfance des arbres, 3, place vieille ville, 56 700 Hennebont.
Roland Halbert : « L’été en morceaux »
Le poète nantais Roland Halbert entre avec brio dans le cercle restreint des auteurs qui ont raconté, par le truchement du haïku, un séjour à l’hôpital. On peut donc, désormais, l’associer aux prestigieux Masaoka Shiki et Sumitaku Kenshin, haïjins japonais ayant écrit sur leur maladie. Skiki, qui meurt à 35 ans, en 1902, d’une tuberculose osseuse, est l’auteur de Un lit de malade, six pieds de long. Kenshin, qui meurt à 26 ans, en 1987, d’une leucémie est, pour sa part, l’auteur de Ebauche et de Inachevé, haïkus précisément consacrés à son hospitalisation.
Roland Halbert, qui fait d’ailleurs allusion à eux dans son livre, publie Un été en morceaux, journal en 103 haïkus de l’été 2015. Il sous-titre son livre chambre 575 par allusion au « pouls métrique »du haïku classique en 5, 7, 5 syllabes.
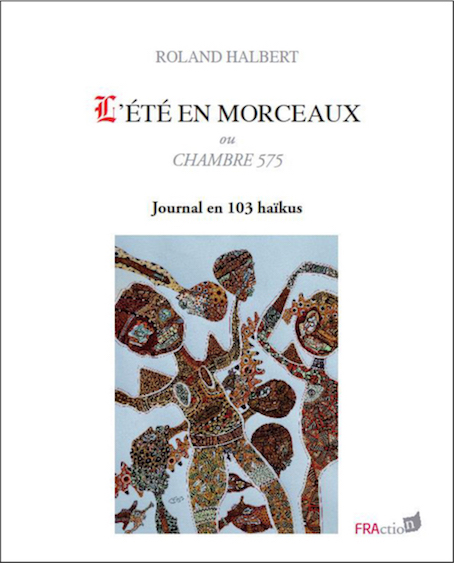
L’été en morceaux, Roland Halbert, éditions
Fraction, 105 pages, 25 euros.
« Ce court poème à l’oreille ultra-fine,écrit l’auteur dans une introduction à son livre, est une médecine douce ». Poursuivant la comparaison, il suggère « de ne pas dépasser la dose prescrite ». Puis il cite Julien Gracq pour qui « le haïku agit à dose homéopathique » (lettre à l’auteur de 2001).
Comme dans tout haïku digne de ce nom, dominent ici l’humour, l’ellipse et l’autodérision. Faut-il rappeler que Roland Halbert (auteur d’autres excellents livres de haïkus) maîtrise à merveille le genre? « Ma belle d’été/s’appelle Morphine/ -cœur en quarantaine ». Ou encore ceci : « Prendre son mal en patience…/je fais de la sonde/ma corde à sauter ». Dans cette approche du plus fragile et du plus précaire – qui caractérise aussi foncièrement le haïku – il peut aussi signer ce merveilleux haïku : « Pies, moineaux, mésanges/qui veut pour perchoir/ma potence grise ? ». Issa n’est pas loin (« Viens jouer avec moi/moineau/qui n’a pas de mère »).La lune (figure totémique du haïku) est là, aussi, consolatrice : « A l’étage un enfant hurle/couleur doliprane, la lune/le soulage ».
De bout en bout, le dehors dit le dedans. La nature est là pour exprimer les douleurs ou les désarrois du patient. Pas étonnant, donc, qu’une« figue saigne »,qu’un « merle s’alarme »ou que « pris dans les boues rouges/un scarabée estropié/baratte le jour ». Confiné dans sa chambre d’hôpital, Roland Halbert fait vibrer le monde extérieur. Ses sensations de malade sont celles d’un homme de plein vent dont le corps est aujourd’hui « empli de frelons ». Et, quand convalescent, il fait ses premiers pas, tout naturellement il peut écrire : « Marche à pas pénibles/le rouge-queue chante/les progrès de la médecine ».
Pour ajouter au bonheur de lire ce journal/album si incarné, au ton si juste, Roland Halbert a fait danser les haïkus dans la page. Une manière de nous rappeler que le fond c’est aussi la forme.
« Solo » : poèmes et dessins de Xavier Grall
Solo réédité. Oui, mais avec des dessins de Xavier Grall lui-même. « Dessins colorés, naïfs »,dont le poète a « enlacé, enluminé, illuminé ce long poème »,note en introduction Marc Pennec.
On a tout dit sur Solo, œuvre essentielle sinon majeure de Xavier Grall. Le livre est publié au 2etrimestre 1981 par les éditions Calligrammes à Quimper, soit quelques mois avant le décès du poète en décembre de la même année. « Solo est un long chant de de réconciliation, nostalgique, très tendre, plein d’amour et de considération pour les êtres et les choses, d’un lyrisme au style laconique, précis », écrit Yves Loisel dans la biographie qu’il a consacré au poète de Bossulan (éditions Jean Picollec, réédition Coop Breiz 2015). « Xavier atteint le sommet de son inspiration lyrique et musicale dans Solo, en particulier dans cette fluidité de la mélodie de ses nostalgies et du temps qui passe », note pour sa part Mikaëla Kerdraon dans l’importante biographie qu’elle consacrera aussi à l’auteur (An Here, 2000).
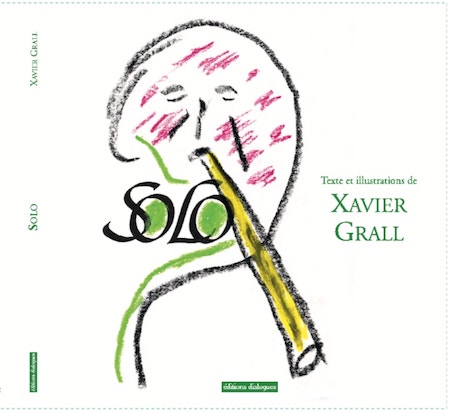
Solo,textes et illustrations de Xavier Grall,
éditions Dialogues, 45 pages, 12 euros.
Qui n’a pas désormais en tête, s’il s’intéresse peu ou prou à la poésie bretonne, ces vers qui introduisent Solo : « Seigneur me voici c’est moi/Je viens de petite Bretagne/Mon havresac est lourd de rimes/De chagrins et de larmes ». Des mots qui reviendront régulièrement dans la bouche du jeune Yvon Le Men dans les récitals où il déclame les textes de Xavier.
Xavier Grall, de bout en bout, s’adresse ici à son Créateur. Il lui parle de cette Bretagne qu’il va quitter (ou qu’il a déjà quittée) et lui adresse sa requête au moment de Le rencontrer par delà la mort: « Seigneur Dieu c’est moi/J’ai fait un grand voyage/Permettez que je retourne en Bretagne/ Pour vivre encore quelques années/Je n’ai pas grand âge/vous le savez ». La Bretagne qu’il a aimée est celle des« oraisons ferventes », celle des « bonnes auberges », celle des « grèves ivres », celle des « hymnes marins »… Dans sa « bretonne supplique » (à la manière de François Villon, sous d’autres cieux, en d’autres temps), Grall demande à Dieu de lui redonner sa « maisonnée » et sa « femme française », mais aussi ses trois bouleaux, ses deux cyprès et son « talus buissonnant ».
Aujourd’hui les dessins du poète donnent une couleur chatoyante à cette supplique. Avec les pastels qu’il s’était procuré auprès de Geneviève, une de ses cinq filles, le poète avait apporté « une contrepoint solaire, lumineux, presque enfantin, au tragique de Solo »(Marc Pennec). On y découvre un bateau toutes voiles dehors, un caboulot (« Au repos du marin »), un calvaire comme entouré de buissons ardents, un phare… Un pays« glaz », naviguant entre le bleu et le vert. Sans oublier un « Christ bleu »,en référence au Christ jaune de la chapelle toute proche de Trémalo. « Mais Seigneur Dieu/Comme la vie était jolie/En ma Bretagne bleue ». Amen, Alleluia !