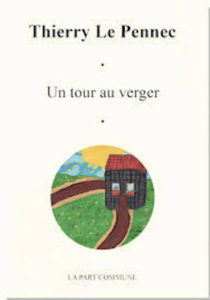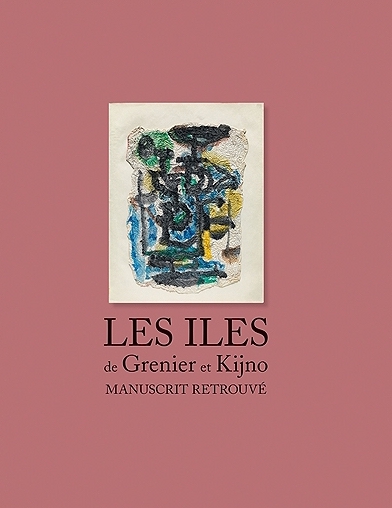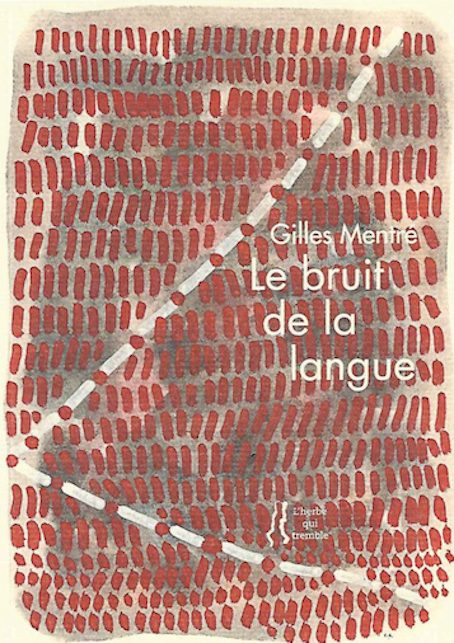France Théoret, Cruauté du jeu
Une révolte poétique
Thème commun aux trois parties qui constituent ce recueil, la cruauté, traitée sous différents angles : cruauté d’une enfance et d’une jeunesse démunies ; cruauté de la maladie, celle de la folie. Ce qui ne tue pas renforce, paraît-il. France Théoret a dû traverser plusieurs morts pour se construire. Dans ses épreuves, elle n’a cessé de lutter, de penser, de mettre en forme les paroles insurrectionnelles.
Cruauté du jeu illustre ce que soutenait Laure Adler, interviewée dans Le Monde((Laure Adler, « L’affaire Weinstein, une révolution ! », Le Monde, rubrique Entretien, 1er décembre 2017)) au sujet de son Dictionnaire intime des femmes, hommage aux devancières. Elles n'ont pas attendu l'autorisation et l'impulsion de la société pour avancer dans tous les domaines...Leur impulsion part toujours de l'intime et d'une interrogation sur leur propre vie...Quelle affirmation puis-je porter en moi ? Et comment participer au monde en offrant mon propre combat ?

France Théoret, Cruauté du jeu,
Ecrits des forges, novembre 2017.æ
Texte 1- Art poétique
Jamais, comme dans ce recueil, France Théoret ne s’est autant dévoilée. La 1ère partie (prose) s’achève sur cette phrase qu’il convient de prendre au pied de la lettre : Au départ, il y eut la faim, la soif, le froid.
La petite fille devenue jeune fille désire quelque chose qu’elle n’ose même pas formuler : une vie comme une œuvre d’art, une vie studieuse. Comment a-t-elle pu concevoir, même si ce n’est que très confusément, cette ambition ? Mystère. Elle vient du dénuement : Rien n’a été au début, moins que le rien, du négatif a été mon lot…Le début n’a pas eu lieu. Et de l’humiliation, infligée par le père, les supérieurs, les religieux. Dans le Québec noir des années d’après-guerre, ils s’en sont pris à mon cerveau.
Pas de consolation. Pas de Dieu et une mère aux violences hurlantes qui incarne, lorsqu’elle lui fait face, l’horreur d’être femme (3ème partie).
On ne peut qu’imaginer les ressources qu’il lui a fallu mobiliser, le courage et la ténacité qu’elle a dû déployer pour réaliser ce rêve d’enfance. Au long de ces années de résistance et de construction de soi, des constantes. Refus des slogans, mots d’ordre et consensus faciles, le réconfort venant de la conviction de ne pas être seule à mener le combat - Laure Adler évoque cette solidarité féminine si contagieuse.
Refus d’une classification entre la poète, la femme et la militante.
Dire. Son combat, France Théoret le mènera dans le domaine de l’écriture. Sans sentimentalisme et sans métaphore, au plus près de ce qui a été vécu, supporté, elle dira le poids des cruautés supportées par elle et toutes les femmes. Dire la violence…Signifier avec le moyen du langage que la violence existe, tel est son propos même si elle reconnaît la valeur approximative des mots. Celle qui fut immensément révoltée et qui le reste peut, aujourd’hui, affirmer, tête haute :
Il y a ce que moi, France, j’ai écrit.
Texte 2 - Vint la maladie
Dans ce poème de près de 20 pages, France Théoret conte le combat récent contre l’invasion silencieuse (le nom médical/n’apparaîtra pas/trop de répétitions en vue). Les souffrances tyranniques, les faiblesses récurrentes, elle les traverse en récusant les injonctions et les projections de son entourage et des bien-portants.
Ne pas compter sur l’auteure pour s’apitoyer sur son sort ou chercher à provoquer l’apitoiement.
Bien au contraire, le mal offensant engage à la sédition. Se battre, même ravagée, contre l’âge de la défaite. Devant l’ennemi lever la tête/au milieu du désastre ; sans compromissions, à commencer par les arrangements vestimentaires. La tête refuse le voile/sous aucun prétexte/ le nu commence par là.
Texte 3 - Ma mère la folie
Texte terrible et magnifique. Une femme suppliciée, tout en impulsions réflexes instincts brusques…Qui n’a rien retenu/ de son père ou de sa mère/ à l’exception qu’il faut paraître. Une femme double, qui hurle sans fin. Dans la maison fermée au monde, sans chauffage, au sous-sol où brillent nuit et jour des ampoules nues, la petite fille, la jeune-fille absorbe tout, en silence.
Je vis fusionnée à vous
je ressens votre détresse
en pure gratuité j’éprouve
une peine sidérante…
Pas d’étanchéité
les crises m’effraient
je les conserve dans mon cerveau…
Il y a là une force inconnue
quelque chose plutôt que rien.
Vous me possédez
je ne suis plus jamais seule…
Et encore
L’irrecevable douleur
s’enferme et découvre
à contretemps sa présence
aussi certaine que son propre corps…
France Théoret gardera longtemps le silence sur ces années où l’invivable l’entraînait à répondre oui à cette interrogation : une femme c’est donc cela//une pure inadéquation au fait de vivre.
Même si demeure en elle l’empreinte sauvage des épisodes lointains, elle peut aujourd’hui, affirmer dans ce clair poème du deuil : Mère vous n’êtes plus n’avez aucun nom/n’êtes ni la cause ni l’effet
Assurément, France Théoret a toute sa place dans le Dictionnaire intime des femmes.