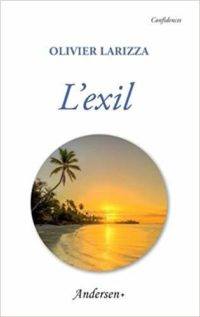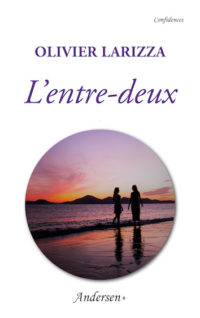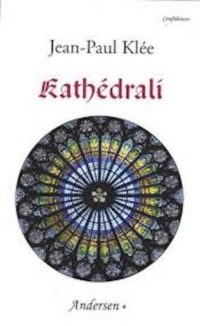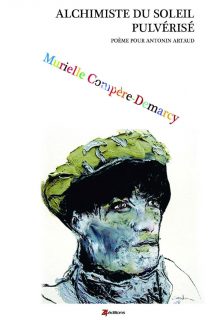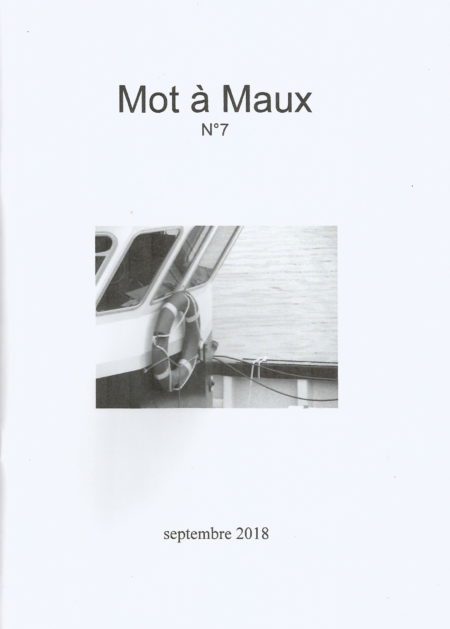Edgar Lee Masters, Spoon River
Edgar Lee Masters, avocat à Chicago (1858-1950), commence sa carrière littéraire à l’âge de 50 ans. Auteur prolixe, il écrira pas moins de vingt et un recueils de poésie, six biographies et romans et douze pièces de théâtre. L’édition augmentée de Spoon River a paru en 1916. Les premiers poèmes ont été publiés en 1914 sous le pseudonyme de Webster Ford. Il est écrit dans la préface que Webster Ford devient la figure du dernier poème, le dernier mort enterré. Le double prend place parmi les personnages, comme une forme de testament et comme un fantôme de l’écrivain avant sa mort.

Car oui, Spoon River (qui est une rivière de l’Illinois) est ici le nom donné à un village, également nommé la Colline. L’espace central du recueil est cependant le cimetière de ce même village. En effet, chaque poème est un épigramme, s’entend la voix d’un membre décédé de la communauté. Le cimetière devient le lieu où une ultime parole s’échappe, immense fresque où, telles des mosaïques, les destins se disent, se croisent, s’entrechoquent. Chaque mort inhumé révèle ce que fut sa destinée, la teneur de son existence, sa place dans le monde, véritable tableau des passions et des caractères est-il écrit dans la préface. C’est un prisme acéré et subtil de la société américaine de la fin du XIX et du début du XXe siècle (entre la fin de la guerre de sécession et le début de la prohibition). Dix neuf histoires sont distillées dans le recueil, reviennent certains visages et lieux nous dit Masters, trois zones non titrée se chevauchent : les idiots, les ivrognes, les ratés, les gens du commun, les héros et esprits éclairés.
La traduction du recueil par le Général Instin poursuit le dessein de l’auteur et l’amplifie. Ce ne sont plus seulement des voix d’hommes et de femmes jaillies d’un microcosme américain qui se font entendre, mais le souffle même de la parole. L’auteur s’empare du pouvoir de l’écriture. Il transmue la finitude en la ridiculisant par une pirouette, elle devient non pas un spectacle figé mais étonnamment magique parce qu’inspirant (à cet effet, découvrir les prolongements de la traduction d’Instin sur le webzine littéraire remue.net). Le Général Instin a traduit Spoon Riveren 1917. Soldat officier de l’armée française et blessé (il a perdu un œil, une oreille et une partie de la pommette), il a, lors de sa convalescence, traduit le recueil (traduction confiée aux actuels éditeurs par un libraire de la rue Trousseau en 2009). Ce n’est pas un simple parti pris du traducteur (les enjeux sont plus vastes que cela) mais le Général Instin a compris que l’authentique auteur de Spoon River n’était pas Masters mais bel et bien Webster Ford, ce double de l’auteur, dont l’épigramme achève le recueil : contrairement à Edgar Lee Masters le copiste, écrit Instin, la gloire littéraire ne nous concerne pas// Nous préférons reposer, auteurs véritables, c’est-à-dire, disparus, auprès de nos créatures pour être dignes d’elles.//Webster Ford a trouvé la digne façon d’écrire. Car seules importent les épitaphes jamais gravées dans la pierre, celles qui restent dans l’air, présentes et absentes.
Le Général Instin renvoyé sur le front le 25 décembre 1917, a poursuivi l’œuvre de Masters avec ses Autres chants de la rivière (présents dans cette édition). Ces poèmes sont dédiés à des personnages cités dans l’œuvre intégrale de Masters. Son admiration pour le poète est telle qu’Instin, plus que s’identifier à Masters, saisit l’essence même de Spoon River qui est de recouvrer et mettre en œuvre l’ineffabilité du langage même. Sa traduction (comme le signalent les derniers vers du poème suivant) en est d’autant plus puissante.
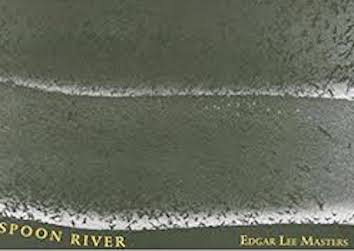
Edgar Lee Masters, Spoon River, Catalogue des chants de la rivière, Othello Traduction Général Instin.
Soldat inconnu
Mort, j’entrepris de traduire ces épitaphes qu’il avait
vivant, consacrées aux morts de la rivière Spoon,
non pas les phrases officielles mais ce que, morts,
ils auraient dit s’ils avaient eu le loisir de parler aux vivants.
Combien de fois rivière franchie puis à rebours, dans un sens,
puis l’autre. Combien de fois barque chargée, de mots,
de corps, d’histoires, une rive éloignée,
une autre langue, un autre temps.
Je n’ai pas fait le compte.
De mes yeux fatigués, j’ai repris lettre à lettre,
mot à mot, chant à chant,
et jamais ne me quittait l’espérance insensée :
voir Petit le poète, voir Caroline Branson, voir le Maître
en personne débouler dans ma pièce
et pour chaque mot, chaque phrase, chaque lettre,
me dire ce qu’il en était, me le dire dans la langue
à tous les morts commune,
celle qu’on ne traduit pas,
celle qui est.
Général Instin
La poésie contenue dans les épitaphes condense le sens et la portée de ces dernières. La simplicité apparente du vocable offre à l’ensemble une légèreté voire une certaine volatilité. Les épigrammes semblent flotter comme des voix dans le vent. Ce que le lecteur en perçoit le surprend et le trouble, car avec Lee Masters, la destinée d’un individu, même réduite parfois à dix lignes, a le pouvoir de l’exceptionnel même dans ce qu’elle a de plus médiocre voire d’immonde. Sa connaissance des autres est grande, il nous révèle leurs secrets, leurs affres les plus intimes, leurs méfaits et fulgurances. Aussi singulière que soit chaque existence, chacune d’elle est reliée à une autre, non seulement par le partage d’un territoire et d’une époque, ou par des histoires croisées, mais surtout par la force et la liberté de pouvoir enfin dire sa vérité. La poésie en est là l’unique vecteur. Elle est incarnée dans le recueil par des personnages, que ce soit Petit le poète : Triolets, villanelles, rondes et rondeaux/ pois secs dans leur cosse, tic, tic, tic/tic, tic, tic, quels petits ïambes,/pendant qu’Homère ou Whitman rugissaient dans les pins/ou Minerva la poétesse bouleversant la vie du docteur Meyers, les nombreuses références : Ce sommet est la pensée de Dante et Milton et là Shakespeare. Dans le poème final, Lee Masters dissimulé, rappelons-le, sous le nom de Wester Ford s’adresse directement à Apollon et achève son poème par ces mots : êtres vivants-Apollon de Delphes !
Seuls les morts se disent dans le recueil et se révèlent, la poésie est cependant la langue, la seule langue possible pour cela. Aucun être humain n’échappe à sa destinée mais l’unicité et le mystère de chaque vie, par l’ultime disparition : Celui qui a vu le visage d’Apollon ne peut vivre, trouvent un ancrage au cœur même de la poésie. Lee Masters/Webster, en donnant voix aux habitants de la Colline, absents, traduit là l’extraordinaire pouvoir de ce langage qui est de donner souffle et vie à l’impossible et au silence.