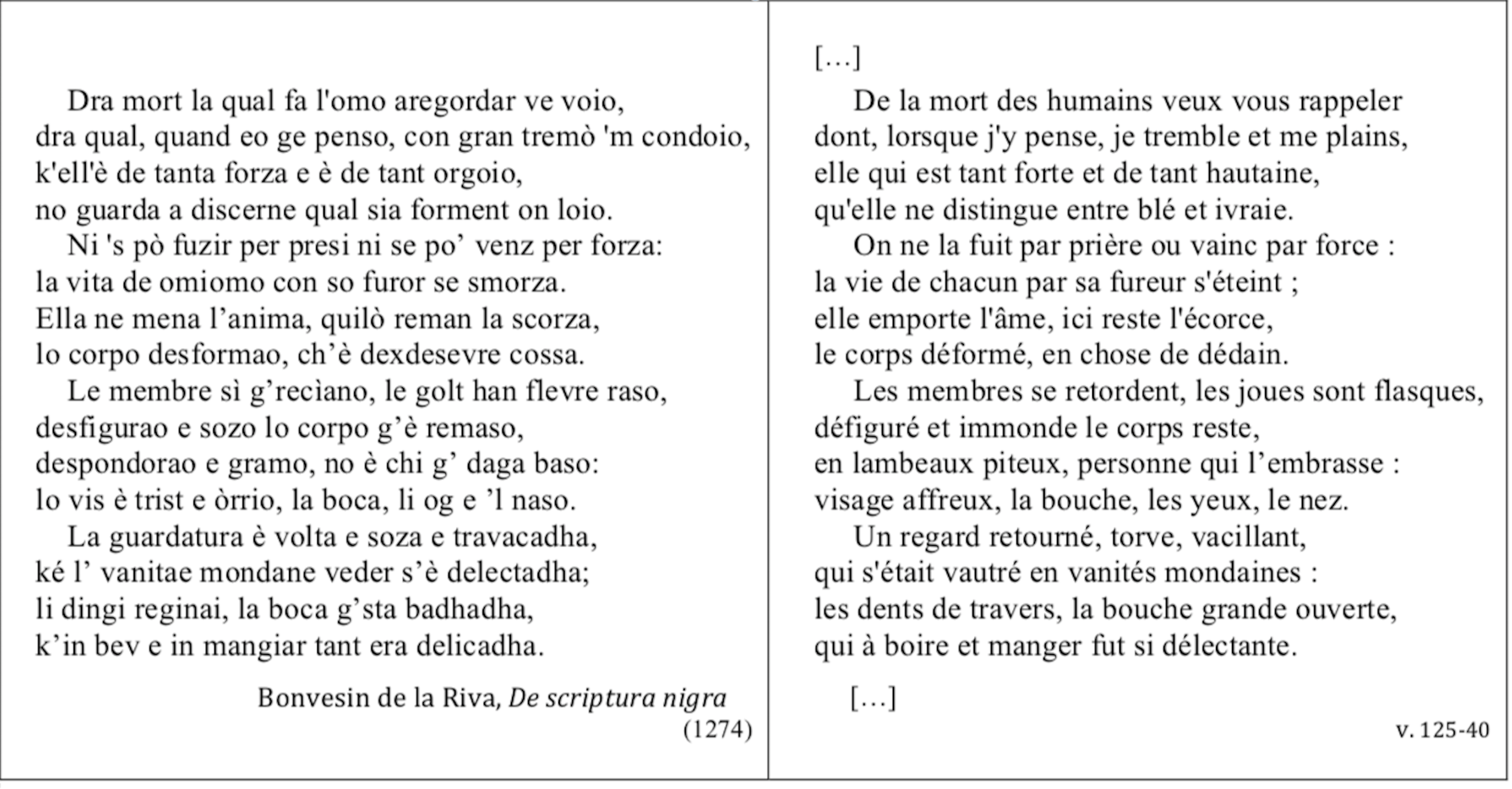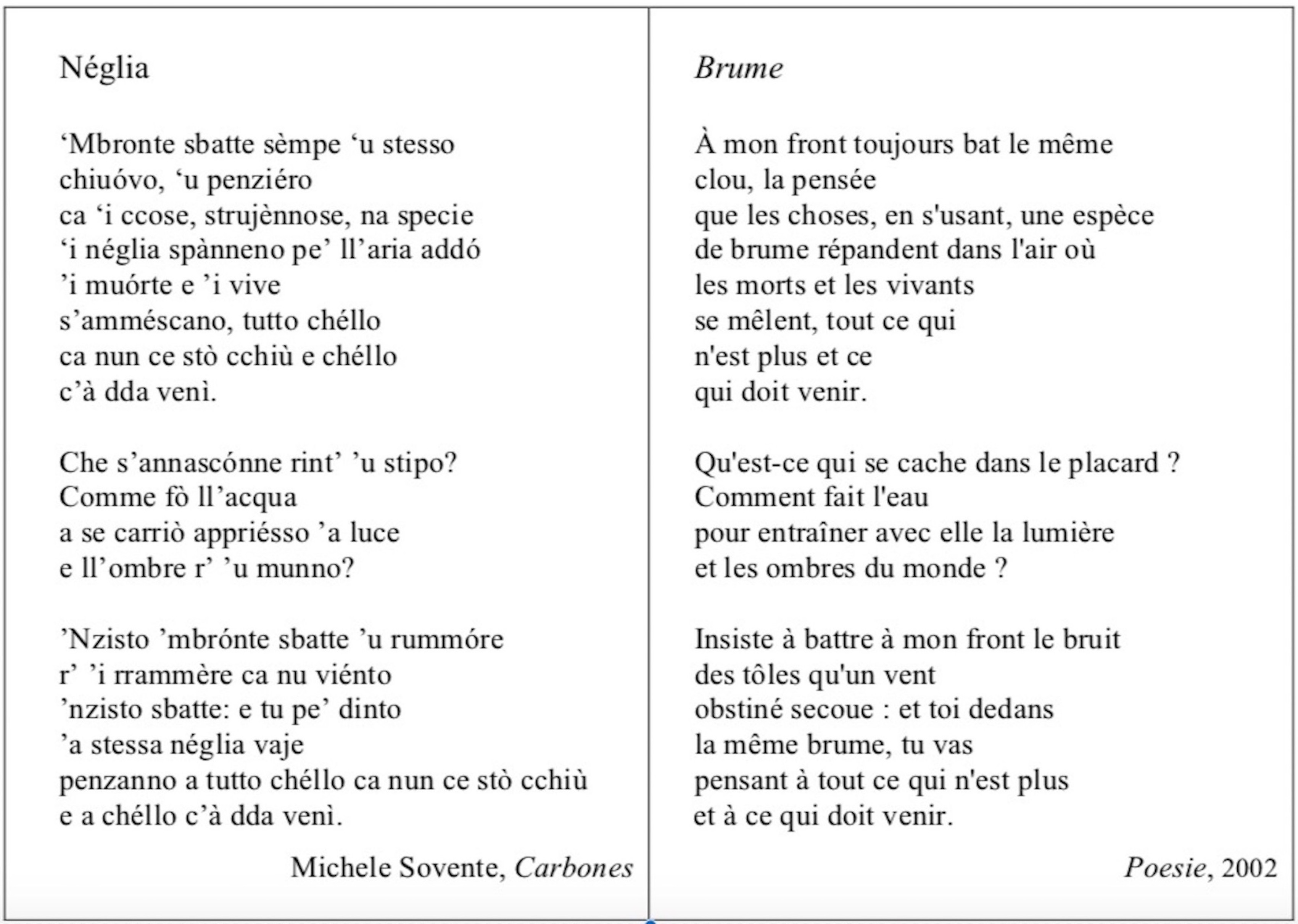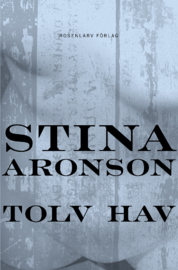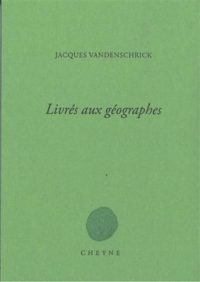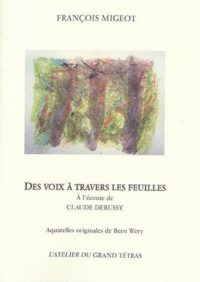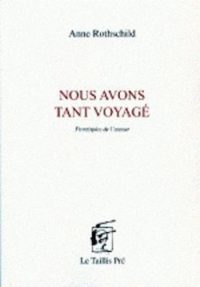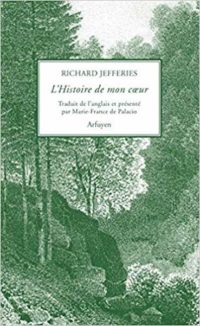Mario Fresa : extraits d’alluminio
traduction de Damien Zalio
Così noi siamo rimasti al fiume,
sulla strada confinata di carezze, nella lotta
della gioia:
nel mutamento dell’adagio si è caduti
in quell’immenso fiato e nella vaga,
trascinata bianchezza
di quegli anni.
Qui mormorava il nastro della gola,
c’era l’immensa porta che inghiottiva i nostri passi,
e invece poi nessuno ha ricordato le parole
che migravano stupìte, nel cielo retrocedendo
con una dolce danza:
«ma guarda
come ci succhia, adesso, guarda come
ci rinnova, questa fervida luce
respirata»
l’esile bocca disse che fu sovrano incendio
e che fu preda.
Alors nous sommes restés à la rivière,
sur la route enserrée de caresses, dans la lutte
de la joie :
au changement d’adagio nous sommes tombés
dans cet immense souffle et dans la vague,
traînante blancheur
de ces années.
Là murmurait le ruban de la gorge,
il y avait l’immense porte qui avalait nos pas,
mais finalement personne n’a retenu les mots
qui migraient étonnés, à reculons dans le ciel
en dansant doucement :
« mais regarde
comme elle nous aspire, maintenant, regarde comme
elle nous ravive, cette ardente lumière
respirée »
la mince bouche dit qu’elle fut l’incendie suprême
et qu’elle en fut la proie.
Poi subito il tremore ha riposato ancora nella pioggia,
in quella lieve tranquillità che ha generato
l’indecisa, lunghissima stagione.
L’ombra nasconde docili rumori e a poco a poco estingue
in laminata attesa il precipizio d’acqua,
la crudele fratellanza dei gesti
che sgretola l’ampiezza di questo sonno duro:
un movimento ansioso che matura e si fa
grave divenire, avvelenato desiderio.
Piove sull’implorante fuoco della pelle che si stringe
respirerà la luce pietrificata in noi,
si strapperà la densa voce del diluvio
e questa mano e questo volo figurato
fanno così tremare
il dolce nome dell’invito, e i riccioli carezzano
il terreno, fiammeggiano morendo
sulle tue bianche braccia.
Si apre volando il celestiale nastro che sorveglia già le strade:
la seta fascia i gesti
e come tace lo stupore della vista,
come risplende il fiore degli abbracci
ricaduto nella luce dei fantasmi…
Et aussitôt, le tremblement s’est reposé sous la pluie,
dans cette légère tranquillité d’où est née
l’indécise, très longue saison.
L’ombre cache des bruits souples et peu à peu efface
dans une attente laminée le précipice d’eau,
la cruelle fraternité des gestes
qui effrite l’ampleur de ce sommeil dur :
un mouvement fébrile qui mûrit et se fait
avenir grave, désir empoisonné.
Il pleut sur le feu implorant de la peau qui rétrécit
la lumière pétrifiée respirera en nous,
la dense voix du déluge se déchirera
et cette main et ce vol figuré
font alors trembler
le doux nom de l’invitation, et les boucles caressent
le terrain, et meurent en flamboyant
sur tes bras blancs.
Le ruban céleste s’ouvre en plein vol, surveillant déjà les routes :
la soie emmitoufle les gestes
et comme se tait la stupeur de la vision
comme resplendit la fleur des étreintes
une fois retombée dans la lumière des fantômes…
Questo piede si è trasformato in vento:
si fanno avanti i muri, le loro bocche ansiose…
La mente già si piega sul granito degli accordi rilucenti,
e adesso il viaggio scava
lo spiraglio proseguendo senza voce,
tutto immerso nell’aceto dei sospiri:
ci svegliamo sconosciuti l’uno all’altro.
E uscendo all’improvviso, l’aria soffoca il riposo
delle mani, e il dolce fuoco si ritrasforma in gelo:
la mia lingua è nella spada».
Così che il movimento è inerpicato sopra il cielo
e poi si stringe, perdutamente insegue
ma nelle stanze di questo vento nero
si riversano le lacrime sonore,
e nel tremore vano della pace
si è fermato il precipizio,
il silenzio dilatato delle figure bianche
imprigionate ancora nell’attesa della vista,
le labbra sollevate sul respiro della neve.
.
Ce pied s’est transformé en vent :
les murs se rapprochent, la bouche impatiente…
L’esprit déjà se penche sur le granit des accords brillants,
et voici que le voyage creuse
la fissure et avance sans voix,
plongé tout entier dans le vinaigre des soupirs :
nous nous réveillons inconnus l’un à l’autre.
Et, sortant d’un coup, l’air étouffe le repos
des mains, et le doux feu se retransforme en glace :
ma langue est dans l’épée ».
Alors le mouvement se juche au dessus du ciel
puis rétrécit, poursuivant éperdument
mais dans les chambres de ce vent noir
les larmes sonores se déversent,
et dans le vain tremblement de la paix
le précipice s’est arrêté,
le silence dilaté des silhouettes blanches
encore prisonnières de l’attente d’être vues,
les lèvres soulevées sur le souffle de la neige.
Lo sguardo si diluisce adesso nelle palpebre sospese
oltre i rumori oscuri, nell’abbraccio del vento
ricaduto nelle bocche dei cespugli:
qui si ascoltano tremare le variabili dita dei canneti
nei magnifici ingressi dell’udito
Ma come sganciarsi da questa larga trama
cucita a moscacieca,
come uscire dalle crepe sfavillanti di sale,
scavalcare le mura della notte?
Le regard se dilue à présent dans les paupières suspendues
au-delà des bruits sombres, dans l’étreinte du vent
qui est retombé dans les bouches des buissons :
Ici, on écoute trembler les doigts variables des cannaies
dans les magnifiques entrées de l’ouïe
Mais comment se libérer de cette vaste trame
cousue en colin-maillard
comment sortir des lézardes de sel étincelantes,
enjamber les remparts de la nuit ?
Quest’aria fine ci ha reso allegri:
così che ci gettiamo, in un istante, correndo
a capofitto nella vaga
sorpresa dei tesori ritrovati.
Eppure, siamo partiti come naufraghi
invasa dallo schianto,
lo sguardo che traboccava intero
sulla voragine di ciò che attendevamo,
di ciò che temevamo.
Qui c’era un velo chiaro, proprio in alto,
c’era la dolce
santità dell’indugio che sapeva circondare
tutta l’aria: e poi le mani
avanti, adesso, per modellare il buio…
Cet air pur nous a rendus joyeux :
alors nous nous jetons, en un instant, en courant
la tête la première dans la vague
surprise des trésors retrouvés.
Et pourtant, nous sommes partis comme des naufragés
envahie par le fracassement,
le regard s’écoulant entièrement
dans le tourbillon de ce que nous attendions,
de ce que nous craignions.
Là, il y avait un voile clair, juste tout en haut,
il y avait la douce
sainteté des atermoiements qui savaient ceindre
l’air entier : et puis les mains
en avant, maintenant, pour façonner l’obscurité…