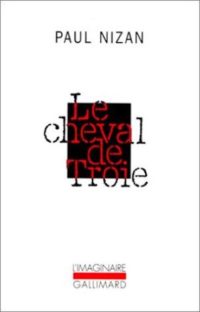PERCUSSIONS
Complainte
Poésie PERCUTÉE – les vapeurs de Paris
S’encastrent – les cheminées – le toit qui s’effondre
Sur un échafaudage – c’était ma demeure.
Mes poumons étriqués dans la fumée respirent
– Ils ont rénové la gare.
Au pavé fume amour – incartade à la rue
Entre des passants fous. L’arcane à Notre-Dame
A ricané si fort que mes poumons se crispent. –
Mes poumons suffoquaient dans la joie qu’elle inspire
– A la lune, Notre-Dame.
Chaque attaque me vêt d’une angoisse moderne –
– C’est un manteau de cuir solide à l’arc prosterne.
Chaque monument fume et mon visage attaque –
Mes poumons colorés par les fumées s’allument
– Notre-Dame à genoux – j’ai besoin de repos.
Peur
Ma tête FRACASSÉE
Percute les pavés de sa ville —
Sa pierre
Avalait mon manteau
Tombe –
Partout percute
Et coque
Ma tête en fer poli
La mare froide mon manteau – sur les pavés s’assèche
Et mon manteau n’est pas autre chose qu’un lac
de cuir un lac de pierre un sac à main pour étouffer ma peau ses pores je transpire
et m’étouffe je transpire en marchant je marche et le soleil et le soleil
anxiété
– dans les anciens récits des épopées périmées.
Percute mon passé
Dans les pavés des villes –
Ma tête s’y réverbère. –
Pneumonie
Mes poumons
se sont craqués dans ma jeunesse —
Course trop rapide
et pluie
– EXPLOSION
Dans mes alvéoles s'est aspiré un vent mauvais, – un
vent si mauvais qu'on en soupira deux ans.
J'ai cru mourir et
Je n'avais pas treize ans.
Que le malheur me suffoque – la tête
Et je t'en serai reconnaissant – tramontane.
Il pleut encore
– c'est pas vrai
il pleuvra donc aussi longtemps
que ma poésie parle ?
À peine ai-je craqué mes poumons
que mon odeur s'en dégage et s'évapore –
comme les mauvaises pensées qui m'avaient envahi
dans mes douleurs les plus terrestres et les plus aiguës
– piqûres et cachets d'aspirine pour cacher à mon corps
son oubli –
et l'empêcher d'en adonner les mots.
Les mots s'emparaient de mes articulations
Comme des os brisés craquellent –
et m'ont donné la force insurmontable
d'aller courir un peu. –
Soleil
Le soleil est trop près de moi –
Il me colle à la peau
Comme elle que j’attends depuis mille ans peut-être. –
– Peut-être à mille mètres
L’angle de chaque vague
Percute mes cheveux. –
C’est la force du monde autour de moi
Qui m’accroche la peau comme l’eau des tropiques
Et m’incite à valser.
Tout s’envole –
Sinon moi.
Tout est près
De moi – râle, ma belle mer,
A quoi bon les cris ?
Depuis trente ans j’attends déjà
Pectoraux blancs, chemise ouverte,
Face au vent que je nargue
Aux vagues qui prenaient le risque d’enrager
Et le soleil près de moi –
Râle, à quoi bon les cris ?
Pluie dispute
La nuit tombait sur toi sur la fenêtre tombe
En haut de ton immeuble – regarde les volets
Couleur lavande et les oiseaux qui s’envolaient
Du rebord de tes yeux tes cernes des colombes. –
Les bras en croix tu cries – qu’a-t-on fait de tes yeux
Bercés de solitude et fermés près de la
Fenêtre sur quoi tombe la pluie. Car il a
Plu sur Paris ce soir – persistent dans les cieux
Des étoiles. – Tes yeux tombent de la fenêtre
A l’approche du soir, puisque la pluie délave
Les vitraux fatigués de tes cernes. – L’eau claire
Et l’eau sombre ici-bas font des flaques. Peut-être
Est-ce là que la veille à la fenêtre grave
Tu as froissé puis mis à l’eau mes vers ? –