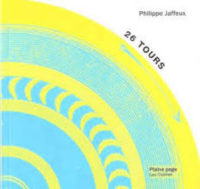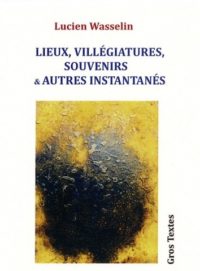Pierre Dhainaut, APRÈS
On ne sait pas. On écoute. On entend. Seul. Une chambre. Des murs, on croit en les fixant sortir de soi, bloquer/ce qui remue sous les paupières. Un brancard. Un cortège de couloirs. Une dépossession. Le bracelet d’identité au poignet gauche nous éloigne de ce monde où l’on n’a pas à dire qui on est/pour être, être en accord. Dans la nuit qui déborde, un mot pourrait en rallumer d’autres. Mais il suffit de balbutier un mot,/« porte » par exemple, pour que le souffle y puise/de quoi ébranler la mémoire, remuer l’air. On tente de « Voir de face » ce qui attend, la vaste salle où il se rend pour la première fois. Et puis, la salle de réveil ou de réanimation, les tâtonnements de la conscience, de « Cela » qui titube au milieu de l’insomnie, de l’inconnaissance au bord d’une nuit accablante.

Pierre Dhainaut, Après, L’herbe qui tremble, avril 2019, 72 pages, 13€
Après, nous pourrons « Dire ensemble » : nous perdons l’innocence/à partir du jour où nous comprenons/que leur promesse d’une source/impérissable, les mots n’ont pas su la tenir/mais nous disons, redisons malgré nous, quitte à nous essouffler, la « source », la « source ». Est-ce la source elle-même qui réclame encore qu’on la nomme, qu’on l’appelle ? Peut-on croire encore aux vertus de la parole ? Peu à peu pourtant, le langage revient, la voix basse,/la voix rauque, ardente, dévoile, une parole, la passion de dire remonte vers les couleurs et la lumière des mots : Pourpre, bleu ou jaune, bleu, jaune ou pourpre/répétons-les, ces adjectifs heureux.
Qui parle ici ? Une voix. La sienne. Devenant aussitôt la nôtre. Pas de je. Pas de nom. Un on, sujet neutre et minimum. Ou un tu qui s’adresse autant à nous qu’à lui-même. Une conscience qui observe, enregistre. Certains mots répétés, redoublés s’enfoncent dans leur sens : l’alliance, être, entendre, la source, mais suffisent-ils à nous le révéler ? Le poème renouvelle l’aveu d’une ignorance sans parvenir à l’épuiser : tu ne sais pas/que l’espace confond/ce qui vient de toi/ou d’un autre... à qui appartient cette voix ?/tu ne sais pas : réponds-lui/son visage/te rendra un visage. La neutralité du sujet correspond à l’impersonnalité d’un fond sans nom. On verra si les yeux ont vieilli,/s’ils sont prêts à s’offrir encore à l’inconnu/comme au très proche, à croire en l’anonyme,/en la généreuse ignorance. Comment ne pas songer ici à La Docte ignorance, de Nicolas de Cues, à cette interrogation sur la nature de la connaissance, à ce savoir de ne pas savoir dont parlent Montaigne, Pascal ou qu’évoque si précisément Descartes : c’est une marque de savoir que de confesser librement qu’on ignore les choses qu’on ignore : et la docte ignorance consiste proprement en ceci.
L’expérience intime que relate ce bref et saisissant recueil est composé de quatre suites comprenant chacune sept poèmes Voir en face, Cela I, Cela II, Dire ensemble. Une courte prose, intitulée. Après, clos l’ouvrage en décrivant les circonstances dramatiques dans lesquelles ces textes furent écrits. Après, après une longue opération du coeur et une interminable convalescence. Après. Ce mince vocable indique un décalage temporel. Après suppose un avant et un pendant. Il les condense, les résume, mais se situe au- delà. Avant, « l’après » reste imprévisible. Avant et pendant, le langage a perdu son pouvoir. Plus de secours ni de recours. Découverte terrible : le poème est impuissant dans l’adversité. « Pourquoi accorder tant d’importance à la poésie si dans les circonstances les plus rudes elle n’offre aucune aide ou pire, si l’on ne songe pas à lui en réclamer une ? »... Quand aux pires heures de la déréliction la poésie n’est pas là, comment ne pas mettre en cause non seulement son influence, mais son existence même ?/Elle n’était pas là, je n’en ressentais pas moins le manque. » N’est-ce pas l’espace ouvert par ce manque lui-même qui agira comme un appel ? N’est-ce pas toujours après, par la suite, à la fin que l’on peut dire et écrire ce qui s’est passé ?