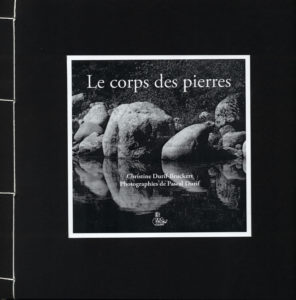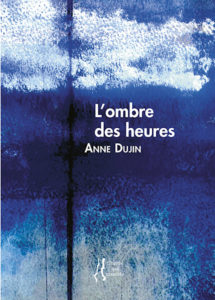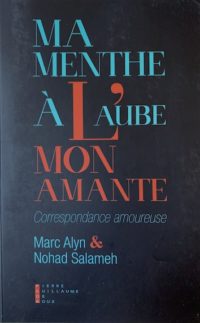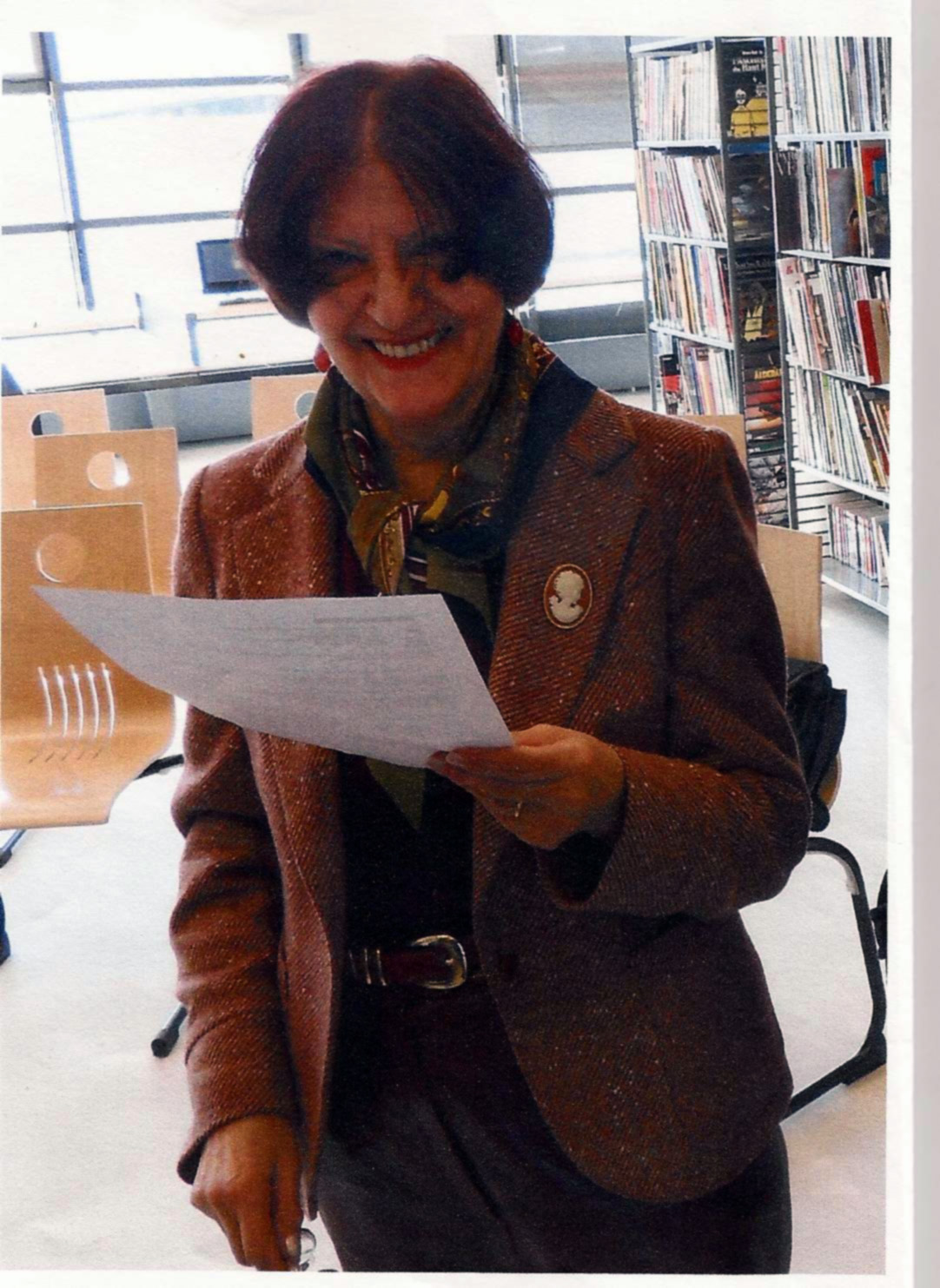Louise Brun, HURLE le ciel
Présentation :
Ces quatre poèmes ont été écrits à des moments différents, sans lien particulier entre eux, tout au moins a priori. Les réunir ici est pour moi l’occasion d’en percevoir les résonnances et les vibrations communes, leurs communautés d’espace.
Lieu Non Lieu (Vide)
On dirait que quelque chose
Cette nuit
(Une nuit, cette nuit-
Là)
S’est produit au plus intime
De l’inconnu
Au plus secret
De ma nuit
(ou de l’ombre, qui bascule, cristalline, nuit lumineuse et cristalline, qui bascule, lieu invisible pourtant, presque indicible, d’où émerge l’image de ces parois de verre miroitantes à n’en plus finir, miroitantes à n’en plus finir, fragile château de verre sans aucune
Image
Où seuls les reflets se reflètent,
A l’infini ou
à en perdre la
raison)
On dirait que quelque chose
S’est produit,
Est revenu, oui,
Revenu
Revenu de plus loin encore, (mais d’où ? Où ? Où seulement se répète l’écho des lieux)
Quelque chose d’un lointain sommeil réveillant un autre sommeil
Sommeil à l’intérieur d’un sommeil lourd, presque figé
Oui, on dirait que quelque chose (de si longtemps éteint, ou étouffé)
S’est réveillé,
A fait
signe
//déplaçant à peine une frontière de soi
à soi, mais suffisamment pour que
quelque chose
imperceptiblement
s’émeuve
D’un sommeil presque inaccessible ou
Dangereux
Là où le corps commence généralement
A se
tordre
Quelque chose, pourtant, sans que l’on sache quoi
Exactement/. Quelque chose d’un lieu vide, ou écho vague d’un « non-lieu » ? Echo de
ce qui a toujours manqué, n’a pas eu lieu
N’a pas
Eté. Eté. Eté.
Non
Lieu
D’un lieu en soi, qu’on ne soupçonnait peut-être
Même
Pas
Et qui pourtant n’en finit plus désormais d’égrener des
Perles
De
Vie
Ou d’Eros
Dans le jour, la nuit aussi. A peine plus perceptible que le très léger mouvement d’un corps
Endormi, rêvant …à quoi ?
La fin d’un rêve, peut-être
La fin d’un rêve de rêve
De mort, oui, c’est comme se sortir au réveil du rêve d’un rêve qui ne nous
appartient pas
Totalement, et convenir que celui-ci
Semble
Aboli (et de nouveau l’espace est rempli de vibrations, de sons, de sens)
Aboli, (évanoui plutôt qu’effacé,
Aboli, abolissant presque par
Hasard
Tout sentiment de
Vanité, leurre du
Rêve, d’un rêve
De mort
- Qui ne lui appartenait pas tout à fait
et où régnait
Un espace de terreur
intérieure presque sans
Limites, presque
Sans
Submersions
Possibles
Sans possible
Subversion
Lieu non lieu//de toutes les érosions//Possibles//De toutes les brûlures//Incandescentes
Et dérisoires,
Incandescences (ou bien, rien
Le vide, vide)
On dirait que quelque chose s’est produit réinventant
Le jour, ou bien rendant incontestablement le jour
A la nuit
Là où depuis si longtemps la nuit se tenait retenue par
Le jour
Coite et prisonnière, sans plus de
Respiration (et ces images de corps attaqués à coups de becs
d’oiseaux, ces images crues et violentes où les corps étaient si
violemment attaqués et déchirés, les chairs dévorées ou brûlées,
images elles-mêmes dévorantes, comme vouées à disparaître,
surgissant pourtant de nulle part, avant ou après l’effacement de
la possibilité même
Des images, ne pouvant auparavant être
Retenues (la mémoire, non, ne voulait pas, rien en soi, voulait,
ne pouvait
Supporter cela), ou ne serait-ce qu’avouées, ou vues…et qui
filaient dans le fatras de ce qui/file (lc corps qui dort, et se tord)
Images alors vouées à disparaître (comme à retenir ce qui d’Eros…ne pouvait
Vivre ? )
Et assombrissaient
Le jour
Mais commencer à distinguer, à
Reconnaître, ce qui pourtant
Commençait à se
Figer
Et commencer à
imaginer
Ce qui ne cesse de filer, Ne cesse de filer//la nuit, ce qui ne cesse de
tisser
Ne cesse de tisser, figée, une
nuit et/ou l’image d’une
nuit
de plus en plus
oppressante,
Qui ne cesse de tisser le vide qui emprisonne, dans ce lieu
Non
Lieu
Ce lieu qui n’existe que
De ne pas
Exister
Sommeil dans le sommeil
Là où quelque chose
Précisément là où
Quelque chose
Vient de
bouger, émouvoir, s’émouvoir, changer (ainsi faut-il parfois imaginer le
long processus de transformation, métamorphose, du corps et de la chair
dans ce lent
Sommeil, le fil qu’il faut tirer d’un amas de fils et autres lieux
Dans le
Sommeil
Du sommeil
Où je ne dors
plus)
Mais où commencent
A apparaître
Des signes, et encore
Imaginer grâce aux instants peut-être, ou moments où
En
Ce lieu
Vide de tout lieu
Vide
Se sont posés
Des regards
Presque à l’insu
De//
Soi
///
Donnant forme
Ou existence
A ce
non
Lieu
Lieu
Là où le vide
Envahissait
Les
Corps
Devenus presque
Pierres
Là où les mots résonnaient presque
Pierres
Et enfin dans le ciel,
ces battements d’ailes, ou les oiseaux de nuit aux becs aiguisés devenus
Doux,
chassant eux-mêmes les rêves de mort les plus
ancrés,
les plus
brûlants (de ceux qui brûlent le corps à l’intérieur
Du
Corps
Dans le
non
Lieu
Non
Vide
//les plus brûlants
Ceux qui dévastent, tourmentent et font se tordre les corps de (presque) pierre brûlants de
fièvre, lorsque la bouche asséchée de mots ne peut plus boire l’eau qui voudrait dire, redire
encore, prononcer, et se perd
dans les méandres du sommeil
du
sommeil
Pour finalement se réveiller de ce sommeil
(presque) létal pour,
dans le sommeil même
Retrouver un Désir d’être
Au plus profond
De Soi
Se tenir là, devant soi, s’apercevoir
Que le corps
Tient,
Vit,
Dans la légère
Et précise
Incidence
D’un regard