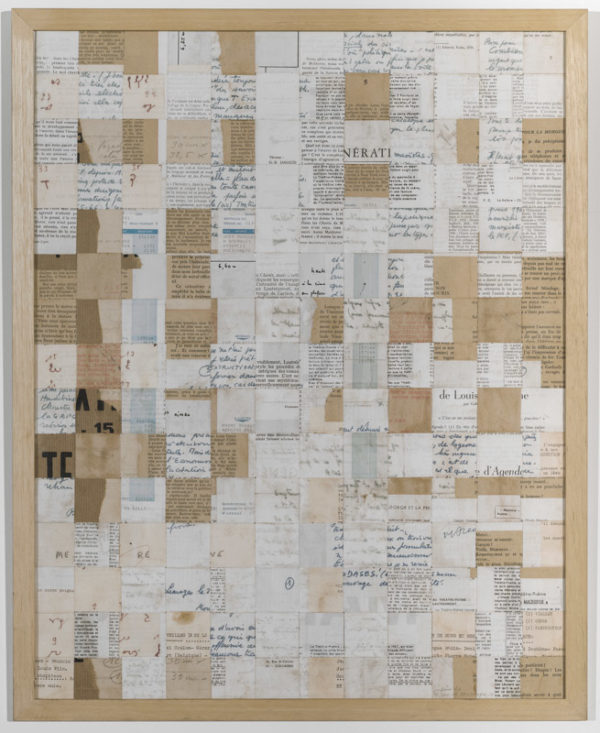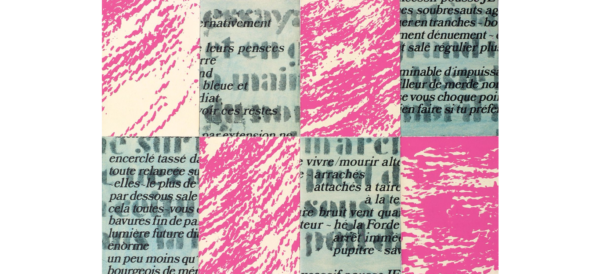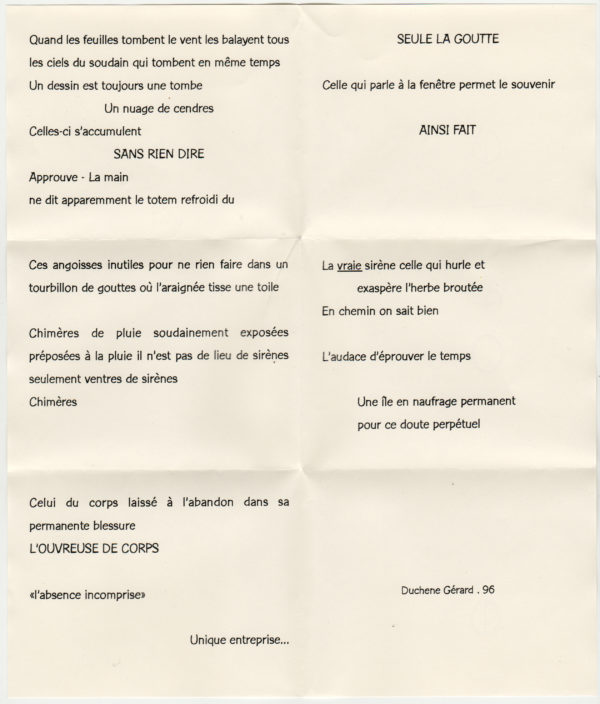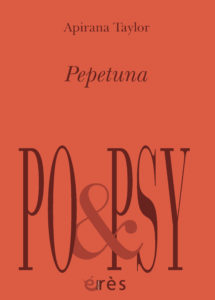Claude Tasserit, A l’essai
Les casernes vidées de leurs soldats vont-elles devenir des centres d’un genre inconnu, destinées à accueillir toujours plus de monde, de tout âge et de tout horizon ?
Cette interrogation de Claude Tasserit à la fin de son récit A l’essai exprime la grande énigme qui le traverse de part en part.
Tout commence, si tant est qu’il y ait ici un tout à entrevoir, par un interminable voyage en train puis en car dans une campagne aux paysages indéfinis, dont les noms des villages sont quasiment effacés sur les panneaux indicateurs.
Une telle imprécision du décor, existe-t-il seulement, fait de Clément Richaume un personnage imprécis. La seule chose que l’on puisse affirmer est qu’il réside dans un centre de formation et d’insertion.
Au terme de son voyage, un accompagnateur taiseux le conduit à une maison près d’un cimetière et lui dit d’attendre dans la cour cependant qu’il s’entretient avec la personne qui est peut-être le maître des lieux. Cela fait, il enjoint à Clément de s’installer dans une remise près d’une grange et s’en retourne sans la moindre explication.

Claude Tasserit, A l’essai, Cheyne éditeur, collection Grands fonds, 23 €.
Voilà un début de stage, (en supposant que le mot stage convienne exactement), qui ne manquera pas d’intriguer le lecteur d’autant que, explorant l’endroit où il va vivre, Clément découvre une espèce de tunnel à l’intérieur d’un mur et qu’un incendie embrase la grange d’un seul coup.
Puis il rencontre un certain Damien presque surgi de nulle part et l’aide à des travaux de nettoyage. Mais le mystère s’épaissit quand apparaissent un étrange médecin et une cuisinière très évasive. Les deux semblent en savoir plus sur Clément que Clément lui-même car ils ont lu son dossier…
Au gré des éléments délivrés au compte-goutte sur l’organisation de la maison et la vie au café-épicerie du village, le lecteur comprend qu’il met le pied dans un univers kafkaïen au sens rigoureux du terme. Le stagiaire apercevra-t-il seulement son employeur qui vit reclus à l’étage ? Pourquoi la lettre qu’il reçoit enfin de lui, avec des instructions précises pourtant, ne dissout-elle pas totalement son malaise ? C’est que, peut-être, l’existence même de Clément est un malaise. Un malaise mal entendu.
Les souvenirs de sa vie au centre de formation, très clairs quant aux menus travers du quotidien, ne disent rien des circonstances qui l’y ont mené. Si au moins, Clément pouvait consulter son dossier ! Tout est dedans probablement ! Mais de quel tout, encore, s’agit-il ? Oh ! bien sûr, doivent y figurer des rapports de médecins, de psychiatres, d’ergothérapeutes, d’infirmiers même, et le directeur aura aussi griffonné quelques mots. Qui ne diront pas plus qui est Clément et ce qu’il a fait (ou pas fait) pour être envoyé dans ce centre.
« Il paraît que la génération qui nous a précédés était autrement plus débrouillarde, et d’une résistance que nous aurions peine à imaginer. D’ailleurs, les stages d’insertion n’étaient pas fréquents, peut-être même n’existaient-ils pas. Ils se sont développés à cause de notre incompétence, de notre mollesse, de tous nos défauts. », écrit Claude Tasserit.
Clément fait son autocritique à la façon d’un prisonnier dans un camp de travail en Chine. Il pourrait devenir paranoïaque car, comme dans Le procès de Kafka, il courbe l’échine sous le joug d’un « atermoiement illimité ». Ni coupable, ni innocent donc ! Comment accomplir une peine, si c’en est une, dont on ne sait pas quand elle a commencé ni quand elle finira ? Quels défauts d’incompétence sont vraiment reprochés aux stagiaires ?
Une chose est certaine cependant. En faisant de Clément un individu condamné à l’essai perpétuel, Claude Tasserit nous offre un livre politique et philosophique. On pense au travailleur enchaîné à ses contrats courts pour nourrir un système économique absurde et totalitaire. Plus largement, cette écriture tout en retenue sans être sèche nous signifie que la vie n’est jamais rien d’autre qu’un essai. On s’y appartient mal. On bricole dans les espaces qui nous sont assignés comme dans les souvenirs déjà gagnés par le flou. De toute façon, comme dit Clément à la fin de son expérience : « cela ne me gêne pas d’attendre. Je ne suis pas pressé. »
Il y a encore beaucoup de casernes à remplir. Il y a encore beaucoup d’humains inadaptés à occuper. Et leur résignation est sans limite.