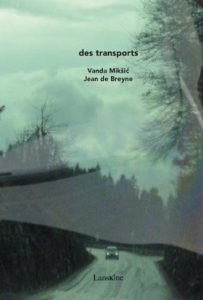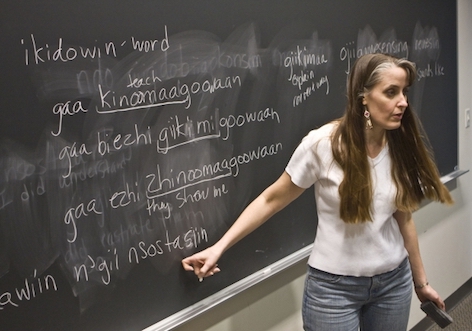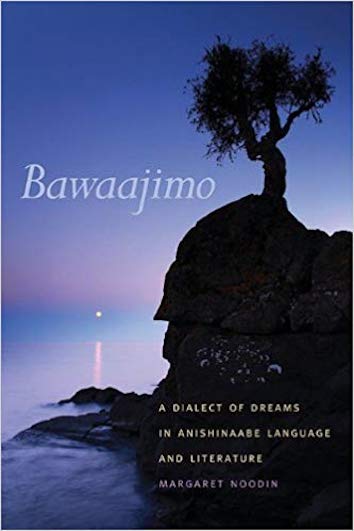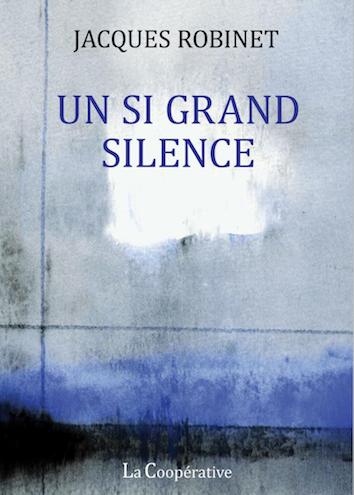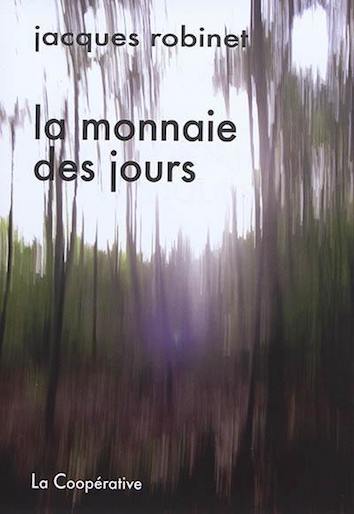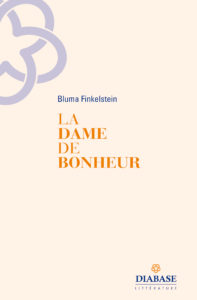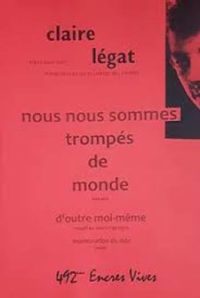Maïakovski, Un nuage en pantalon
Figure emblématique du modernisme russe dont la créativité croise la révolution de 1917, Vladimir Vladimirovitch Maïakovski mourut à 37 ans le 14 avril 1930, en se tirant une balle dans la poitrine.
Son introduction à un poème des derniers mois de sa vie, « À pleine voix », se veut une adresse directe à la postérité semblant boucler la portée de son écrit initial de 1914 à l'occasion d'une tournée du mouvement futuriste à Odessa intitulé « Un nuage en pantalon » : « Honorés / camarades de demain ! / Grouillant / dans la m... fossile / de notre temps, / étudiant les ténèbres de nos jours, / peut-être / chercherez-vous / qui je fus. »
Ce souci de s'exposer dans sa vérité, en porteur du verbe jusqu'à son incandescence, travaille déjà l'écriture de sa tétralogie alors qu'il rencontre Maria Denissova. Prescience de son propre malheur, tragédie futuriste, par son expérience des maux traversés et sa profusion des mots jetés en pâture, dans une recherche avant-gardiste des formes nouvelles, tournant le dos tant aux clichés du poétique qu'à un lyrisme trop conventionnel, ce poème premier témoigne d'un monde intérieur tourmenté, accouchant ses monstres et ses chimères, et habité par la ferme volonté de rénover le langage poétique...
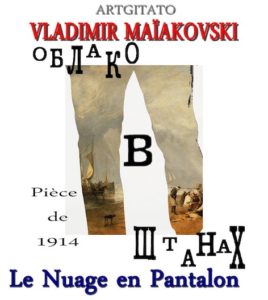
Maïakovski, Un nuage en pantalon, traduit par Elena Bagno et Valentina Chepiga, Vibration Éditions.
Comme le suggère Elena Truuts, dans sa préface à la nouvelle traduction de ce texte majeur par Elena Bagno et Valentina Chepiga, c'est à se demander si derrière quelques vers visionnaires ne se cache l'intuition de la fin tragique de leur créateur ? « Et quand le nombre de mes années / aura achevé son ère - / des millions de gouttes de sang joncheront l'allée / vers la maison de mon père. » Mais si la destinée demeure funeste quel éclat avait le feu poétique qui embrasait son cœur ! Avec un goût prononcé pour la provocation, l'ardent jeune homme s'y dépeint en Christ moderne ou en « treizième apôtre », titre alors envisagé, prompt à bousculer les facilités de pensée et l'avachissement des habitudes de ses contemporains, pour mieux leur opposer son chemin, mêlant dans une même écriture agit-prop et mysticisme, ce qui décloisonne le regard rétrospectif porté sur cette œuvre singulière du XX ème siècle qui ne saurait se réduire à un simple endoctrinement communiste...
Vladimir Maïakovsky, Un nuage en pantalon, prologue.
Dès les premiers vers, le choix des traductrices de donner une forme versifiée restitue par son art de la rime la vigueur de la musicalité et l'audace du ton adoptés par le jeune chantre d'une Marie, figure où l'on retrouve tant la rencontre amoureuse de Maria Denissova que la divine Vierge ou la sensuelle Marie Madeleine, et reproduit avec justesse le choc du regard de l'écrivain avec le conformisme de son temps, ainsi du « cerveau ramolli » exprimant un « cœur démoli » à l'image de celui, desséché, de certains hommes de son époque, ainsi que de l'objectivité bourgeoise et clinquante du « canapé luisant » à laquelle répond son rire « insolent » : « Votre pensée / qui rêvasse sur un cerveau ramolli, / comme un laquais aux chairs flasques sur son canapé luisant, / je la taquinerai avec un lambeau de cœur démoli ; / à satiété je me moquerai, caustique et insolent. »
Vladimir Maïakovski, Adolescent.
Par le mordant de son trait d'esprit, le jeune insurgé paraît ainsi répondre d'emblée à la question-reproche que la censure adressa à ce dernier en 1915, après avoir supprimé six pages et rejeté le titre premier « Le treizième apôtre » : « Comment avez-vous pu unir le lyrisme à la grossièreté ? » Par son goût des contrastes, par sa manière provocatrice, le poète russe a su donner à entendre un lyrisme nouveau, celui de la dissonance aux extravagances déroutantes... C'est cette dimension essentielle de sa poésie que Valentina Chepiga et Elena Bagno ont rendu avec brio par leur travail minutieux ! En effet, la longueur des vers, le choix des assonances et autres échos sonores illustrent à merveille la poétique de cet auteur « à pleine voix » ! Et qui se livre à l'exercice de déclamer à voix haute la traduction nouvelle, retrouvera, pour reprendre les formules de l'avant-propos de Florian Voutev, à la fois « résonance harmonieuse » et « entrechoquement brutal »...
Vladimir Maïakovski, Ecoutez, lecture du poème en russe et en français, par Anna Gichkina.
Ainsi en est-il, par exemple, de l'avant-dernier couplet du prologue, qui explicite le titre de cette déchirante et néanmoins revigorante tétralogie, charge critique avec la docilité désormais attendue de tout un chacun astreint au miroir des apparences et des convenances : « Voulez-vous / que je sois de viande fou - / et comme un ciel qui change de tons - / voulez-vous / que je sois impeccablement doux, / pas un homme, mais – un nuage en pantalon ! ».
Vladimir Maïakovski, Le Poète est un ouvrier.