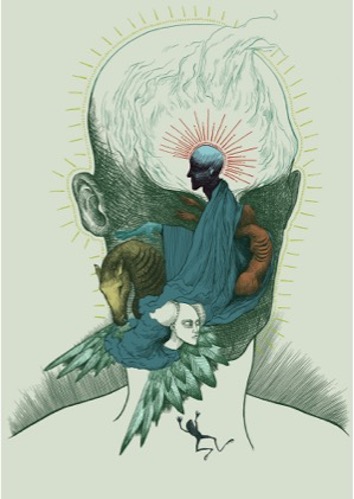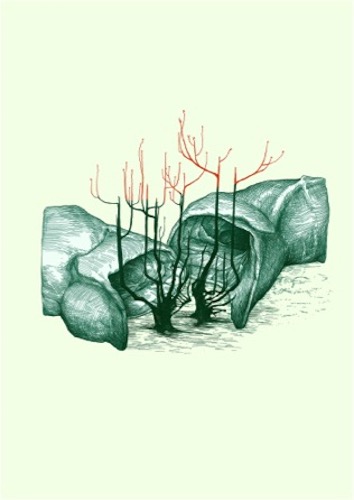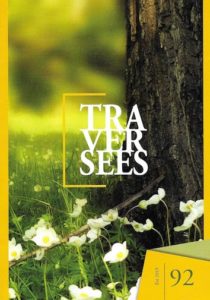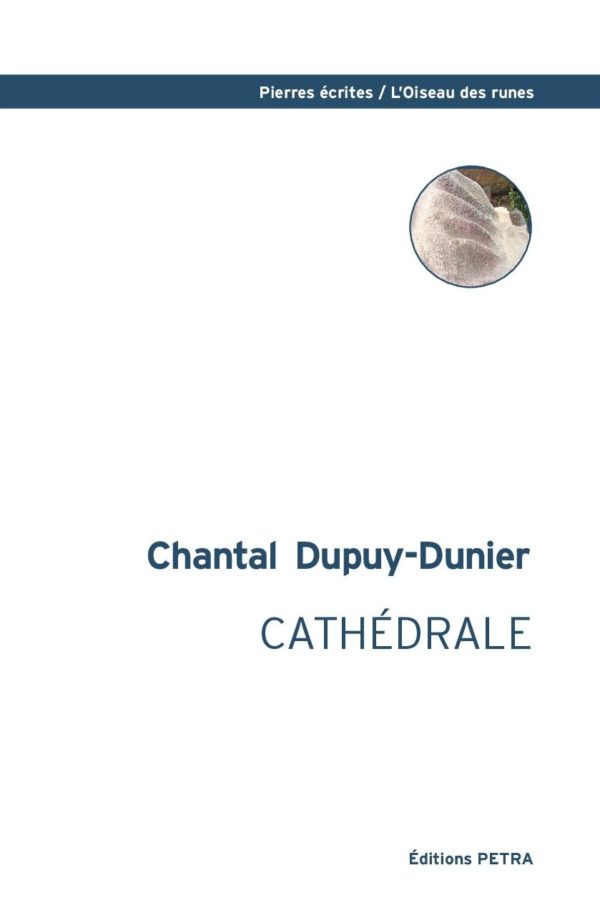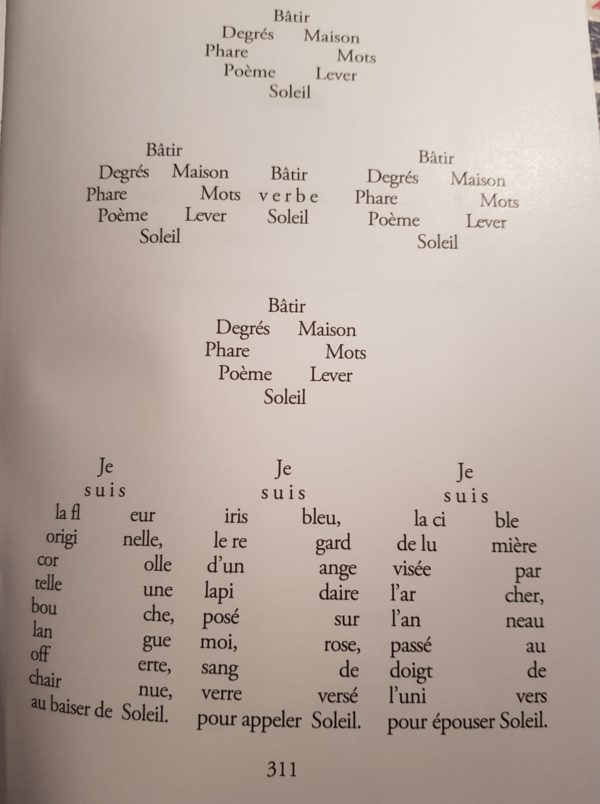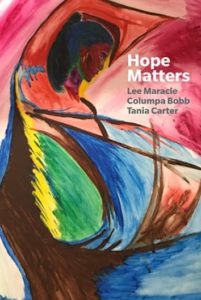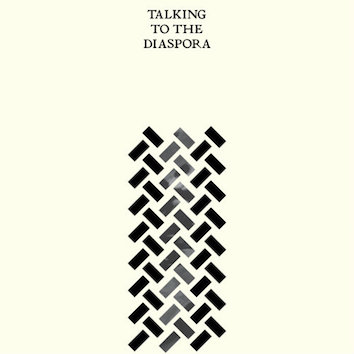Thierry Radière, Tercets du dimanche
Quel meilleur jour qu’un dimanche pour écrire la notule d’un livre sur les dimanches ?! Un livre autour des dimanches. Où les dimanches sont tout à la fois le sujet et son complément, l’histoire et la géographie, souvenir et présent.
Les premiers dimanches, ceux de l’enfance, cette sorte de routine, entraînante, lancinante, parfois doucereuse, souvent proche d’une anesthésie générale, le monde comme en sommeil, pire encore dans le coma, ou plus prosaïquement sur pause. Hormis l’enfant. L’enfant qui, seul, s’agite, s’excite, joue, rêve, court, crie. L’enfant qui, malgré son envie de normalité, de rythme habituel, éprouve lui aussi cet étrange sentiment de distanciation – dimanche n’a rien de commun avec les autres jours ; dimanche est une parenthèse, des pointillés. L’enfant est un capteur à évidences non exprimées.
Ce n’est pas tous les jours
que dès dix heures du matin
le garçonnet sent que rien ne changera.
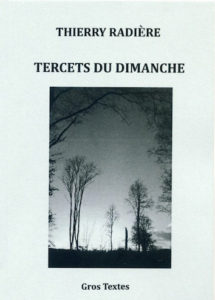
Thierry Radière, Tercets du dimanche, Gros Textes, 6€.
Car c’est ainsi que les choses avancent, le dimanche, sans avancer. L’immobilité suit sa route, et l’énergie courbe l’échine, un peu, très peu. Si les adultes semblent flotter dans une sorte d’air ouaté, le monde, la vie, l’existence perdure malgré tout. Et l’enfant ne le sait que trop, qui s’en réjouit, sait aller vers qui il faut, pour trouver le bon compagnon, la bonne compagne, afin de rester lui-même, ne pas se perdre dans la morosité d’un statu quo non désiré.
Dans un coin de la maison
où le temps s’est arrêté
l’enfant parle à une araignée.
Tout lui semble lent, mou, à l’enfant qui se véhicule entre les heures creuses, plates, à la recherche de cette folie douce hebdomadaire qu’il chérit tant. Les parents, les grands-parents s’affairent, s’activent, pourtant, mais dans le repli d’eux-mêmes, l’acidité de l’intimité, la bile d’hiers, comme si les dimanches avaient la vertu non pas d’une eau de jouvence, mais se rapprochaient d’une machine à remonter le temps – avec l’aigreur, la peine, le mal discret en besace.
Jouer au quatre vingt-et-un dans le salon
en compagnie de ses enfants dès le matin
le transportait en Algérie pendant la guerre.
On s’occupe, alors, on fait ceci ou cela, on tâche d’éloigner cette couverture de vide qui ne nous tient pas chaud, nous refroidit même.
La voiture rouge en bas
lavée tout à l’heure
est un clin d’œil au garçon penché au balcon.
Parce qu’on a une idée en tête, une idée que tout le monde devine, sait. Dimanche n’est pas un jour comme les autres, on se doit d’y vivre quelque chose qui, donc, ne ressemble en rien à ce qu’on vivrait dans la semaine. On le sait, l’enfant le sait, les adultes le préparent. Et c’est le départ, la route, l’ailleurs.
La baignade dans le lac
était attendue avec le pique-nique
au bout du monde.
L’ailleurs, oui… Mais l’ailleurs se trouve partout, le dimanche. Qu’il fasse beau ou non, été comme hiver, on est toujours en partance, le dimanche, ce voyage vers soi, vers les Autres, ses autres. Chez soi est le véhicule de ces déplacements.
C’est un jour
où même chez soi
on se sent ailleurs.
Extrait de Attendre que la mer monte, Dre Thérry Radière, lu par Jérôme Rousselet.