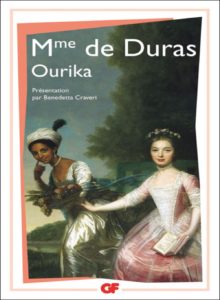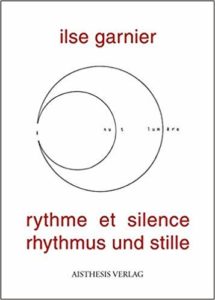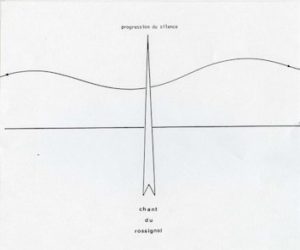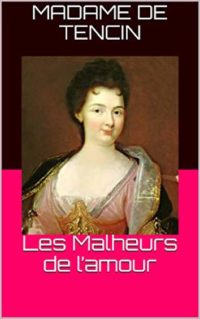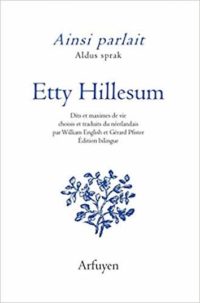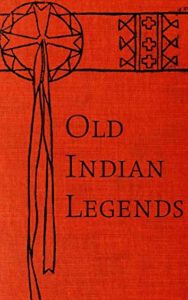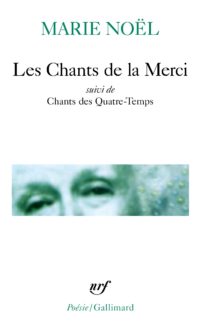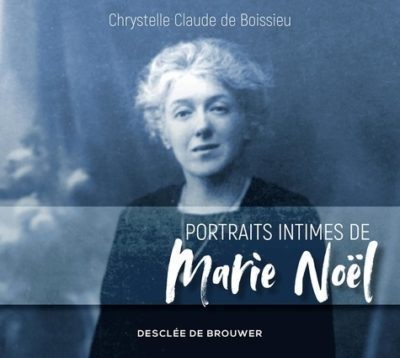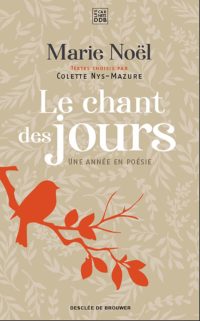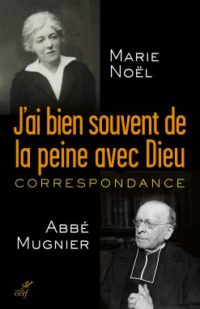Yona Wallach, Poèmes
Traduits de l’hébreu moderne par Virginie Genest et Amotz Giladi
La biche monstrueuse
Et tous les oiseaux étaient dans mon jardin
Et tous les animaux étaient dans mon jardin
Et tous chantaient l’amertume de mon amour
Et la biche chantait plus merveilleusement que tous les autres
Et le chant de la biche était le chant de mon amour
Et tous les animaux se turent
Et les oiseaux cessèrent leur cri
Et la biche monta sur le toit de ma maison
Et me chanta le chant de mon amour
Mais dans chaque animal se trouve un monstre
Comme il y a quelque chose d’étrange dans chaque oiseau
Comme un monstre existe en chaque homme
Et la biche monstrueuse tournait autour du jardin
Et les oiseaux inclinaient leur tête au chant de la biche
Et les animaux sommeillaient au chant de la biche
Et j’étais comme si je n’étais pas quand la biche chantait
En ce doux moment elle a brisé mon portail.
Et tous les animaux ont fui et les oiseaux se sont envolés
Et la biche est tombée du toit et s’est brisé le crâne
Et j’ai fui et dans le jardin de mon amour je renferme un monstre
Gorille noir et mauvais comme l’oubli.
Yona Wallach, Bande annonce officielle.
Yonatan
Je cours sur le pont
Et les enfants sont derrière moi
Yonatan
Yonatan ils m’appellent
Un peu de sang
Juste un peu de sang pour recouvrir le miel
Je suis d’accord pour une piqûre d’aiguille
Mais les enfants veulent
Et ce sont des enfants
Et je suis Yonatan
Ils coupent ma tête avec une branche
De glaïeul et ramassent ma tête
Avec deux branches de glaïeuls et enveloppent
ma tête dans un papier froissé
Yonatan
Yonatan ils disent
Vraiment, excuse nous
Nous ne savions pas que tu étais comme ça.
∗∗∗∗
Je n'aime plus vraiment avoir peur
Je jouais avec la peur
Comme avec un enfant
Je la secouais devant moi
Je la regardais
Et je l’appelais
Peur peur viens,
Je lisais
Les choses
Les plus effrayantes,
Je devenais accro à ces sensations
Comme si c’était la chose la plus importante
Et je le fais encore
La peur,
Les petites peurs ne m’intéressaient pas
Seule la grande peur
Emporte tout
Maintenant je n’aime plus vraiment avoir peur
Je me suis retrouvée assise
Et l’ai encore appelée dans un murmure
Comme dans ces jours-là
Peur peur viens
Viens jouer à la peur avec moi
J’ai pensé que c’était ce
Que je devais faire
Encore dans ces jours là
Avoir peur,
Je frémissais de peur
Voyais des choses terribles
Les entendais aussi
Ça a commencé un jour
J’ai découvert la peur
Et découvert d’autres choses
La folie par exemple
Mais c’est ailleurs
Sous une forme similaire
J’ai découvert les perceptions humaines
Après ça j’ai découvert le choc de l’interprétation
Des choses différentes j’ai comprises
Et j’en ai eu marre d’autres choses
Mais la peur était la dernière
J’ai marché dans de longs corridors
Toujours de longs corridors
De monastères hôpitaux
De bâtiments publics
Et je me suis dit
Que d’emblée toute cette peur et cette folie
Je pars j’en ai marre
Je n’aime plus vraiment avoir peur
Il est maintenant temps de récolter
Je récolte les fruits de la peur
Pour la plupart pourris
Je les regarde avec un sourire
Pas avec horreur
Et les rejette de ma vue
Je n’aime plus vraiment avoir peur.
Extrait du documentaire Les sept bobines de Yona Wallach.
La femme devient arbre
La femme devient arbre
Dont voici les deux mains les bras
Qui s’élèvent vers le ciel
Deux branches qui se séparent
De son corps
Du tronc de son corps reposant
Sur d’invisibles genoux
Elle est visible jusqu’aux genoux
Et ses cuisses sont
Les racines de la terre
Son ventre séduisant une cavité
Un creux dans son ventre le tronc
Ses cheveux abondants
De longues branches
Des rames
Voici que la femme devient
Un tronc antique
Elle est si belle
Et splendide
Je ne l’ai pas vue
Avant
Mais je savais
C’est la femme
Devenue tronc
Pas de feuilles vertes
Pas de signes de croissance
Tout est asséché depuis longtemps
Le beau visage est devenu bois
Tout est uniforme
Est-ce que tout cela est arrivé d’un coup
Sans déroulement
Ce qu’il n’est pas possible d’accomplir
Pour celui qui est vivant
Se produit instantanément en vision
Ce qui est possible se produit avant
La matérialisation après cela
Aucun intérêt
Car c’est seulement la sensation
Qui crée une telle image
Je sais bien de qui on parle.

![Mémoires_des_autres_5___[…]Comtesse_Dash_bpt6k96010277](https://www.recoursaupoeme.fr/wp-content/uploads/2020/02/memoires_des_autres_5___-comtesse_dash_bpt6k96010277-171x300.jpeg)