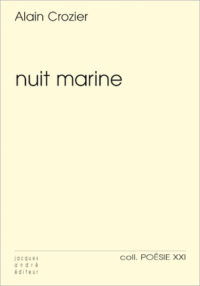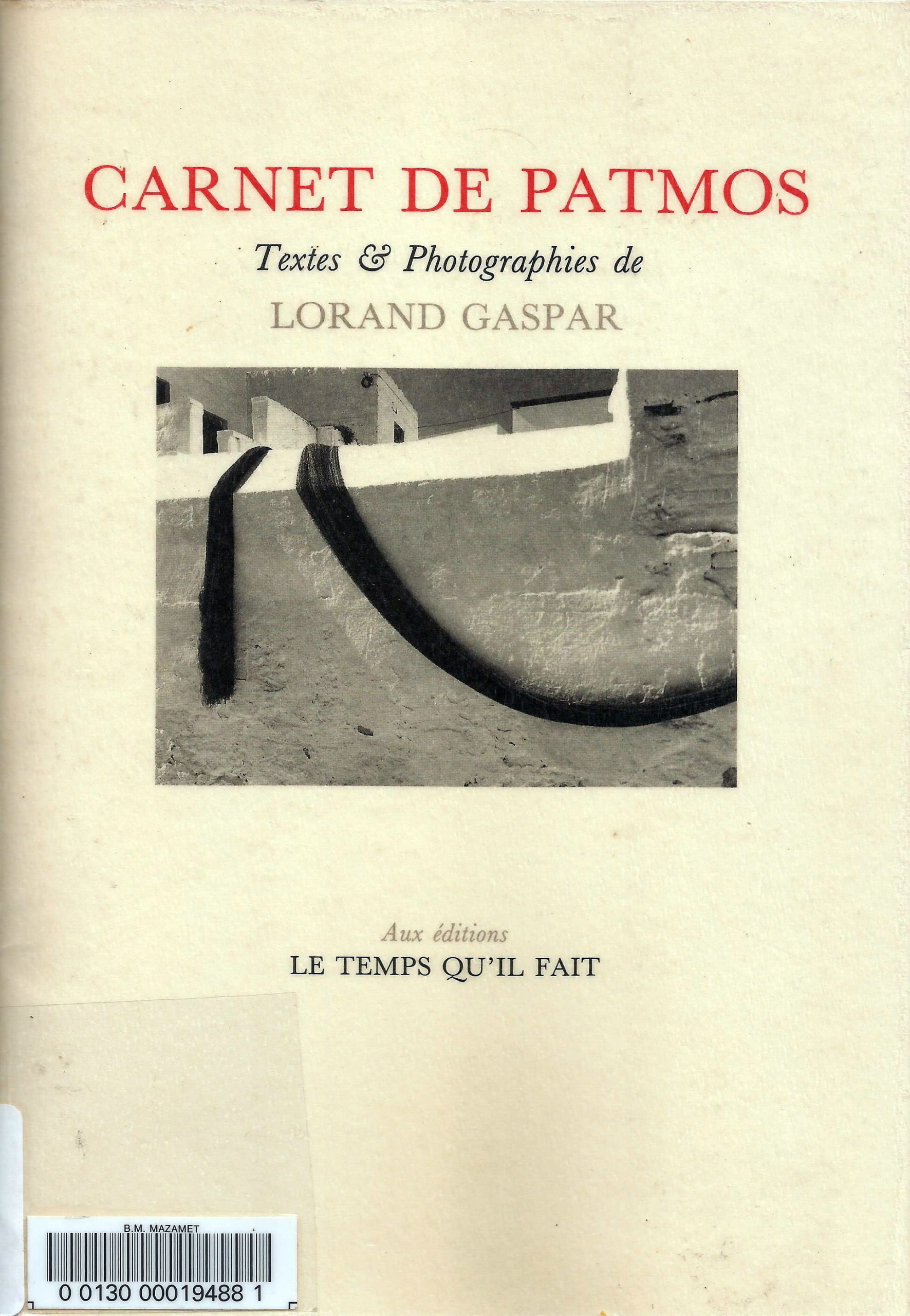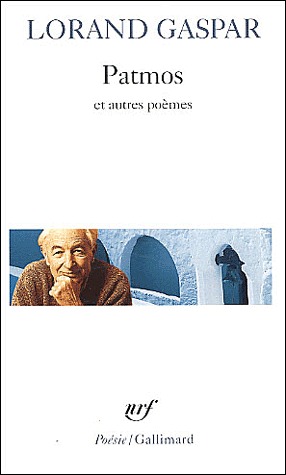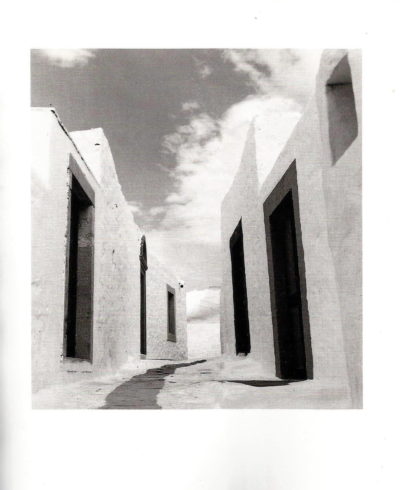Georges de Rivas, La beauté Eurydice, Sept Chants pour le Retour d’Eurydice
La Beauté Eurydice, un titre qui place le recueil sous les auspices d’un horizon d’attente dense, très dense et habité par toutes les mythologies, celles qui ont traversé le temps et se sont chargées des historicités jusqu’à cette histoire d’Orphée, et d’Eurydice. Alors comment le poète gère-t-il cette référence ?
Est-ce une évocation dans la littéralité de laquelle il va placer ses propos, s’agit-il d’une lecture moderne du mythe, ou bien de prendre le contre-pied de ces imagos ancestraux ? C’est tout à la fois, et c’est ceci qui confère à ce livre un caractère exceptionnel. Georges de Rivas en virtuose joue de toutes les partitions avec une aisance que n’égale que la beauté des poèmes qui constituent cet ensemble. Est-ce cacophonique, est-ce un mélange arbitraire d’éléments épars ? Loin de là ! Tout est agencé de manière à révéler la richesse des références convoquées, non seulement dans une lecture des paradigmes, mais aussi dans la juxtaposition des voyages et adaptations du mythe. Et puis, surtout, nous entendons, enfin, après des siècles de mutisme, la voix d'Eurydice.
Georges de Rivas écrit une prose poétique tout à fait remarquable. Elle sert un dialogue entre Orphée et Eurydice, et grâce à la fluidité de cette poésie tissée comme une dentelle translucide et coulant comme une source de montagne toute la douceur mais aussi toute la puissance de cette femme à qui enfin on donne la parole est là, offerte, dans l’émotion de cette langue superbe.

Georges de Rivas, La Beauté Eurydice, Sept Chants pour le Retour d'Eurydice, Editions Alcyone, collection Surya, 2019, 82 pages, 19 €.
L’immense palette des sentiments évoqués grâce à cette prose poétique et la finesse d’analyse servent une thématique pourtant objet de tant de recueil, de livre, de tentatives pour en tracer la magnificence : l’amour. La dédicace dit déjà ceci, ce cadeau d'aimer et d'être aimé/e : A ma muse, mon Eurydice retrouvée / Source d'eaux-vives d'où a jailli le fleuve / du poème aimanté par sa Présence-Absence. L'épigraphe d'œuvre souligne l'importance de ce sentiment, le plus haut qu'il nous soit donné de ressentir :
La beauté ne fait pas l'amour
C'est l'amour qui fait la beautéLev Tolstoï
Mais ici le poète parcourt toute l’étendue de ce sentiment. Il y a l’amour pour l’être élu de notre cœur, et il y a l’amour cosmique, au sens spirituel, celui qui fait que l’on ouvre son cœur et que l’on accueille chaque parcelle de ce qui advient avec un sourire lumineux. Ces deux polarités d'expression de l’amour, individuel et universel, sont ce qui guide le dialogue entre les deux figures mythologiques du récit. La palette des sentiments est explorée avec ce point de vue éminemment spirituel qui lie le particulier au tout.
Eurydice enfin s’exprime. Elle porte la parole révélatrice de toutes les dimensions qu’elle a côtoyées. Elle parle pour ouvrir à la profondeur du silence. Elle est créatrice, femme unique et multiple. Et elle sait, et elle guide. Un paysage cosmique se révèle, une toile pure tissée par le regard spéculaire de l’homme sur sa condition d’être là, en vie, et sur les raisons de nos existences, aimer, bien sûr.
Ce long chant est aussi discours sur la poésie, chant sur le chant, et redécouverte d'un lyrisme revisité par la beauté de chaque mot déposé en juste place comme une pierre précieuse sur le diadème de la littérature. Eurydice est cette femme muse et enchanteresse, elle est la poésie, aussi...
Orphée
Je vous ai reconnue, promesse et présence de la poésie
Cœur rayonnant de ce soleil dans la nuit
Et comme l'âme infinie
Ô beauté rue à ce seuil voilée sous l'arche des nuées
Mon cœur foudroyé sur ce duel instant vous a aimée !
Puissance de ceci, le mythe. Prégnance des universaux qu’il déploie. Et comme il est encore difficile d’en appeler à ces références qui demandent une croyance autre qu’en celle d’une immanence absolue d’exister. Encore faut-il croire en ce socle des humanités, faut-il y voir l’espace d’une communion possible. Loin bien sûr de toute obédience, encore faut-il désirer interroger les représentations qui à notre époque fleurissent partout, sur tous les écrans. Celui de notre imaginaire aura tout intérêt à fréquenter La beauté Eurydice, car la richesse et l’épaisseur sémantique du mythe, donc de l’humanité, y sont offertes, données à voir, à comprendre et à ressentir dans toute la puissance des émotions à jamais présentes dans la poésie qui ici révèle l'immanence de ces socles universaux présents dans chacune de nos respirations.