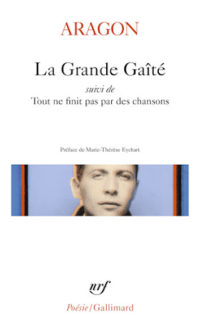Rutger Kopland, Cette vue
La collection de poésie Po&psy, publiée par les éditions Erès et dirigée par Danièle Faugeras, propose de faire découvrir des poésies du monde peu connues du public français car pas ou peu traduites jusque-là.
Les textes édités sont présentés dans leur langue d’origine, avec la traduction française en regard. Les recueils sont également illustrés par un artiste, peintre ou dessinateur.
Les auteurs retenus peuvent être de nationalités très diverses. Ainsi, j’ai reçu trois recueils de la collection, l’un de Lucian Blaga, traduit du roumain, l’autre d’Apirana Taylor, poète maori, et enfin le dernier de Rutger Kopland, traduit du néerlandais.
J’ai choisi de vous présenter le recueil de Rutger Kopland, « Cette vue », car il me semble être étrangement en résonance avec la situation que nous vivons actuellement, contraints de rester chez nous, de ne pas sortir.
Rutger Kopland est donc un auteur néerlandais (1934-2012). Deux sélections de ses poèmes ont déjà été publiées chez Gallimard dans la traduction de Paul Gellings : « Songer à partir » (1986) et « Souvenirs de l’inconnu » (1998).

Rutger Kopland : Cette vue. Traduit du
néerlandais par Jan H. Mysjkin et Pierre
Gallissaires. Dessins de Jean-Pierre Dupont.
Collection Po&psy. Erès, 2019
Le poète évoque un certain état d’être, une vue qu’il pourrait avoir depuis sa fenêtre, sans bouger.
Supposons que nous puissions rester ici –
mais cette vue par-delà les montagnes
est trop lointaine, trop définitive
pour être supportée, bien que
placés dans cette attitude, en
montagne mués,
nous puissions rester couchés,
aussi fortuits que tous les autres.
Etrange prémonition que ces vers écrits il y a plusieurs années de cela : Rutger Kopland dit « nous », un « nous » général. « Nous » sommes « couchés ici » comme elles (les montagnes), immobiles, statiques.
Immobiles, statiques, et, « maintenant que nous nous savons perdus / il nous reste seulement ce lieu ». « Sans colère, sans regret », « nous avons abandonné les cartes ».
Et aujourd’hui, au moment où je rédige ces lignes, nous sommes, chacun chez nous, privés de nouveaux horizons ; il nous faut accepter de lâcher prise, « sans colère, sans regret », de ne plus chercher à nous échapper, ailleurs, toujours ailleurs. Il nous faut accepter d’être dans l’ici et maintenant, et de nous nourrir de ces minuscules riens que, d’habitude, nous ne voyons pas : bruissements, odeurs, détails et manifestations subtils du quotidien. Alors, nos pleurs « ne sont pas des pleurs, mais / pluie et peau ».
Rutger Kopland écrit sur une certaine façon d’être au monde, une qualité d’être ; présence attentive aux manifestations du vivant, de la nature, à ce qui surgit, dans l’imperceptible.
Si tu vois ce qui reste, tu suis
un oiseau, comment il plane, un moment
voltige, tombe, bat des ailes,
retrouve le vent et
monte, monte,
même pas le point dans l’air
par lequel il a disparu.
Dans la dernière partie de son recueil, le poète interroge la permanence dans le mouvement. Ainsi, la rivière, toujours en mouvement, est aussi statique, car son flux s’écoule sans discontinuer. Elle ne se déplace pas, son flux est continu ; elle s’écoule, tantôt agitée, tantôt calme, et pourtant, elle n’a pas de destination, pas d’objectif. Elle coule pour couler, elle est le mouvement.
Matin au bord de la rivière,
matin où enfin
elle ne sera rien de plus
que la rivière.