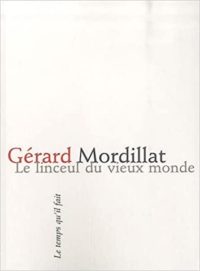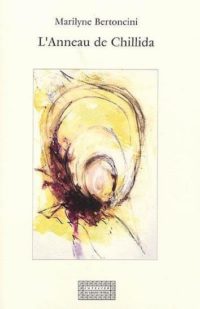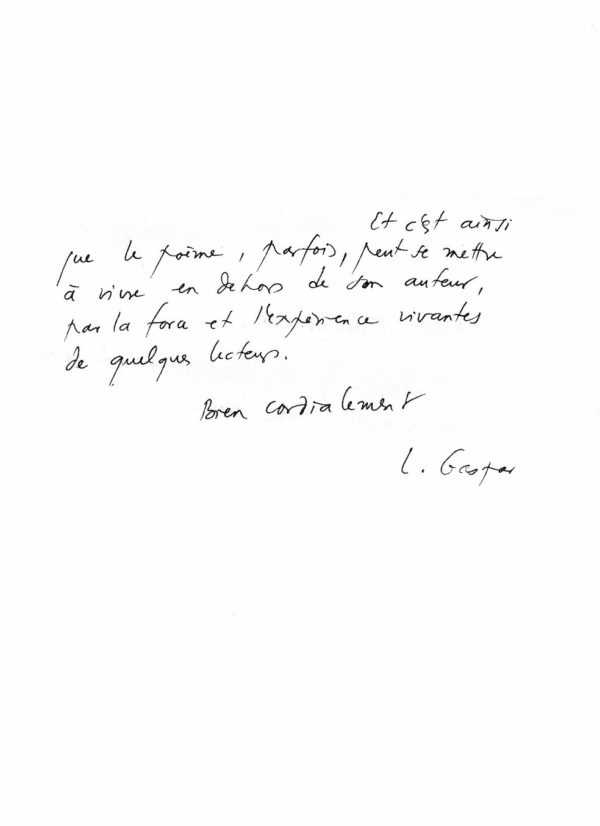Alain Brissiaud, 1000 retours
pour ma fille Marie
Maintenant sur la voie rapide
revenant vers la ville
l’auto s’enfonce dans la mémoire et remonte le temps
Mère courage si lointaine maintenant là gisante cassée
ta vie ne pèse plus bien lourd
nos mains enlacées voudraient tout retenir
juste ça
filer libres
souviens-toi quand tu chantais
ciel ouvert vers les hauts bâtiments et
le rire de jeunes femmes
comme un écho à ton souffle
mille malheurs
l’espace est saturé de non sens
vie heurtée
vie contre vie à tout donner
je me tourne vers le mur
au- delà des vitres le ciel est plein de ta voix
ton chevet jaune reflets bleutés agitation sursauts rides maigreur
Mère tu dors dans l’avant mort
légèrement de biais lèvres closes et râles
allant et venant dans la chambre
depuis ce monde je te regarde
ancienne jeune femme me donnant la vie
jaillissant d’entre tes cuisses
pour quel avenir pourquoi
dis
quand ton premier frisson
quel timide jeune amoureux
posant un baiser sur ta bouche
déjà ce père unique amour
et plus tard débâcle captivité
le père prisonnier solitude enfants malades
je suis en toi ce soir pour tout voir de ce temps
j’ai voulu connaître où il était
mettre mes pas dans les siens
comprendre ma propre vie
comprendre Mère par ta souffrance pour me comprendre
par ce père figé comme un dimanche
pouvoir me dire « ça va »
partir vers le pont de la photo à sa rencontre
comme il devait aller vers toi
depuis l’autre coté de la ville le dimanche matin
mains d’amoureux doigts serrés
peut-être des caresses sur ta peau
fantômes tardifs
et si vite père malade retour du corps à la maison
dans le sillage de l’ambulance je refais le compte
je m’épuise à comprendre votre histoire
ton courage sous la peine
que penser
chemin d’Allemagne encore
descendant vers le pré dans la lumière finissante
cherchant ses pas dans les beaux paysages
Sylvie aide-moi
je dissimule mon émotion
tout retenir pour comprendre*
kommando captivité votre séparation
Bavière air bucolique maisons jolies
le pont métallique de la photo soudain devant moi
bouffées manque d’air je perce soudain tes silences
vague sourire droit digne propre
même allure rare maintenant
si loin il disait
« ne fréquente pas ma sœur » il voulait par delà la distance diriger ta vie
sans rien savoir de tes souffrances
mort des parents traîner Jean à l’hôpital passer la ligne
à son retour tu reprends ta place
en arrière
effacement ta force être une ombre
juste te rendre indispensable
provoquer l’amour
s’attacher l’amour
soudain tu hurles
« maman ! maman ! » son souvenir t’assaille
tes bras tournent sur ta tête
tu appelles depuis l’abîme
« maman ! maman ! »
son absence résonne dans la pénombre
elle te manque tu as peur
perdue si tôt
véritable souffrance tu en parles comme on caresse
que t’aurait-elle donné
tu es partie si vite t’occuper des autres
fille enfant fille maîtresse
je t’imagine gamine
à quoi rêvais-tu
et jeune femme aimais-tu ton corps
et plus tard quelles caresses sur ton ventre
nous n’avons pas parlé rien dit de ces choses
ta jeunesse vendue pour servir les bourgeois
et Jésus bel amant au-dessus de tout
tu appelles ta mère
tu voudrais cloisonner ton esprit
mais avancer c’est se perdre
je suis las de tant d’échecs je n’ai rien compris à ta vie
je touche ton front
je touche ta joue : « ma peau se dessèche »
« pense à ramener la crème »
« qui est là »
étrange ces présences qui volent atour de toi
quelle est cette réalité
ce soir mes pensées cavalent
et puis la mort de Claude dans le journal
si soudaine
je n’ai rien compris
cris d’homme maintenant : « arrêtez-ça arrêtez-ça »
voix tendues
la souffrance toute entière dans ces cris
quel ancien cruel remord
quel drame enfoui
cette folie inonde l’espace de sombres pressentiments
nos rapports se sont détraqués
comment construire nos vies
trouverais-je la paix dans toute cette démence
revenant du pont vers l’hôtel faussement touriste
mon cœur déchiré
incapable à dire mon désarroi
comportement déflagration
mon esprit s’enraye cette nuit
Sylvie je voulais tant m’ouvrir
couler en toi
apaisé
douloureux d’amour
vers ton ventre m’écouler
mais souillures de ma vie
Mère tu disais
« vas là-bas - je suis usée - tu bouges trop - hors de moi »
maintenant je m’accroche
je jouis de ton usure
reprends-moi reprends-moi
ne me laisse plus
me souvenir de ces nuits de dortoir
le grand me touche sous le drap
le grand me guette dans l’ombre vers le fond attend l’occasion
mettre son sexe dans ma main
par gentillesse disait-il
m’offrir ses névroses
lui aussi manque d’amour
mère pouvais-tu imaginer
et toi père absent que je cherche maintenant
vers la fin tu guettais ses allers et venus vers l’atelier
« Alain - il prend du vin »
« Alain - sors de moi »
<
« Alain - tu vois mon ventre dans le bois »
je sors en courant dans la nuit
fuir
vaines souffrances
ce don de toi payé au prix fort
tu disais tout résoudre par l’amour la prière
tes années défilent comme un livre d’images
dans la lumière du crépuscule
tu sautes sur ta couche rempli de doutes
comme une peau nouvelle un bonheur enfui
ça n’est pas un chagrin un malaise
tes croyances ne sont pas les miennes
pourtant nous attendons la même chose
la même délivrance
ta beauté apparaît maintenant que tu pars
Marie Hélène prie à mon coté
Il fait si chaud
Mère que vois-tu
maintenant sur la voie rapide
vers la maison
la radio joue long way you run
neige sur le bord de la route
marques de vie manque d’amour
tous à la merci les uns les autres
tous la même vaine histoire
absurde après-midi
hiver 2004