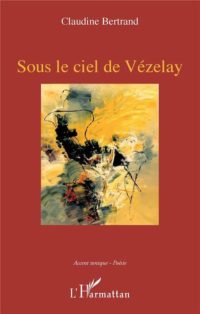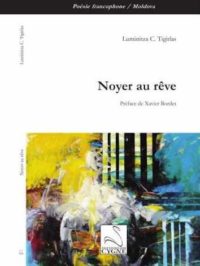Serge Núñez Tolin, une poésie de la moindre des choses
Les éditions Rougerie nous ont donné à découvrir en 2020, deux recueils de deux poètes d'origine belge : Marc Dugardin et Serge Nuñez Tolin. S'il ne fallait ne retenir qu'un point commun entre ces deux auteurs, il me semble que c'est leur sens de l'observation méticuleuse du moindre instant de vie. Mais aussi dans leur appropriation de leurs observations « C'est en moi que je trouve le bois vécu des clôtures : en moi l'incendie du sens. »
L'ouvrage de Serge Nuñez Tolin s'ouvre sur des feux de prairie en totale opposition avec la pluie drue du titre. Mais cet d'embrasement est un feu de joie. Le feu de la fin d'été et de l'automne où commencent ces textes. Le feu intérieur qui entretient la vie. Ce feu que les poètes cherchent, sinon à domestiquer, à le comprendre, à en percevoir la magie, à en ressentir le pouvoir « en moi, l'incendie du sens ».
Tout de suite, dès le premier texte, l'auteur cherche à « Tirer le poème de son silence » dans la « Banalité de la campagne, chemins défoncés. / / Tous les mots sont ici, aucun ne s'absente, prairie du réel ». Là où le réel serait cette prairie immense où il est facile de se perdre, l'auteur a trouvé son poste d'observation : « La fenêtre patiente pour s'accorder au paysage. » Pour s'aérer le regard « J'habite les fenêtres, ces éveils de la lumière. »

Serge Nuňez Tolin, Près de la goutte d'eau sous une pluie drue, Rougerie, 2020, 72 p., 13 €.
La poésie de Serge Nuñez Tolin résonne comme célébration des mots du quotidien, « Ce quotidien où nous sommes levés avec les choses et les mots les plus quelconques ». Avec des mots de tous les jours, Serge Nuñez Tolin parvient à réaliser ce qu'Antoine Emaz appelait la fusion vie-langue pour un ensemble très agréable à lire.
Serge Nuñez Tolin sait choisir les mots de l'observateur attentif de la nature pour en exprimer la fragilité : « Fragilité belle, d'une beauté qui ressemble si fort à nos tristesses. Fragilité qui conduit nos pas vers les présences les plus discrètes. » La nature et les petites choses qui en font la vie « Les mots ne me séparent pas des choses ». Avec une écriture à l'écoute de ce « silence plus grand que les mots avec quoi on a voulu le cerner. »
Poésie du fragile, poésie de la moindre des choses.
Une observation fine de chaque perception la plus insignifiante, pour en deviner le signifiant. Le poète trouve un pouls dans le moindre envol de cloches. Il observe en profitant de la forme la plus heureuse de la solitude « Il y a toujours une solitude dont on doit se remettre, à laquelle on n'achève pas de se rendre. »
Observer le moindre détail, y repérer la moindre sensation. Dans la pluie drue, savoir y distinguer la moindre goutte d'eau. Pas besoin d'aller loin pour écrire de la poésie, « En quoi vaudrait-il toujours pour se tenir ici, respirer ailleurs ? », juste tenter de raccrocher à l'universel la moindre veilleuse allumée, le plus banal poteau de clôture, la plus insignifiante goutte d’eau « Près de la goutte d'eau sous une pluie drue. / Comme l'eau de la cruche, la mie sous la croûte, le silence réclame sa forme. »
Écrire avec le regard au plus proche du réel. « Des mots dits dans leur plus grande possibilité d'être dits ; pour cela, nus dans leur plus grande possibilité d'être nus. Ils sont le réel sans nous. Des mots avec lesquels nous mangeons et mourons. ». Se laisser s'abandonner à la méditation dans la lumière et le silence pâles d'une aube nouvelle, depuis une fenêtre, et dire « le glissement des heures l'une sur l'autre. »
Que retirer de cet ouvrage ? Une poésie des horizons bas, d'une douce mélancolie, en prise directe avec « le vaste réel et l'icône du monde. », mais aussi « une joie dans la matière que l'écho du vivant y aurait mise, violente et active, une danse élémentaire. » Une pluie nourricière pour qui aime la poésie.