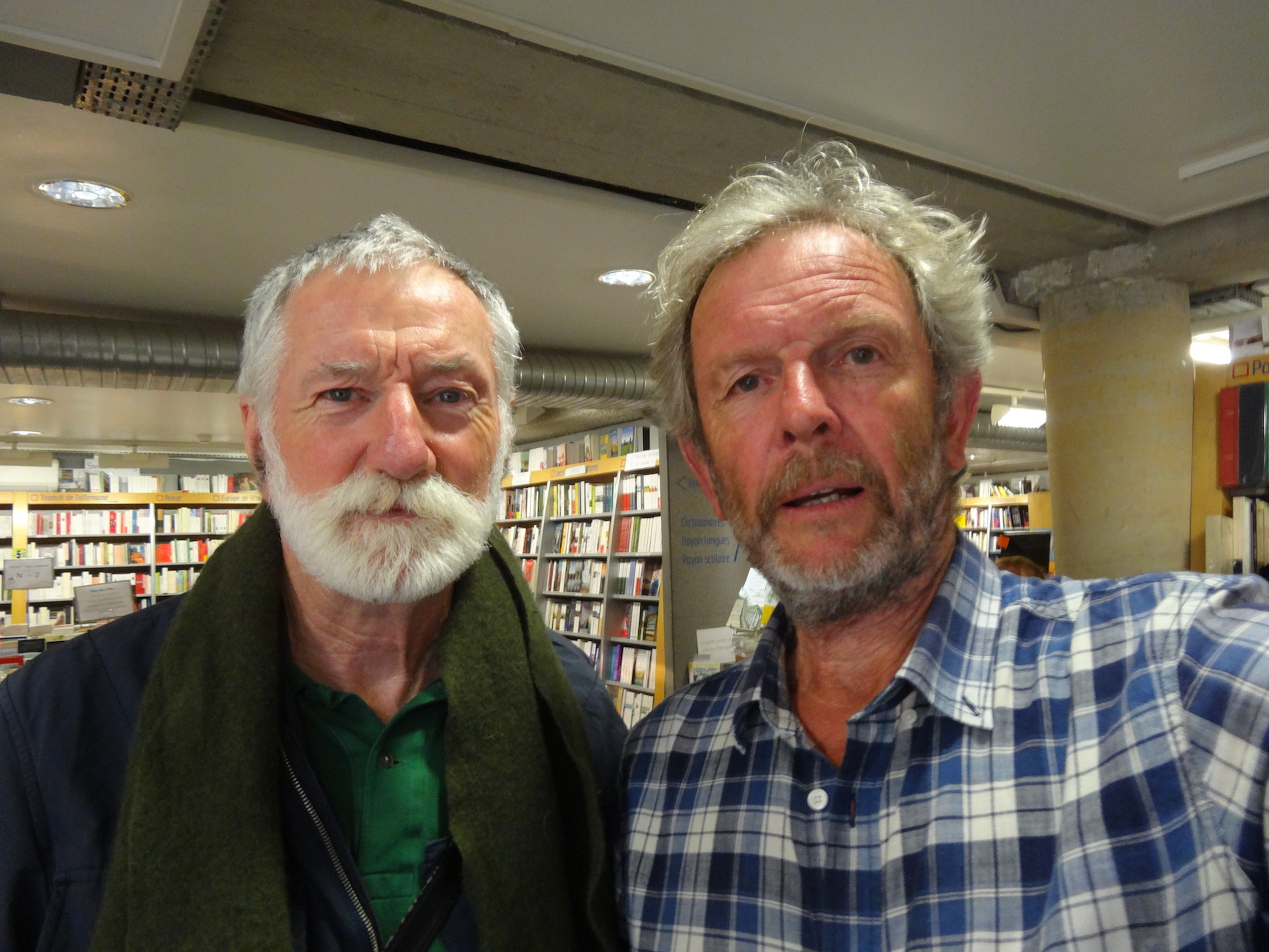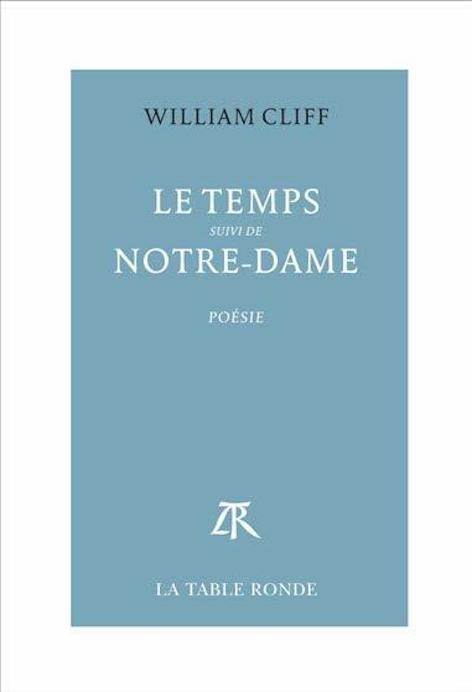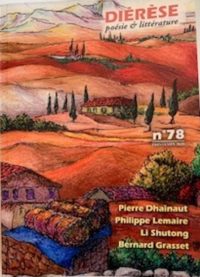Le haïku francophone contemporain
Ces textes ont été diffusés en 2019-2020 dans l’émission « La pierre à encre », animée par Christophe Jubien, sur Radio Grand Ciel.
Le genre haïku a l’avantage d’ouvrir un espace littéraire au sein duquel le monde, l’être humain et la langue se retrouvent dans un rapport équilibré, chacun ne prenant que sa place, furtive, limitée.
Le genre a traversé les frontières du Japon, où il était né, au début du 20° siècle pour occuper le vaste espace interculturel de la planète. C’est sa modernité, il se partage et réunit. Il aiguise l’attention. N’allez pas croire que sa forme fixe minimale : 5-7-5 syllabes, un mot de saison, une césure, soit d’un autre temps et mène à la facilité, au contraire. Elle est un défi et un force.
Dans ces lignes, vous trouverez quelques éléments qui colorent la pratique francophone du genre, arrivé en France vers 1903, dans toute son activité aujourd’hui.
1. Retour au haïku, France, années 80
Trois poètes s’engagent dans l’écriture du haïku au cours des années 1980.
Patrick Blanche, né en 1950, s’approche du haïku en lisant « Journal des yeux », de Gary Snider, poète de la beat generation à San Francisco. Blanche publie ses premiers haïkus en 1980, dans la revue P.A.F, réalisée par Maurice Coyaud. En voici quelques uns :
Une fois de plus l’hiver
me trouve sans compagne
mais la montagne a des vallées profondes
Sur la route enneigée
Les pattes des moineaux semblent
encore sautiller
Après la pluie,
Le chant des oiseaux
Semble plus clair
Blanche vit dans la Drôme, a travaillé comme saisonnier ; sa figure semble proche du poète ermite. À une époque, il a fondé avec deux collègues drômois une école : « La voix.e du crapaud ». Il est intervenu à l’université, il a traduit des haïkus japonais avec Makoto Kemmoku. Et il a publié, entre autres, un livre de poèmes bilingues, au Japon : « Si léger le saule », dont voici un extrait :
Des années d’errance
ne demeure pas grand-chose
Le goût de la pluie
Premières cerises
On les vole au bord des routes
comme des gamins
Simple fait d’hiver
Couché sur des vieux cartons
un clochard : mort
Comme tous les midi
la nana au tatouage
s’en vient boire son coup
Alain Kervern, brestois, est né au Vietnam en 1945. Il a étudié et enseigné le japonais et affirme que les non-japonais ne peuvent comprendre et écrire des haïkus. Mais, il se trouvera emporté par cette vague du haïku dans les pays occidentaux et publie lui aussi des poèmes courts. Dans « Les portes du monde », aux éditions Folle avoine (1992) :
Les lampadaires s’allument
A voix basse
La marée monte
Il monte il monte
L’orage
Par les cages d’escaliers
Volée d’étoiles
Longuement vibre
L’horizon
Baiser
De la première abeille
Douleur au ralenti
Il désherbe une mémoire
∗
A la pointe du ciel
L’estafilade
D’une mouette
Il désherbe une mémoire
Plus longue que sa vie
Le buveur de silence
∗
Rendre au vent
Sa jeunesse
La fureur des chardons
Dialogues, 5 questions à Alain Kerven, 2009.
Kervern a traduit aux éditions Folle avoine un almanach de saison, saïjiki en japonais.
Jean Antonini, moi-même chers amis, né en 1946, découvre le haïku japonais dans l’anthologie de Maurice Coyaud : Fourmis sans ombre, éditions Phébus (1978). Je publie un premier recueil aux éditions Aube, région lyonnaise, en 1982 : Riens des villes et des champs.
Premier fauchage
la rouille de l’année
disparaît dans l’herbe
∗
Petit géranium rouge
mon tremplin matinal
en ce monde
L’univers est un grand mystère
dit-il en regardant
un carré de poireaux
∗
C’est l’automne
les balayeurs
ont du travail
Ce goût pour le haïku m’amènera à voyager et rencontrer de nombreux poètes, dont l’un, Max Verhart, hollandais, m’a publié le recueil « Hé ! géranium blanc », en trois langues.
Le géranium blanc
juste cinq pétales éclos
sur la fenêtre
∗
Trois tiges vertes, les yeux
glissent, montent, se posent, s’éparpillent
sur les pétales blancs
∗
Je cale les pétales
des taches blanches sur le ciel bleu
J’enfile mes deux yeux
La fleur blanche
elle en silence, je bégaye
la fleur blanche
∗
Et si la fleur meurt
vais-je mourir aussi, moi ?
Ensemble sous la terre
∗
N’oublie pas fleur nous
le monde s’évapore fleur nous
rester bien serrés
∗
Remplir sa vie whoops
des brassées de géranium
de la terre au ciel
2. L’intérêt pour une esthétique autre
Au tournant des années 2000, avec le développement des réseaux numériques et des messageries, la pratique du haïku va soudain rencontrer des amateur.es très divers. Touché.es par la forme courte qui s’échange facilement, ou par la puissante brièveté du poème japonais, ou encore par son exotisme et son esthétique singulière, chacun, chacune va se lancer dans l’écriture du haïku en développant des motivations différentes.
Allons d’abord au plus simple : le goût pour l’esthétique japonaise telle qu’on peut la lire dans les recueils de Philippe Bréham.
Silence de l’aube
Et de la neige qui tombe
Sur la neige
(Ce poème obtint le 1° prix d’un concours de haïku organisé par un quotidien japonais)
∗
Au-dessus des pins
Flotte une lune brumeuse
Thé dans la véranda
Dans le repos du soir
Je n’entendis plus rien
Excepté la montagne
∗
Devant le Fuji
Un photographe en extase
dépose l’appareil
L’auteur écrit en préface de Pins et Cyprès sous la lune, éd. Spiritualité Art Nature : « L’acte poétique, c’est tendre vers l’expression d’une réalité transcendée... c’est aussi aller au-delà de son ego vers l’intériorité profonde de chaque être. » Bréham recherche, à travers le haïku, une nouvelle forme de spiritualité.
Il en va tout autrement de Robert Davezies (1923-2007), prêtre, militant du combat anticolonial, membre du réseau Jeanson durant la guerre d’Algérie. Le haïku l’amène à décrire des scènes campagnardes avec empathie.
Cris des martinets
qui font des entailles
dans un matin de juillet.
∗
Petits pois coulant
de la vieille main
de Marie au fond d’un bol.
∗
Cheminant au bord du ciel
sur sa bicyclette
le facteur rural.
Vous ne cueillerez
jamais que des figues
sur votre figuier.
∗
Elle flotte, immaculée,
la culotte de gendarme
au ciel étendue
∗
Il neige. Au jardin
le vieil arbre mort
se couvre de fleurs.
Il tonne. Un navet
dans la main, une servante
fait le signe de croix.
Dans ces poèmes (tirés de L’eau & le vin, éd. Maspero), nul exotisme si ce n’est celui d’une vie campagnarde française.
Marcel Peltier, lui, fut professeur de mathématiques durant 38 ans en Belgique. Il commence à écrire des poèmes autour de l’année 2000. Par la suite, il cherche une formule poétique plus resserrée que le 5-7-5 : un poème de 7 mots maximum.
Crépuscule
Les choses se cachent
sans un bruit.
∗
Conversation prolongée
fond de bouteille
∗
Les éoliennes
voilées par la brume
Tremblements,
ses lèvres rêvent.
∗
Le jardin
recueille leurs voix,
Passereaux
∗
Près de la banque
des pissenlits.
La concision des poèmes de Marcel Peltier, tirés de Au creux du silence, éd. du Cygne, veut laisser le champ libre à l’imagination du lecteur.
Avec Pierre Courtaud (1951-2011), l’écriture du haïku rejoint celle de la poésie française contemporaine, dans ses aspects fragmentaire, instantané, effacé.
Faux marbre et cuir or
c’est écrire
sur un petit carnet made in Shangaï
∗
Sur le vent déjà ―
plus rien à dire
∗
Les haillons de la langue
et tout ce qui s’y cache
Aile non plus que feuille
Quel vent
les pousse à se ressembler ?
∗
L’instant de l’éveil
dans son désordre
lumineux
∗
Et blanche brume plutôt que fleur
là-bas-au-fond-du-champ-près-des-toits
bouclier se lève
Ces poèmes sont tirés de 33 Haïkaï des sites et autres modèles, éd. La main courante.
3. Le goût de la fondation
Dans l’histoire du haïku francophone depuis 1903, il y a eu des regroupements de poètes pour écrire (kukaï), des numéros de revue, des articles, des livres, mais la première association (type loi 1901) date d’octobre 2003. Elle est fondée par les D : Dominique Chipot et Danyel Py (« Les D sont jetés » est le titre de l’éditorial du numéro 1 de la revue GONG). Henri Chevignard participe à cette fondation, plus particulièrement semble-t-il, par sa collaboration à la revue de la nouvelle association : revue francophone de haïku. Les deux D se réjouissent que 50 personnes aient répondu à leur appel associatif, des belges, des canadiens et des français. C’est un moment historique, rendu possible par la structure même du haïku : une forme poétique fixe que chacun, chacune partage et qui rassemble donc ses pratiquant.es.
Parlons des fondateurs. Dominique Chipot, qui va remplir la fonction de président de l’AFH pendant 3 ans, puis fonder une autre association de haïku et contribuer à la traduction en français de haïkus japonais essentiels (l’intégrale des hokkus de Bashô, notamment) est sans nul doute le ferment actif de cette fondation. Il a découvert le haïku dans le roman « Oreilles d’herbe », de Soseki, et « il a choisi d’être dans ses haïkus un ‘passeur de sens’ en évoquant le banal sans être banal », écrit-il sur son site « Le temps d’un instant ». Voici quelques poèmes tirés de L’ignorance du merle (2011) et La boussole dans son vol garde le nord (2016) :
le merle recueille
des pétales de glycine ―
je peins le salon
∗
matin de printemps
et pourtant mon cœur me dit
que l’automne est là

Revue Gong numéro 26.
lui serrant la main
je comprends que son travail
n’était pas facile
∗
dans ce vol de corbeaux
matinal
je lis l’aventure
certains ont des avenues
lui
c’est une impasse
∗
n’écris pas de poèmes
laisse la lumière dessiner
ton carnet de voyage
∗
Passant
dans la rue des grands hommes
passés
Daniel Py indique dans GONG n° 1 qu’il a découvert le haïku au hasard de ses lectures sur les philosophies orientales, à l’adolescence. En 2002, il organise HCSC – Haïku-Concours-Senryu-Concours -, un groupe de discussion sur Internet qui permet, dit-il, de nouer des contacts chaleureux. Par la suite, il sera, durant plusieurs années, l’animateur du Kukaï de Paris et publiera plusieurs traductions de l’anglais de textes critiques sur le haïku, tendance plutôt zen.
Voici quelques haïkus tirés de « HAIKU » (2001) et « Galets sur la langue » (2004).
Une goutte de pluie
rebondit et pose 8 pattes
sur la table
∗
Nuit d’août ―
partageant la moiteur
avec les moustiques assoiffés
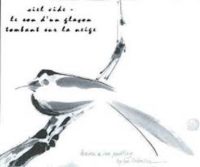
Association francophone de Haïku.
∗
Les arbres laissent
tomber à leur pied
leur robe de feuilles
∗
sur l’emplacement
du WTC, l’ombre
de tours voisines
le miroir
ne fait pas un pli ―
visage ridé
∗
elle regarde un livre
je lis dans son décolleté
l’unique ligne
∗
mouettes
portant l’histoire du vent
dans leurs ailes...
On peut lire Daniel Py sur son blog : http://haicourtoujours.wordpress.com/
Henri Chevignard écrivait dans le numéro 1 de GONG : « Gong ! Très simplement, c’est un impact, suivi d’une résonnance. Mais on saura aussi y déceler une image fugitive, imprimée sur la rétine ; un cri, que prolonge un écho ; une passante en allée, n’offrant plus que son parfum ; une cicatrice, témoignant d’une ancienne blessure... »
À ma connaissance, il n’a pas publié de recueil de haïkus, mais on peut lire ses tercets dans la revue GONG et dans les anthologies « Dix vues du haïku » et « Zestes d’orange » :
À l’aube
la profondeur des labours
Un reste de rêve
∗
Bol de thé
posé sur le parquet
Sentir ses cheveux
∗
Cohue du métro ―
sur ce manteau bleu marine
un cheveu blanc
Mon calepin vert
remplacé par un bleu
Premier gel
∗
Hall de gare
les trajectoires des voyageurs
autour du mendiant
∗
Un ciel d’encre
redessine la colline
Les champs labourés
∗
Train d’hiver
pénétrant dans un tunnel
odeur de mandarine
4. Le goût de la transmission - ateliers
La forme courte du haïku en a fait une forme poétique propre à être échangée et transmise. Ces échanges et ces transmissions ont pris deux formes : les ateliers d’écriture et les kukaïs. Abordons d’abord les ateliers d’écriture et trois poètes de haïku qui se sont illustrés depuis plus d’une dizaine d’années dans l’animation d’ateliers, souvent en direction des jeunes gens, dans les écoles ou les médiathèques.
Parlons d’abord de Jeanne Painchaud, poète canadienne qui vit à Montréal et qui a publié en 2015 le livre « Découper le silence – Regard amoureux sur le haïku ». Elle écrit que, « pour partager son enthousiasme pour le poème, elle a commencé à animer des ateliers d’initiation en 1997 ». « Quand je franchis la porte d’un atelier, mon objectif est toujours le même, dit-elle : mettre le feu à la classe ». Et elle cite le haïku d’un jeune garçon de 13 ans assez turbulent :
printemps
les plus belles fleurs
portent des mini-jupes
Voici quelques haïkus de Jeanne Painchaud, tirés de « Le ciel si pâle », éditions de La Lune bleue.
le ciel si pâle ce matin
douter même
de l’existence des étoiles
∗
lune pleine
poches vides
des soirs comme ça
∗
ces branches d’érables nues
autant de mains
tendues vers le ciel
∗
il veut passer la nuit
avec moi
le papillon de nuit
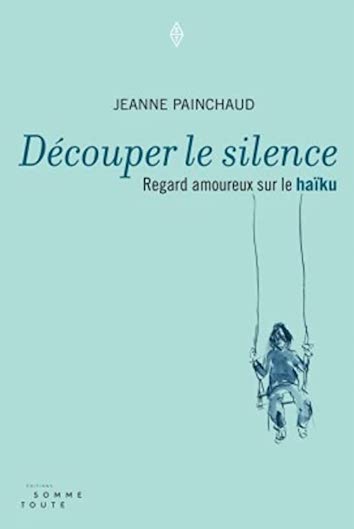
Jeanne Painchaud, Découper le silence, regard amoureux sur le Haïku, éditions Somme toute, 2015.
∗
regarder les nuages
les sentir glisser profondément
en soi
dans le tourbillon du soir
zigzaguent deux moustiques
premier baiser
Jeanne Painchaud a également médiatisé le haïku dans des dispositifs artistiques : pochoirs sur les trottoirs ou lanternes japonaises en médiathèque.
Isabel Asúnsolo, quant à elle, a commencé l’animation d’ateliers d’écriture de haïku comme éditrice de la maison qu’elle a fondée, avec Eric Hellal : les éditions L’iroli. Elle a publié plusieurs anthologies thématiques de haïku et des guides pour l’écriture, comme « Le haïku en herbe » (L’iroli, 2012), et aux éditions leduc : « Mes premiers haïkus pour bien grandir » et « La magie du haïku à partager avec vos parents ». Au cours de ses animations, Isabel Asúnsolo insiste particulièrement sur le fait d’observer les choses autour de soi durant des promenades d’écriture (ginko) et sur le fait de choisir le mot juste : un oiseau ? quel oiseau ? une pie, une alouette, un épervier, un moineau ? Elle habite à Beauvais et transmets l’écriture du haïku aux jeunes scolaires de la région des Hauts de France et d’ailleurs. Quelques uns de ses poèmes (Les carnets qui rêvent n°6) :
je mets une fleur
d’amandier dans sa paume
elle ouvre la bouche
∗
novembre
le couteau heurte le vide
de la meringue
∗
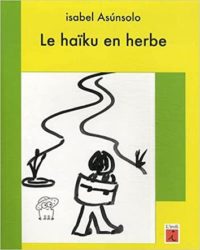
Isabel Asunsolo, Le haïku en herbe, L'Iroli éditions, 2012, 160 pages, 15€.
après son départ
je mets à griller au four
deux beaux poivrons rouges
∗
nuit de neige
au réveil mon dernier fils
me dépasse !
alerte orange
le rouge-gorge finit
mon Paris-Brest
∗
dimanche de Rameaux
la chatte Geisha mâchonne
le petit buis
Dans l’animation d’ateliers, Thierry Cazals est un maître planteur. « Il suffit parfois d’une graine plantée dans le silence pour que le monde se remette à sourire. » dit-il. Et son expérience d’animation, il la partage dans un livre qui vient de paraître à la maison cotcotcot éditions : « Des haïkus plein les poches ». « Ne cherchez pas de vagues idées dans votre tête, dit-il, partez de sensations vécues précisément. Un haïku est une invitation à sortir de notre bulle et reprendre contact avec la vie en direct. » Il cite ce poème :
Je marche
sur des feuilles rouges
un danger agréable
de Cédric, Collège, Clamart
Thierry Cazals incite les jeunes aspirants à prendre un nom de plume, comme ceux des poètes japonais : Bashô, c’est bananier ; Buson, Village de navets ; Issa, Une tasse de thé ; Ransetsu, Tempête de neige ; Chigetsu, Lune sage. Une façon de s’écarter de sa vie, de soi-même, pour mieux regarder.
Voici quelques poèmes de Thierry Cazals, tirés de «La volière vide », aux éditions L’iroli :
je ne sonne pas, ne frappe pas
cette porte
c’est elle que je suis venu voir
∗
les arbres parmi les maisons
et soudain
les maisons parmi les arbres
∗
le long de la voie ferrée
ignorant les horaires
les cerisiers fleurissent
∗
nuit d’insomnie
un à un les bourgeons
se défroissent
un homme
happé par le brouillard
rarement l’inverse
∗
cherchant à quatre pattes
une aiguille sous l’armoire
long jour d’été
∗
long hiver
je taille mon crayon pour mieux
ne rien écrire
∗
après le passage de la fanfare
je relis mes haïkus
avec suspicion
5. Le goût de la rencontre : kukaï
C’est en 2006, au Festival de haïku organisé à Paris par l’AFH, que le poète Seegan Mabesoone nous a expliqué comment se transmettait la pratique du haïku au Japon dans les rencontres (kukaï) de poètes sous la direction d’un poète expérimenté. Par la suite s’est créé le kukaï de Paris, avec Daniel Py, et le kukaï de Lyon, avec moi-même.
Dans une rencontre classique, chacun apporte 3 poèmes, les poèmes sont copiés sur différents papiers pour devenir anonymes et chacun lit l’ensemble des poèmes et retient les trois qui lui plaisent le plus. Au cours des lectures, on échange sur le poème, son intérêt, ses images, etc. Et l’auteur est appelé à se dévoiler et à évoquer l’écriture du texte. Puis, on relit les haïkus choisis et le nombre de voix obtenus. Le kukaï peut aussi se rapprocher de l’atelier d’écriture et on travaille le mot de saison ou la césure, ou autre chose. C’est un moment très convivial.
Aujourd’hui, il existe plusieurs dizaines de kukaïs en France, en Belgique, au Canada francophone, qui se réunissent régulièrement et font connaître leurs activités sur des sites ou des blogs. Parlons du kukaï de la ville de Québec, au Québec, puis de celui de Lyon, que je connais bien.
Le 5 septembre 2017, nous raconte Geneviève Rey dans la revue GONG n°61, pour la rentrée du Kukaï de Québec, le groupe a réalisé un ginko (balade-haïku) au cimetière-jardin de Mount Hermon avec un groupe de dessinateurs. Voici quelques uns des haïkus écrits, un par participant.es.
sur la pierre
un trait entre deux nombres
le temps d’une vie
Bernard Duchesne
∗
sous l’orme géant
devant la croix de granit
une jeune femme
André Vézina
∗
bruissement de feuilles
les arbres centenaires
défient la mort
Solange Bouin
∗
soldat de 18
à côté d’Anne de 39
amour éternel
Donna McEwen
∗
sous le grand pin
un ange de pierre
veille une stèle vierge
René Moisan
trois croix
côte à côte
la blancheur des lettres
Diane Prévost
∗
les grands pins
témoins stoïques
de tous ces chagrins.
Marianne Kugler
∗
une simple pierre
dans le gazon
elle avait vingt-sept ans
Geneviève Rey
∗
sur le banc
bouquet de fleurs fraîches
merci à la vie
Jean Deronzier
Et maintenant, une séance classique du Kukaï de Lyon, le 9 mai 2019, animée par Patrick Chomier : Le thème - « Pour sortir de la fascination de la vue, nous choisissons d’écrire deux haïkus non visuels. »
les bras tendus
à petits pas chercher la porte
dans la nuit
Christian Lherbier (4 voix)
∗
craquements d’os
au pied de mon lit
souris ou oiseaux ?
Béatrice Aupetit-Vavin (3 voix)
∗
Tintement
de la petite cuillère
sur le bol
Jacques Beccaria (2 voix)
∗
Mois de mai
l’odeur du gazon coupé
Solitude
Jacques Beccaria (1 voix)
froissée dans ma main
une feuille de menthe
odeur de vacances
Béatrice Aupetit-Vavin (3 voix)
∗
dans l’ombre chaude
dort le gros chat paisible
parfum de roses
Martine Mari (2 voix)
∗
A cinq heures
l’alarme incendie
Riz cramé
Danyel Borner (2 voix)
∗
elle m’annonce
la mort de son père
les cris du bébé
Patrick Chomier (1 voix)
6. Regards de femmes
Les quatre poètes considérés comme des maîtres de haïku au Japon sont quatre hommes : Bashô, Buson, Issa et Shiki. Pas une femme poète dans cette hiérarchie établie au pays du soleil levant. Et pourtant, dès le début du 18° siècle, une femme poète, Chiyo-ni, a réalisé une belle œuvre de haïkaï. Ses poèmes ont été traduits en français chez Moundaren et chez Pippa. Dans leur présentation de la poète, Grace Keiko et Monique Leroux Serres écrivent : « Chiyo-ni écrit sans chercher à copier les hommes et assume sa part féminine. » Cela aurait pu être un motif pour lui faire une place parmi les maîtres de haïku japonais. Mais la place sociale laissée aux femmes japonaises, encore aujourd’hui, ne le permet peut-être pas. Citons un de ses hokkus traduit par Keiko et Leroux Serres :
otoko nara hito yo nete min hana no yama
si j’étais un homme
dans la montagne en fleurs
je passerai la nuit
Dans l’espace francophone, par contre, les anthologies de haïkus écrits par des femmes n’ont pas manqué depuis les années 2000. Commençons par mentionner « Du rouge aux lèvres », une anthologie de haïjins japonaises réalisée par Makoto Kemmoku et Dominique Chipot, aux éditions La table ronde, en 2008. On y lira une quarantaine de poètes japonaises, depuis l’époque de Bashô jusqu’à aujourd’hui.
Mais les anthologies de poètes francophones ont pris leur part. La première est réalisée par l’auteure québécoise Janick Belleau, publiée par l’Association francophone de haïku et les éditions Adage en 2009 : « Regards de femmes ». En préface, Belleau évoque le mot « gynku » pour un haïku de femme. Et, elle décrit les thèmes abordés : la nature, bien sûr, le Je, l’amitié et l’amour, les relations mère-fille, le quotidien, le corps à soi, l’humour, la société, l’environnement. Elle se pose la question d’une écriture androgyne.
ma vieille amie
des étincelles dans les yeux
malgré les rides
Louise Vachon
∗
au chevet de ma mère
je retrouve mes gestes
de maman inquiète
Amel Hamdi Smaoui
∗
retour du marché
les bras pleins de légumes
et de pensées pour l’hiver
Nicole Olivier
la gastro de la petite
toute la famille y passe ―
lune de février
dorothy howard
∗
cinquante et un ans
il photographie toujours
ma nudité
Dominique Champollion
Un an plus tard, 2010, c’est l’éditrice isabel Asúnsolo qui publie aux éditions L’iroli « La lune dans les cheveux », 88 femmes plus un. Chaque auteure est présentée par un poème avec sa traduction en espagnol.
ton cœur
j’en ressens les secousses
sur mon ventre rond
Céline Larouche
elle berce sa poupée
sur sa poitrine naissante
la petite fille
Hélène Bouchard
dans le musée
elle admire les statuettes
aux seins pendants
Micheline Beaudr
En 2018, Danièle Duteil reprend le flambeau avec 127 femmes sous le titre « Secrets de femmes », aux éditions pippa. Duteil écrit en préface : « ... les femmes brûlent d’exister aussi en dehors de la vie domestique, si exquis leur foyer soit-il. »
Kobayashi Issa (Le goût des Hïakus).
lueur du jour
rêvant de maternité
je nourris les poules
Geneviève Fillion
photos de famille
sur le visage des femmes
le même sourire
Sophie Copinne
Retour de la neige
Mes règles à jamais
disparues
Monique Leroux Serres
Il faut encore citer « Sens dessus dessous », en 2018, où Choupie Moysan, Chantal Couliou et Régine Bobée publient le désir et les fantasmes féminins (assez proches des masculins) dans la collection Envolume dirigée par Igor Quézel-Perron.
Pouce levé
robe collée à la peau
l’auto s’arrête
Balade à vélo
seule dans le bois touffu
― rêver du loup
Nacre de ses dents
sa bouche entrouverte
Ah... ! m’y faufiler
A la prochaine fois.
7. Les revues francophones
La plus ancienne, parmi les contemporaines, est la revue papier GONG. Son premier numéro (couverture jaune, 32 pages, parution trimestrielle) fut lancé en octobre 2003 par Dominique chipot (directeur d la publication jusqu’en 2006), Daniel Py et Henri Chevignard. C’était le début de l’association française, puis francophone de haïku. « Les dés sont jetés. L’aventure commence. » écrivaient les deux D. Et Henri Chevignard, page 9 : « Gong ! Très simplement, c’est un impact, suivi d’une résonnance. » Le son, qui se propage plus lentement que la lumière dans l’air était privilégié dans le titre de la revue. Aujourd’hui, la revue en est à son numéro 67 (couverture orange, 72 pages), j’en suis le rédacteur en chef depuis 2007, avec le comité de rédaction : isabel Asunsolo, Danyel Borner, Geneviève Fillion, Sabrina Lesueur, Eléonore Nickolay et Klaus-Dieter Wirth. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Voici quelques haïkus du n°1 et du n° 67 :
soleil matinal ―
quelques corbeaux se partagent
les champs moissonnés
Henri Chevignard
l’étudiant en flûte
de ses volutes repeint
chaque matin les murs
Daniel Py
Crépuscule
Odeur enivrante
Du seringat par la fenêtre
Leslie Riard
déclin de l’été
les fourmis sur la glycine
soignent les pucerons
Dominique Chipot
blancs et légers
j’irais bien nager
dans les nuages
Béatrice Aupetit-Vavin
mars éteint
et rallume la lumière
― giboulées
Mireille Péret
Vous pouvez lire tous les numéros de GONG sur www.association-francophone-de-haiku.com.
En 2007, la revue numérique 5-7-5, revue francophone de haïku, est créée par Serge Tomé, sur son site web dédié au haïku depuis 1999 : TempsLibres. Cette revue, qui surgit à la fin de la revue papier canadienne Haïkaï, paraîtra trimestriellement de l’hiver 2007 à la fin 2010. Serge Tomé indique que chaque numéro sera coloré par un poète particulier. Meriem Fresson tiendra une rubrique haïbun régulière jusqu’à la fin ; et Daniel Py, une rubrique « zen contemporain et haïku urbain » épisodique. Damien Gabriels dirige le n°2, de nombreux intervenants se sont mobilisés. Cette aventure prometteuse durera peu de temps. Meriem Fresson y fera un travail important pour le haïbun francophone, qui se poursuivra dans « L’écho de l’étroit chemin », la revue de l’Association Francophone des Auteurs de Haïbun, créée et dirigée par Danièle Duteil, fondatrice toujours active de l’AFAH. Les numéros de 5-7-5 peuvent être consultés sur 575.tempslibres.org. Quelques haïkus du numéro 2 :
après l’averse
odeur de tisane
sous les tilleuls
Monika Thomas-Petit
dans le brouillard
même ma voix
disparaît
Philippe Quinta
la fourmi
emportée par la goutte d’eau
fin de l’été
Micheline Beaudry
Ploc ! la revue du haïku est ouverte par Dominique Chipot en 2008. C’est la revue numérique de l’association pour la promotion du haïku, APH. Chaque numéro est réalisé par un poète différent : Olivier Walter, Francis Tugayé, Sam Cannarozzi, Christian Faure, Damien Gabriels, Hélène Phung. La parution, de 8 à 10 numéros par an au début, est à présent de 2 numéros par an. On peut y lire des haïkus et senryûs, des articles, des haïbuns, des notes de lecture. Voici quelques haïkus du n° 78, février 2020, réalisé par Hélène Phung :
soirée sans nuages
le bruissement des feuilles mortes
portées par le vent
Maria Tirenescu
sur la neige fraîche
chut !
l’ombre d’un nuage
Annie Chassing
eaux transparentes
entre les herbes la grenouille
somnole
Abderrahim Bensaïd-Sidi Kacem
Vous pouvez lire tous les numéros de cette revue sur www.100pour100haiku.fr
Signalons, pour terminer, la revue numérique dédiée au haïbun que l’on peut lire à association-francophone-haibun.com.
Buson (Le goût des haïkus).
8. Recherches universitaires
Dans les dix dernières années, les chercheurs universitaires s’intéressent au haïku : un premier colloque, « Le haïku en France, poésie et musique », est organisé à Lyon 3, en 2011, par Jérôme Thélot et Lionel Verdier. Il montre que la forme poétique japonaise traverse le domaine de la création en France, particulièrement en poésie et en musique.
« Le haïku fut pour beaucoup des poètes de l’après-guerre la chance inespérée d’un réinvention de la poésie française, la rencontre de cet ailleurs du discours,dans le congédiement de la pensée rhétorique et de la pensée logique, grâce à quoi parler poétiquement fut de nouveau possible, après tout.... Nul doute que s’il y a eu dans la langue française depuis cent vingt ans une découverte capitale, c’est bien celle-ci, - la découverte que les poètes ont faite du haïku. » écrit Jérôme Thélot. On perçoit la détermination de ce chercheur pour expliciter l’intérêt des poètes français pour le haïku japonais. Mais, dans ce travail, n’est abordé que ce rapport extérieur au genre poétique, un rapport critique, un rapport de confrontation, limité par l’existence de cultures différentes, marquées par la nationalité développée dans chaque pays.
C’est le cas emblématique de Yves Bonnefoy, qui écrit : « ...quelques poètes des XIX° et XX° siècle ont cru possible de recommencer, en français notamment, une pratique analogue à celle du haïku, et même ont estimé y avoir assez réussi pour s’approprier le mot. Ils regardent une fleur, disons une rose, comme ils imaginent que le poète japonais contemple la fleur de cerisier.
Mais quelle différence pourtant ! Dans le haïku, rien n’est isolable de rien, s’arrêter à quoi que ce soit serait séparer cet objet de l’attention, chose ou vie, du reste de ce qui est, dénouer la continuité de l’environnement naturel, et pour qui le ferait ce serait se couper lui aussi du tout, perdre ce bien, ce seul bien, par illusion que l’on peut exister par soi. La fleur du cerisier, si tôt défaite, c’est l’offre de méditer l’immédiat éparpillement, qui se doit d’être heureux, de l’être illusoire de la personne. »
Murakami Kijo (Le goût des haïkus).
Quand d’autres, comme Jean-Jacques Origas, rappellent la « vulgate du haïku » proposée par Akimoto Fujio (1901-1977) :
- Le haïku est un art mineur. Donc, si on ne réussit pas à faire de bons haïkus, c’est sans conséquence.
- C’est un poème bref. Donc, il ne faut pas faire un effort trop long.
- C’est un poème à forme fixe. Il y a toujours un cadre. Étant donné que nous avons dans l’esprit certaines impressions, certains mots, il faudra bien arriver à les mettre dans le cadre 5-7-5.
- Il faut toujours tenir compte du rythme des quatre saisons.
- C’est également le poème de l’aïsatsu, c’est-à-dire de la « salutation ».
Bref, ce sont des définitions tout à fait banales. Pourtant acceptons-les, ajoute Origas. Ces définitions constituent un rappel. À partir d’elles, réfléchissons.
The Haiku poems of Chiyo ni looked at in a new way, Une autre lecture des haïkus de Chiyo Ni.
Un deuxième colloque s’est tenu à Paris 3, en 2019, sous la direction de Muriel Détrie et Dominique Chipot : « Fécondité du haïku dans la création contemporaine. » Le premier colloque soulignait la partition entre « haïku » (genre poétique japonais) et « France ». Celui-ci entre directement dans l’exploitation de la forme poétique d’origine japonaise, acclimatée par des écrivains ou artistes francophones pour des raisons qui leur sont propres.
Muriel Détrie, maître de conférences en littérature comparée, souligne en ouverture la « forme simple » du haïku : « Comme toute ‘forme simple’, le haïku au sens où on l’entend aujourd’hui n’est pas une forme littéraire bien définie comme l’est le haïku japonais qui comporte des règles rythmiques (17 mores en 5-7-5), structurelles (deux partie distinguées par un kireji ou mot-césure), thématiques (emploi d’un kigo ou mot de saison) et esthétiques (voir les principes sabi, karumi, fueki et ryûkô, etc. utilisés par Bashô), mais il est d’abord et essentiellement défini par sa brièveté. La brièveté est ce qui a d’emblée frappé les premiers commentateurs occidentaux (de Paul-Louis Couchoud à Roland Barthes) et ce qui est resté comme la caractéristique fondamentale du haïku.... Dans tous les cas, c’est l’idée de brièveté extrême, de limite du langage, qui est perçue comme constitutive du haïku... »
Roykan, (Le gout des haïkus).
A partir de cette forme à la brièveté extrême, chaque intervenant étudie l’usage que chaque artiste ou écrivain fait du haïku. Par exemple, Magali Bossi, doctorante à l’université de Genève, étudie les « Haïkus de prison » publiés par Lutz Basmann, un des hétéronymes de l’écrivain Antoine Volodine. Dans ce livre, une succession de haïkus écrits par un prisonnier a pour tâche de rendre compte d’une guerre.
Le premier qui monde dans le wagon
a l’impression fugitive
qu’il est maître de son destin
Le deuxième à entrer
s’installe le plus loin possible
du trou à pisse
Le dernier qui monte là-dedans
regarde toujours on ne sait pourquoi
derrière son épaule
Ici, on voit bien que les haïkus sont devenus des éléments de narration, des fragments, qui n’ont plus grand chose à voir avec le haïku japonais, si ce n’est leur brièveté. D’ailleurs, on peut lire des poèmes tels que :
Le Japonais parle des cerisiers
pourtant dehors
la neige tombe.
Et malgré tout, un tel travail montre que la forme poétique du haïku peut intéresser bien des écrivains occidentaux, pour diverses raisons, peut-être ici en particulier parce que le haïku se situe à la croisée du narratif et du poétique.
∗∗∗
Voici donc un aperçu, non exhaustif bien sûr car le domaine est très dynamique, du monde du haïku francophone. C’est la petite taille du haïku, son équilibre entre l’humain, le monde et le langage, et son humour qui ont fait le succès de ce genre. Il constitue un véritable ferment poétique qui rassemble les gens et qui envahit l’espace.
Sur le site de l’Association francophone de haïku vous pouvez trouver beaucoup de liens pour prendre des contacts et beaucoup d’éléments pédagogiques pour se lancer dans la pratique de ce genre si souple, si proche de la nature et si propre à créer des rassemblements de poètes.