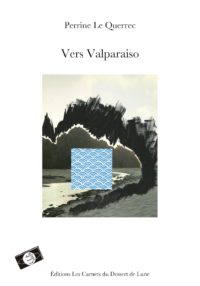Verso n°179, Ici & ailleurs
Ayant organisé deux expositions sur le thème universel Ici et Ailleurs1, grande est la tentation de consulter la revue trimestrielle Verso2. Son choix suscite l’envie de lire et d’observer les ricochets de poème en poème, recto ou verso d’eux-mêmes! Un incipit-dessin (formule inventée), esquissé par Michel Julliard, prélude à une certaine liberté de ton avec son lézard lascif et son oiseau aux ailes ocellées.
«Ici désigne un lieu précis. Ailleurs n’est pas visible » précise Alain Wexler, directeur de publication. Tout apparaît donc possible. Ainsi sa proposition d’ « appartenir au rêve d’un autre » incite la lectrice à fantasmer cet ouvrage traversé par un vif bouillonnement créatif.
Certes l’ailleurs du voyage impose sa priorité. « Il n’avait pas plu depuis longtemps. Les hommes dansaient pour faire tomber le verbe pleuvoir », constate le poète Charles Vanhecke en un périple – peut-être imaginé - vers une tribu éloignée. L’audace poétique vient que la pluie d’eau attendue est remplacée par le « verbe » qui l’exprime ! Une passion similaire pour les mots anime Véronique Joyaux, exploratrice d’un « livre qui n’existait pas ». Rêveuse d’amour, elle s’imagine être l’héroïne de l’ouvrage que lit l’homme « du wagon » assis en face d’elle. Il en émerge une belle phrase énigmatique : « Penseur, j’ai abîmé tes étoiles », annonce probable d’une relation ultérieure.

Ici & ailleurs, Editions Verso, n°179, 120 p., décembre 2019, 6€
Cet ailleurs entraîne le poète Jean-Paul Prévost dans son propre spleen : « Tout s’écroule. Je perds mon temps. De mon matin/Frileux, entre mes dix doigts je ne retiens rien ». Il conduit aussi Géraldine Serbourdin vers la tristesse de l’abandon : « Je suis agenouillée sur le sable en attendant la mer,/Je suis sur la longue route de la perte de toi ». Il pousse même Marc Mériel au désespoir existentiel : « Je n’arrive pas à croire que je suis le fils de quelqu’un. Il me semble que je suis né de rien du tout. D’un vide». Il est emprisonné en lui-même : « En habit de bagnard / Une statue me représente. » Quel constat fait-il ? « On croyait changer le monde / Mais c’est le monde qui nous change, / Il a fait de nous ce que nous sommes ; / des Poètes » . Patrice Blanc connaît cette même affliction, mais « au nom du désir et des flammes, au nom du sang » : « C’est comme une explosion/un corps ouvert à l’amour / qui ne sait plus de secret ». Quant à Marinette Arabian, son désarroi est un émouvant écho d’enfance. Fillette punie pour une dangereuse bêtise (se pencher dans le vide à hauteur du troisième étage), elle suggère à son père en sanglotant : « Rends-moi au Monsieur du magasin où tu m’as achetée ».
Certaine douleur enfin, moins personnelle, hante ces villes détruites par la guerre et rongées par les « cicatrices » de Clément Bollinot : Alep « à jamais béante dans l’étouffant ciel rouge de l’humanité », la route vers Tel-Aviv « criblée d’impacts de balles/une voiture calcinée / encore fumante / dans laquelle jouent /quatre enfants ».
Tous ces « ailleurs » progressent parfois jusqu’au bout d’eux-mêmes, à leur propre négation. Joëlle Pétillot (Seishin) ressent un mutisme exalté: « Pour décrire un ailleurs, des mots sont nécessaires. On écrit avec du silence, mais du silence fertile, un vide fécond qui devient autre à mesure que le blanc du départ gagne en apesanteur ». En ce silence qui se déconstruit, la poétesse se retrouve « debout, face à un océan dont l’éternité aboie », puis « L’éternité n’aboie plus, elle danse ».
Ailleurs invite à modifier son regard sur le monde. A L’approcher autrement ou à se sentir quelqu’un d’autre. De façon insolite comme Patrice Blanc qui s’exclame : « J’appelle la pierre ». De façon fusionnelle et troublante : « Je connais bien ce monde, c’est ma peau » comme l’affirme Joëlle Pétillot. De façon charnelle : l’ailleurs peut aussi prendre corps. Tristan Allix, si sensible aux « plaies poétiques des marges », invente une femme aussi effrayante (« Tu es mon enfer par ton mystère ») que désirée (« Je suis ton appétit, ton ventre / Je suis ton paradis quand mes rêves deviennent réalité »).
Au-delà du contenu, cet Ailleurs répercuté dans l’ici de ces poètes propose aussi à jouer avec les formes expressives. Parfois la musique qui émane des poèmes leur donne forme. Christian Kakam joue avec les sons, impulsant un rythme afro : « les saccades continuent par saccades », « la fronde fait fondre », « tous les terreaux rotent », « l’ire dans les heurts » ou « les pulsions hâtent les pulsations ». Parfois le poète Michel Gendarme manie l’art de la répétition. Créant une rengaine, il répète ainsi onze fois « les mots », dix-huit fois « elle », vingt-neuf fois l’interjection « ha »…. Son but, en capturant les mots comme par magnétisme, est de rédiger un poème pour ses amis : « Je veux écrire sur l’eau/, (…) écrire sur la peau de l’eau/, (…) j’écris sur la peau de l’eau ». Son écriture porte en elle et décrit sa propre musicalité : « tout vibrait parfaitement tremblements éboulements ». Un saxophone lançait « des chants lancinants » dans une ville bombardée pleine « d’horreurs ». « Il dansait en-dehors de lui / hors de lui / entre les bombes et le saxo ». Cette musicalité de l’ailleurs peut parfois être constatée sans s’inscrire dans le flux poétique. Ainsi Marcel Faure évoque « Ce baume noir des plaies béantes » dans le bar «du « blues camarade ». « C’est toujours d’actualité / Nègres de toutes les couleurs / Dans le tempo des jours ».
Et moi lectrice, me promenant en bonne compagnie avec ces Ici et Ailleurs poétiques si vivants, j’aurais volontiers ajouté2 l’ici de l’ici, l’ailleurs de l’ailleurs, l’ici de l’ailleurs, et même l’ailleurs de l’ici… Pour clamer à quel point nous sommes emprisonnés et limités par nos propres concepts. Mais… soudain l’interrogation puissante d’Eric Sicilien, me nargue et claque comme une leçon ou une menace : « Et si nos rêves avaient pour vocation d’être poursuivis sans jamais être réalisés ? Et si c’était justement cette quête sans fin qui nous maintenait en émoi ? Autrement dit, en vie ? » Heureusement, ces hypothèses à l’imparfait sont peu probables (pour ne pas dire improbables). Alors ai-je bien lu ou ai-je seulement rêvé?
Notes
- Broderies d’ici et d’ailleurs (2014), Animaux d’ici et d’ailleurs (2015), Gilles 28260.
- Emportée par la fébrilité de la recherche.